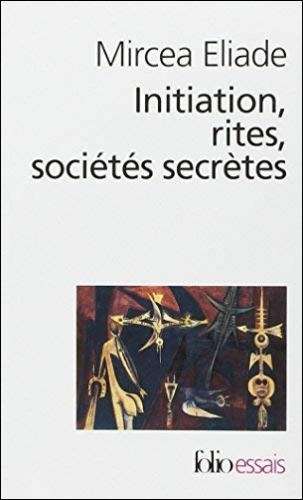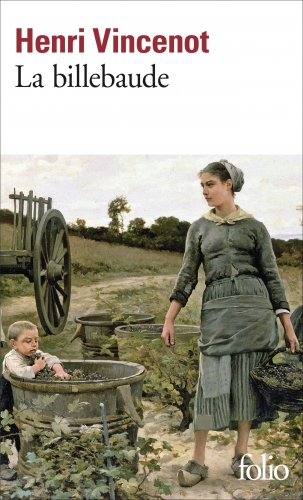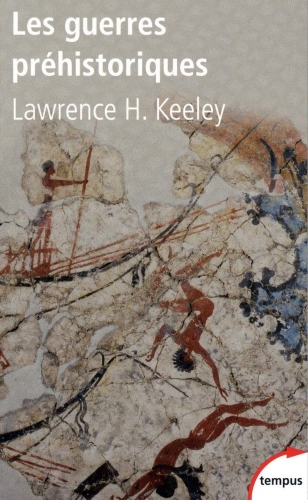Économie : En territoire inconnu
Wall Street a connu début avril sa meilleure semaine depuis… 1938 ! Au moment même où les États-Unis annonçaient un nombre record d’inscriptions au chômage : 16 millions ! Malgré l’extension mondiale de la pandémie de Covid19, la paralysie d’un nombre croissant d’économies et la réduction du commerce international, de l’ordre de 30 %, ni les produits de taux, ni les actions n’ont subi les conséquences de la crise en proportion des effets attendus sur les résultats des entreprises, à l’exception des valeurs directement impactées ; tourisme, aéronautique, etc.
Les marchés lead l’économie
Que se passe-t-il ? Aucun hasard dans cet apparent paradoxe, aucune raison non plus d’en appeler à la ritournelle de ceux qui veulent que tout ça n’ait aucun sens, que les marchés aient perdu toute utilité, et qu’il suffise de fermer les Bourses, d’interdire le versement des dividendes, et accessoirement de nationaliser les entreprises. Les Cassandre finissent toujours par avoir raison, elles ne savent ni quand ni pourquoi, ce qui les rend dérisoires.
Mieux vaut regarder en face les trois faits révolutionnaires qui changent tout ce que nous croyions savoir sur les marchés.
D’abord, ce ne sont plus les chiffres d’affaires et les résultats qui font les mouvements des valeurs d’actifs, c’est l’action des Banques centrales. Business ne fait plus-value. Ceux qui croient encore que les sociétés privées dirigent le monde doivent y réfléchir. Depuis un mois, les États décident du versement des dividendes et des rachats d’action, les États décident de l’implantation des usines et des autorisations de vente à l’étranger ou d’importation de produits industriels, et les États décident de la vente ou non d’entreprises privées à d’autres entreprises privées, le blocage de la vente de Photonis à Télédyne en France en donnant un bon exemple !
Nous sommes loin de l’abandon d’Alcatel, d’Alstom, de Morpho-Safran, de Technip, des Chantiers de l’Atlantique, etc. Et ceux qui croient encore que les marchés s’autorégulent doivent abandonner leurs illusions ; les banques centrales ont tiré la leçon de 2008, elles savent que les marchés s’autorégulent encore moins qu’ils ne sont transparents et équitables, et elles en tirent la conséquence ; à elles de faire les prix de marché — pour le meilleur ou pour le pire, c’est une autre histoire !
L’endettement
Ensuite, la Nouvelle Politique Monétaire (NPM) et son application signifient que l’émission de monnaie est devenue le vrai moteur des économies, et que tout peut être fait, rien ne doit être exclu, qui assure le maintien des valorisations boursières. Les banques centrales sont le premier acteur de l’économie nouvelle. Les marchés ont été nationalisés ; ou, plutôt, les marchés financiers sont devenus trop importants pour les laisser à la confrontation des acheteurs et des vendeurs. Le citoyen avait disparu, effacé par le consommateur, le consommateur disparaît, effacé par l’investisseur, devenu l’acteur central de la société globale, ou par son symétrique, le consommateur endetté, État ou particulier, qui doit avoir la certitude, non de rembourser ses dettes, ne rêvons pas, mais de pouvoir s’endetter davantage !
Nous sommes passés d’un univers dans lequel le crédit bancaire et les aides d’État déterminaient l’activité, au monde dans lequel la valorisation boursière commande la propriété et in fine décide de l’activité du crédit. Quelle Nation pourrait accepter que les plus belles entreprises nationales soient rachetées à vil prix parce que les cours de leurs actions ont baissé ? Trois solutions : la nationalisation, à la fois suspecte et coûteuse ; l’interdiction par la loi, qui trouve vite ses limites géopolitiques ; le soutien des cours. D’où cette conviction appliquée, il faut faire tout ce qu’il faut pour que les valorisations demeurent élevées, et progressent, c’est la condition de la stabilité économique ! La surabondance monétaire booste les cours des actions. Est-ce la nouvelle règle du jeu ?
Enfin, c’en est fini de la diversité des anticipations, cette fiction convenable des marchés où les prix étaient le résultat de l’appréciation du risque, et des anticipations d’acteur divers par leurs horizons de gestion, leurs objectifs de rendement, leur appétence pour le risque, etc. Jamais la détention d’actions n’a été aussi massivement concentrée entre les mains des 1 % de « superriches » — aux États-Unis, de toute leur histoire ! Et jamais la concentration des pouvoirs (ou la confiscation de la démocratie) n’a joué aussi manifestement pour protéger les super-riches contre tout événement fâcheux, et leur garantir la poursuite accélérée de leur enrichissement !
Les banques centrales sont prêtes à tout
Les données publiées par le site « Zerohedge » indiquent plus de 16 000 milliards de dollars ont été engagées par la FED pour sauver les banques américaines, leurs actionnaires et leurs dirigeants, de la faillite et de ses conséquences judiciaires pour les uns, financières pour les autres ! Ce qu’elles n’indiquent pas, c’est ce phénomène bien connu et si bien exploité ; la surrèglementation nourrit l’hyperconcentration. Seuls, les très gros, très riches et très forts bénéficient des seuils réglementaires et normatifs qui excluent les plus petits, plus faibles, moins riches.
Le temps est venu de ranger au bazar des accessoires défraîchis les enseignements de l’économie classique sur la fabrication des prix et les racontars sur « la concurrence libre et non faussée » que nul n’a jamais rencontrée nulle part ailleurs que dans les manuels d’économie et les discours de la Commission européenne à la Concurrence ! Les marchés actions doivent progresser, les Banques centrales en sont garantes, et on ne gagne jamais contre les banques centrales, c’est bien connu ! Voilà qui met à bas tout ce que nous croyions savoir sur les politiques de gestion d’actifs. Les politiques de gestion raisonnables, différenciées, basées sur les fondamentaux des entreprises ou des États n’ont plus de sens quand ce sont les injections de liquidités et les politiques de rachat de tout et n’importe quoi par les banques centrales qui font les cours. S’il est une conclusion à tirer de l’énormité des engagements des banques centrales, Fed comme BCE, c’est bien qu’elles sont prêtes à acheter n’importe quoi pour que la musique continue !
Dans ces conditions, le couple risque-rentabilité qui dirigeait les allocations d’actifs raisonnées n’est plus de saison. La sélection des titres est un exercice vain. Tout simplement parce que la partie « risque » s’est évanouie, ou que l’action des banques centrales fait qu’il est impossible de l’évaluer. Il n’y a plus de prix pour le risque, ce qui interroge au passage sur le nouveau tour du capitalisme et le sens du mot « entrepreneur ». La logique est : qui va bénéficier des actions de la FED et du Congrès, de la BCE et des décisions du Conseil et de l’Eurogroupe ?
La richesse ne vient plus du travail
Au moment d’entrer en territoire inconnu, que conclure ? D’abord, essayer de comprendre les règles du « new normal ». Les règles ne sont pas les mêmes, ce qui ne signifie qu’il n’y a pas de règles ; elles sont nouvelles, c’est tout. Ensuite, s’efforcer de prévoir l’évolution dans le temps de ces règles et de leurs impacts, leur nouveauté même pouvant réserver toutes les surprises. Enfin, reconnaître l’intérêt de la France, et faire en sorte que la France sorte gagnante d’un jeu qui fera des gagnants et des perdants.
Sauver l’effet richesse, c’est la nouvelle règle du chef d’orchestre. La richesse dans les pays riches ne vient plus du travail, mais de la détention ou de l’attraction du capital (cas exemplaire des start-up qui ne sont riches ni de produits, ni de clients, ni de chiffre d’affaires, mais du capital qu’elles lèvent sans limites, et qu’elles consomment également sans limites ; voir Uber, Tesla, etc. !) Et voilà comment des compagnies aériennes américaines qui ont racheté pour 45 milliards de leurs propres actions (soit 96 % de leur cash flow disponible) pour enrichir leurs actionnaires demandent… 54 milliards d’aides au gouvernement pour ne pas faire faillite (Boeing a suivi la même politique, consacrant la totalité de son cash flow disponible en dix ans au rachat de ses propres actions et demande également le sauvetage par l’argent public) !
Le compromis entre le capital et le travail a été rompu dans les années 1990 pour être remplacé par un compromis entre les détenteurs du capital et les banques centrales ; il ne s’agit plus de partager des gains de productivité, il s’agit de s’enrichir sans fin ! Il ne s’agit plus de redouter une « stagnation séculaire » de la croissance dans les pays riches, il s’agit d’assurer l’enrichissement des plus riches par la création monétaire déversée sur les marchés d’actifs ! Ce ne sont plus les plus vulnérables qui sont protégés, ce sont les plus riches qui peuvent se servir. Il est permis d’espérer, mais ce n’est pas demain que le monde du travail retrouvera les leviers qui lui avaient permis de négocier le partage des gains de productivité qu’assurait l’industrie — d’ailleurs, il n’y a plus chez nous ni industrie ni gains de productivité ! Pour s’en convaincre, et contrairement à tout ce que suggèrent la situation actuelle et la célébration méritée du courage des soignants, des gendarmes et des policiers, des caissières et des livreurs, il suffit de regarder où va l’argent émis par les banques centrales ; les marchés ont l’argent, les soignants ont l’ovation de 20 heures aux fenêtres chaque soir ! Paradoxalement, la pandémie marque un nouveau bond en avant du capitalisme libéral. Certains peuvent rêver que ce soit le dernier.
L’Europe laissée de côté pour le véritable affrontement
Éviter la confrontation au réel et ruiner l’adversaire, c’est le jeu du moment. Un jeu impitoyable dans la confrontation des faibles aux forts. La Chine est annoncée grande gagnante de l’épreuve actuelle. Attendons. Il serait paradoxal que le pays d’où est parti la pandémie, qui l’a probablement aggravé par sa politique de censure des informations critiques, ou simplement des mauvaises nouvelles, et par le retard mis à en reconnaître le caractère expansif et non maîtrisé, en tire un bénéfice géopolitique et financier, mais nous sommes installés en plein paradoxe (le fait qu’une chose et son contraire puissent être affirmés en même temps est caractéristique de la situation présente, c’est-à-dire du chaos cognitif et de la confusion mentale) ! Attendons pour en juger de voir quels engagements en faveur de la relocalisation massive de nos productions stratégiques seront effectivement tenus.
Tout indique que les États-Unis se détournent de l’Europe pour engager la confrontation avec le pays qu’ils jugent leur premier adversaire du XXIè siècle, une confrontation dont tout indique qu’elle mobilisera la gamme entière des stratégies non conventionnelles et des armes non militaires, les moyens de paiement, les systèmes d’information et les attaques biologiques constituant quelques-uns des moyens d’un arsenal varié. Bitcoin, 5G, biotech — nous n’avons encore rien vu des ressources que la monnaie et la finance de marché peuvent mobiliser pour appauvrir l’ennemi, pour diviser l’ennemi, pour obliger l’ennemi à composer.
Plus besoin des canonnières du commodore Perry pour obliger un pays à s’ouvrir et à se plier ! Au choix, on considérera les milliers de milliards de dollars mis sur la table par la FED depuis ces dernières années comme une arme de destruction massive pour les détenteurs de papier libellé en dollar, ou pour le système financier occidental lui-même… les paris sont ouverts ! Et on sera attentif au projet attribué au macronisme de confier la gestion des réserves d’or de la France à une banque américaine ; après le pillage d’Alstom, le pillage de la Banque de France ? Pendant la pandémie, le hold-up continue !
Protéger le patrimoine national et l’activité nationale devient une priorité pour chaque État. C’est la priorité de la France. La sécurité monétaire, la sécurité économique et patrimoniale, s’imposent au premier rang des enjeux de sécurité globale. Derrière les soubresauts boursiers, les risques de prise de contrôle de tel ou tel fleuron technologique ou industriel sont multipliés. Derrière la suppression de la monnaie papier, les enjeux de contrôle, de détournement, et de vol, sont gigantesques. Derrière la naïveté avec laquelle les administrations européennes prétendent se moderniser en substituant au papier et au guichet l’Internet obligé se cache mal l’exploitant américain ou chinois et un retour au temps des colonies, quand quelques compagnies privées, aventureuses et pirates, se partageaient des continents.
Et qu’en sera-t-il si le traçage individuel grâce aux données collectées à partir des téléphones portables se justifie par des motifs sanitaires pour devenir la règle imposée à toute la population, au bénéfice des prestataires qui s’en félicitent déjà ? La pandémie n’arrête pas les (bonnes) affaires d’Atos et de ses concurrents (écouter à ce sujet sur RTL l’étonnant discours du commissaire européen Thierry Breton, ex-PDG d’Atos, ouvrant sereinement la voie au contrôle numérique de la population européenne !) Derrière l’échappée belle de toutes les règles budgétaires de rigueur imposées par l’Union, s’annonce une course qui fera des gagnants et des perdants.
La France doit saisir dans la pandémie une bonne occasion de rompre avec les contraintes que l’Union européenne impose aux choix nationaux, à la protection du marché national, à la préférence pour les entreprises nationales. La France doit utiliser au maximum les facilités qui sont offertes par la BCE, par un mécanisme européen de solidarité (MES) débarrassé de toute conditionnalité, par le fonds européen de relance annoncé.
Elle doit le faire au profit des entreprises françaises, des projets français, de l’indépendance de la France – et sauver les entreprises familiales du commerce et de la restauration, contre les ambitions prédatrices des chaînes mondiales de « malbouffe ». Elle doit mobiliser toutes les capacités que l’Union européenne peut offrir dans son propre intérêt, comme l’Allemagne, comme les Pays-Bas, comme les autres Nations le font. Et elle doit plus encore considérer les marchés financiers pour ce qu’ils sont, un outil à la disposition de qui choisit de s’en servir. Voilà qui n’invalide pas le rôle des marchés, mais qui le transforme.
Tout simplement parce que nous sortons du monde du bon père de famille qui savait que rembourser des dettes enrichies. Dans le nouveau monde, non seulement les dettes ne seront jamais remboursées, mais celui qui s’enrichit est celui qui peut émettre le plus de dettes. Dans le nouveau monde, ce ne sont plus des créanciers exigeants et sourcilleux qui achètent la dette, ce sont des banques centrales d’autant plus accommodantes qu’elles jouent elles-mêmes leur survie — au cours des dernières semaines, la nouvelle Présidente de la BCE, Christine Lagarde, l’a bien compris !
Et l’impensable arrive. La France de 2020 doit savoir s’enrichir de sa dette et mobiliser sans freins la dépense publique, si elle sait l’employer à relocaliser son industrie, à relancer une politique territoriale qui commence par le soutien au secteur de l’hôtellerie, de la restauration familiale et du petit commerce, à relancer de grands projets (le second porte-avion, le cloud français ?) et à réduire le coût du financement de son économie, l’exemple allemand étant sur ce sujet à méditer.
Mieux vaut danser en cadence quand s’arrêter donne le vertige. Les colonnes du temple européen s’effondrent les unes après les autres, de Maastricht à Schengen, ce n’était que des colonnes en papier. Mais que l’entreprise privée, libre de sa stratégie, que les marchés concurrentiels où se forment les prix, que l’allocation des capitaux selon le rapport rendement-risque disparaissent par la magie complaisante des banques centrales, voilà qui mérite attention ; ce sont cette fois les bases du libéralisme qui sont mises à mal. Certains diront ; changeons de partition ! D’autres diront plus simplement ; tant que la musique joue, il faut continuer à danser, seuls ont tort ceux qui pensent d’en tirer en s’isolant dans leur coin. Mais la seule question qui compte est tout autre ; vaut-il mieux être celui qui joue dans l’orchestre, celui qui danse sur la piste, ou celui qui agite son mouchoir sur le quai en regardant partir le Titanic, tous pavillons flottant au vent ?
Hervé Juvin (Site officiel d'Hervé Juvin, 13 avril 2020)