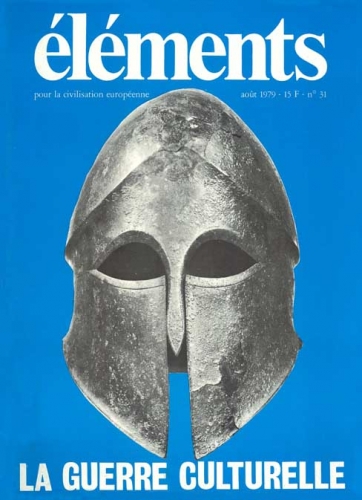Nous reproduisons ci-dessous un texte de Lionel Baland cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré à Oswald Spengler...

Tombe d'Oswald Spengler à Münich
Oswald Spengler à Munich : du « socialisme prussien » au mythe du soldat de Pompéi
Oswald Spengler, qui compte parmi les théoriciens prépondérants de la Révolution conservatrice allemande, a passé deux parties de son existence à Munich, la première en 1901-1902 et la seconde de 1911 à sa mort survenue en 1936. Lionel Baland retrace la vie au sein de la capitale bavaroise de cet écrivain dont les idées décadentistes sont de nos jours en pleine résurgence et dont l’ouvrage le plus célèbre, Le Déclin de l’Occident (1918 et 1922), a été rédigé au sein de cette cité, à l’instar de Prussianité et socialisme (1919), de L'Homme et la Technique (1931) et d’Années décisives (1933).
Né en 1880, Oswald Spengler débarque, souffrant de violents maux de tête, pour la première fois à Munich un soir d’octobre 1901. Au cours de la première nuit, il est piqué par des punaises. Il change de lieu et loge chez la veuve du juge Weigel, dans la Kaulbachstrasse, au sein du quartier de la bohème littéraire et artistique de Schwabing – qui comprend Schwabing et une partie de Maxvorstadt. Il suit, en 1901-1902, des cours à l’université Ludwig-Maximilian. Le Munich illuminé du tournant du siècle l’envoûte. L’architecture de cette ville d’art l’impressionne. La Ludwigstrasse est pour lui une des plus belles rues du monde. Les châteaux, situés non loin de Munich, construits à l’initiative du roi Louis II de Bavière lui font grande impression. Le 27 décembre 1901, il visite la chapelle érigée près du lac de Starnberg consacrée au souvenir de ce souverain mort noyé en cet endroit. Dans les églises munichoises, il perçoit la différence entre le catholicisme du sud de l’Allemagne et le protestantisme du nord dont il est originaire. Il admire le compositeur de musique Richard Wagner et le peintre symboliste suisse Arnold Böcklin. Il s’intéresse au théâtre, ainsi qu’aux symphonies de Richard Strauss. Il prend des cours de dessin de nus.
Les membres du cercle constitué autour du poète rhénan Stefan George, un des inspirateurs de la Révolution conservatrice allemande, se réunissent dans une maison voisine de celle dans laquelle Oswald Spengler vit dans la Kaulbachstrasse. Franziska zu Reventlow, qui fréquente les membres munichois de ce cercle, décrira l’ambiance de l’époque au sein du quartier de la bohème littéraire et artistique de Schwabing dans son roman à clé Herrn Dames Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus einem merkwürdigen Stadtteil (« Les notes de Monsieur Dame ou événements de la vie d’un quartier étrange »), qui paraîtra en 1913 et deviendra un des livres préférés d’Oswald Spengler. Ce dernier ne fréquente pas les membres du cercle Stefan George, à l’exception de Friedrich Huch et, plus tard, de Karl Wolfskehl, qui a appartenu au Cercle cosmique de Munich, avec Alfred Schuler et Ludwig Klages, deux inspirateurs de la Révolution conservatrice allemande dont Oswald Spengler apprécie fortement les idées tout en n’entretenant pas de relation avec eux.
Retour à Munich
Une décennie plus tard, en 1911, à la suite du décès inopiné de sa mère, il hérite d’une somme d’argent qui lui permet désormais de vivre sans travailler et choisit de s’implanter dans la ville qui représente le sud et la liberté : Munich. Il a pour objectif de se consacrer à la poésie et à l’art. Il est déçu par le style Art nouveau des constructions qui ont vu le jour au cours des dernières années et par la peinture expressionniste du groupe Der Blaue Reiter (« Le cavalier bleu ») de Vassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Gabriele Münter, Paul Klee, … Il vit dans deux pièces meublées au numéro 38 de l’Arcisstraße, dans le quartier de Maxvorstadt, non loin du quartier de la bohème littéraire et artistique de Schwabing. Il porte son linge dans un lavoir de la Schellingstraße. Une employée, Maria Kirmaier, lui reprise ses chaussettes. Oswald Spengler déménage en 1914 dans l’Agnesstraße au numéro 54/1, dans le quartier de Schwabing. L’appartement est orienté vers le nord, toutes les fenêtres donnent sur la cour et il comprend trois pièces. Celle de réception contient des meubles en acajou hérités du côté maternel. La pièce avec la plus grande fenêtre est le bureau. Sa table de travail est une planche à repasser, en dessous de laquelle il peine à placer ses jambes, tournées de côté et l’une sur l’autre. Il se promène dans la rue de manière décontractée avec un sac à dos contenant des ouvrages empruntés à la bibliothèque municipale. Il écrit avant tout la nuit et mange à des heures irrégulières. Sa sœur Adele vit quelque temps chez lui puis part.
La guerre
Oswald Spengler ne participe pas, car cela ne correspond pas à son tempérament, à l’éclatement de joie et d’excitation nationaliste parmi la masse qui se rassemble sur l’Odeonplatz dans le centre de la capitale bavaroise lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale et reste à la maison. L’artiste peintre Adolf Hitler, fuyant le service militaire au sein de l’empire des Habsbourg et arrivé à Munich plus d’un an après lui, y prend, en revanche, part. Les deux hommes perçoivent ce moment comme étant d’une importance capitale. Spengler estime qu’il se trouve face au « plus grand jour de l’histoire mondiale qui tombe dans sa vie » et pense que cela s’accorde avec l’idée pour laquelle il est né. Fataliste, il voit la guerre comme une phase inévitable du déclin de l’homme occidental ambitieux et condamné à l’épuisement par sa propre dynamique infinie, alors qu’Adolf Hitler est, lui, émerveillé par cet événement et remercie le ciel de lui avoir donné la possibilité de vivre à cette époque.
La guerre atteint les avoirs financiers d’Oswald Spengler. Il est contraint de gagner de l’argent via des exposés et des contributions à la presse écrite. L’économie de guerre provocant des privations, il subit la faim et le froid.
La première partie du Déclin de l’Occident paraît en avril 1918. Attaqué par le philosophe Walter Benjamin et l’écrivain et journaliste Kurt Tucholsky, « Spengler fut au contraire salué par Georg Simmel, à qui il avait envoyé un exemplaire de son livre, comme l’auteur de la “philosophie de l’histoire la plus importante depuis Hegel”, ce qui n’était pas un mince compliment. L’ouvrage fit aussi grande impression sur Ludwig Wittgenstein, qui approuvait le pessimisme de Spengler, ainsi que les grandes lignes de sa méthode, sur l’économiste Werner Sombart, ainsi que sur l’historien Edouard Meyer qui, après une discussion de cinq heures avec l’auteur du Déclin de l’Occident, devint son admirateur et son ami. Max Weber fut moins impressionné, mais n’en invita pas moins Spengler à prendre la parole dans le cadre de son séminaire de sociologie à l’Université de Munich en décembre 1919. Quant à Heidegger, qui cite souvent Spengler, mais ne lui a jamais consacré d’étude exhaustive, il prononça en avril 1920, à Wiesbaden, une conférence sur Le déclin de l’Occident. » (1) L’ouvrage influence fortement Thomas Mann, alors que celui-ci adhère aux idées de la Révolution conservatrice allemande, dont il se détournera définitivement en 1922 et prendra ses distances avec le livre, ainsi que les frères Friedrich Georg et Ernst Jünger, deux autres penseurs de la Révolution conservatrice allemande.
Le dégoût, qui envahit Oswald Spengler lors de la prise du pouvoir, le 7 et 8 novembre 1918, à Munich par le socialiste révolutionnaire Kurt Eisner, lui est presque insupportable.
La République de Weimar
La défaite de l’Allemagne constitue un énorme choc pour Oswald Spengler, ainsi que pour Adolf Hitler. Les deux sont opposés à la révolution de 1918, à la République et à au traité de paix de Versailles. En dehors de l’antisémitisme exacerbé et petit bourgeois d’Adolf Hitler qui a vécu à Vienne, les deux hommes désirent tous les deux la mise à bas du traité de Versailles, un Reich fort en tant que cœur d’une sphère d’influence, le nationalisme, un « socialisme allemand » et une direction autoritaire non-parlementaire.
Oswald Spengler prend part, à Munich, à une conférence du comte et écrivain Hermann von Keyserling sur la reconstruction de l’esprit allemand. À l’issue de celle-ci, quelques participants se retrouvent en petit cercle : le médiéviste Friedrich von der Leyen et sa femme, Hermann von Keyserling et la sienne, le couple d’éditeur Hugo et Elsa Bruckmann qui tiennent le salon éponyme, l’historien de l’art Heinrich Wölfflin et Oswald Spengler. Alors que Spengler considère le déclin comme étant inévitable, Keyserling estime que la situation catastrophique de l’époque permet d’envisager une régénération spirituelle. (2)
Au cours du mois de janvier ou février 1919, Oswald Spengler se plaint auprès de Karl Wolfskehl – un des précurseurs de la Révolution conservatrice allemande, ancien membre, au début du siècle, du Cercle cosmique – d’avoir dû confier son manuscrit de la première partie de sa production Le Déclin de l’Occident à l’éditeur viennois Braumüller, loin de Munich. Quelques jours plus tard, Karl Wolfskehl en parle à August Albers, lecteur aux éditions munichoises C. H. Beck. Cette maison publie en 1919 Preußentum und Sozialismus (« Prussiannité et socialisme ») – au sein duquel Oswald Spengler défend l’idée d’un socialisme prussien, basé sur la discipline, la hiérarchie, le sens du devoir, le sacrifice pour la communauté, la primauté de l’État et de la nation sur l’individu et la finance – et la seconde partie de l’œuvre Le Déclin de l’Occident en 1922. La maison d’édition publie également la troisième édition et les suivantes de la première partie du texte Le Déclin de l’Occident.
Le 21 février 1919, le comte Anton von Arco auf Valley, ardent nationaliste, assassine Kurt Eisner. Le 7 avril, la République des Conseils est proclamée par des intellectuels anarchistes et des socialistes radicaux : Ernst Toller, Gustav Landauer, Erich Mühsam, Silvio Gesell et Ernst Niekisch – qui deviendra, à partir de 1926, un des principaux penseurs de la Révolution conservatrice allemande et le principal de sa tendance national-bolchévique. Le 12-13 avril 1919, des communistes instaurent la deuxième République des Conseils qui est écrasée le 2 et 3 mai par les corps francs nationalistes. Le 4 mai, Oswald Spengler rapporte à un ami : « Nous sommes enfin libérés de l’enfer de ces quatre semaines. » Ernst Niekisch est incarcéré à la suite de la répression organisée par les nationalistes et lit en prison des écrits d’Oswald Spengler.
Au printemps 1920, Oswald Spengler change de logement au sein du même immeuble du 54/I de l’Agnesstraße, et vit dans un plus grand appartement situé au troisième étage. Il se rend en divers endroits d’Allemagne. Ainsi, Il rencontre, dans la seconde semaine de juillet à Berlin, Arthur Moeller van den Bruck, un des plus importants penseurs de la Révolution conservatrice allemande, dans une maison située Motzstraße 22 au sein de laquelle se réunit, sous la direction de Heinrich von Gleichen, le Juniklub, les deux étant également des éléments de la Révolution conservatrice allemande. Il prend part jusqu’en 1923 aux activités de la filiale munichoise du Juniklub dirigée par l’historien Karl Alexander von Müller (3). Oswald Spengler est en relation avec Elisabeth Förster-Nietzsche, la sœur du philosophe Friedrich Nietzsche qui est un des inspirateurs de la Révolution conservatrice allemande.
En 1924, alors qu’Adolf Hitler est emprisonné à Landsberg à la suite de son putsch manqué de 1923, Gregor Strasser tente d’obtenir d’Oswald Spengler qu’il publie des articles dans un organe de presse national-socialiste, ce que ce dernier refuse catégoriquement, car il estime que la politique doit reposer sur des faits et des considérations et pas sur un romantisme des sentiments qu’il attribue au national-socialisme.
Il déménage, en 1925, dans la Widenmayerstraße, au numéro 26. Sa sœur, Hildegard Kornhardt-Spengler, dont le mari Fritz est mort au front durant la Première Guerre mondiale, et sa fille Hilde, partent à Munich et vivent chez Oswald Spengler.
Oswald Spengler se promène, parfois accompagné de sa sœur, et se rend au théâtre. Le 3 août 1931, Karl Wolfskehl leur rend visite.
Le IIIe Reich
Après l’arrivé au pouvoir, le 30 janvier 1933, d’Adolf Hitler, Oswald Spengler rencontre ce dernier le 25 juillet 1933, de 12h30 à 14h, à Bayreuth. En août, Spengler lui envoie son ouvrage Jahre der Entscheidung. Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung (« Années décisives. L’Allemagne et le développement de l’histoire mondiale »). Hitler fait transmettre un remerciement formel pour l’envoi. Le livre est perçu par les nationaux-socialistes comme une critique du système qu’ils ont mis en place, pendant qu’Oswald Spengler se tient totalement à distance d’eux.
Après le discours tenu à l’université de Marbourg par le vice-chancelier national-conservateur Franz von Papen le 17 juin 1934 et rédigé par le théoricien de la Révolution conservatrice allemande Edgar Julius Jung contestant certains côtés, liés au national-socialisme, du nouveau régime, la Nuit des longs couteaux éclate et parmi les victimes des nationaux-socialistes se trouvent, à la suite d’une confusion avec une autre personne, le critique musical Willi Schmid qu’Oswald Spengler connaît personnellement et le national-socialiste de l’aile la plus sociale du parti Gregor Strasser qui entretient une correspondance avec Oswald Spengler, ainsi que l’ancien chancelier national-conservateur Kurt von Schleicher, auquel Oswald Spengler est lié, et sa femme. Edgar Julius Jung est aussi assassiné lors de la Nuit des longs couteaux. Cela s’ajoute au fait que Karl Wolfskehl, juif, a quitté l’Allemagne peu de temps après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler.
Le 1er mai 1935, devant un million et demi de personnes rassemblées à Berlin-Tempelhof, ce dernier déclare : « Un écrivain a résumé ses vues sur l’époque dans un livre qu’il a intitulé Le déclin de l’Occident. Serait-ce donc vraiment la fin de notre histoire et de notre peuple ? Non ! Nous ne pouvons pas croire cela ! Ce ne doit pas être le déclin de l’Occident, mais la résurrection des peuples d’occident ! » (4)
Oswald Spengler meurt le 8 mai 1936, dans son appartement à Munich, d’une crise cardiaque. Il est enterré au Nordfriedhof (« cimetière nord ») dans le quartier de Schwabing où repose, au sein de la crypte, Alfred Schuler, membre du Cercle cosmique et qui compte parmi les inspirateurs de la Révolution conservatrice allemande qui sera théorisée par Armin Mohler qui sera enterré, ainsi que sa femme Edith, dans une tombe de ce cimetière. Une pierre en porphyre portant l’inscription « Spengler » est placée sur celle de l’auteur du Déclin de l’Occident.
Le César attendu
De nos jours, la phase ultime du déclin qu’est, selon Oswald Spengler, la dernière tentative vaine, constituée par l’avènement de Césars, de redressement avant l’effondrement final, paraît advenir. Par-delà la question de la différence entre le côté prolétarien du national-socialisme et celui plutôt aristocratique du prussianisme d’Oswald Spengler, ainsi que le fait que ce dernier reproche au national-socialisme son romantisme et un manque de profondeur intellectuelle, le clivage entre Adolf Hitler et Oswald Spengler semble à nouveau se poser de nos jours en Europe occidentale et aux États-Unis, entre ceux qui pensent que le redressement est possible grâce à des changements radicaux et ceux qui estiment que les carottes sont cuites. Pour ces derniers, il nous reste à couler de manière honorable en nous accrochant au mythe décrit par Oswald Spengler en conclusion de Der Mensch und die Technik.Beitrag zu einer Philosophie des Lebens (« L’Homme et la technique. Contribution à une philosophie de la vie ») qui veut que notre devoir soit de tenir la position perdue, sans espoir, comme ce soldat romain dont les ossements ont été retrouvés devant une porte de Pompéi et qui, pendant l’éruption du Vésuve, est mort à son poste parce qu’on a oublié de le relever. (5) Pour eux, ce qui a été une culture, puis une civilisation, ne sera bientôt plus qu’une simple « population », à l’instar de l’Égypte après la fin du monde des pharaons, dominée quelques temps par une civilisation étrangère, puis durant une ou deux générations par une autre.
Lionel Baland (Site de la revue Éléments, 19 février 2026)
Notes :
(1) Alain de Benoist, Quatre figures de la Révolution Conservatrice allemande. Werner Sombart, Arthur Moeller van den Bruck, Ernst Niekisch, Oswald Spengler, Association des amis d’Alain de Benoist, Paris, 2014, p. 257-58.
(2) Wolfgang Martynkewicz, Salon Deutschland. Geist und Macht 1900-1945, Aufbau Verlag, Berlin, 2009, p. 347-348.
(3) de Benoist, Quatre figures, p. 265-266.
(4) de Benoist, Quatre figures, p. 280-281. (texte repris de : Max Domerus (Hg.), Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945, vol. 1, R. Löwit, Wiesbaden, 1973, p. 502)
(5) Oswald Spengler, Der Mensch und die Technik, München, 1931, p. 89.
Sources
DE BENOIST Alain, Quatre figures de la Révolution Conservatrice allemande. Werner Sombart, Arthur Moeller van den Bruck, Ernst Niekisch, Oswald Spengler, Association des amis d’Alain de Benoist, Paris, 2014.
ENGELS David, Oswald Spengler. Introduction au Déclin de l’Occident, collection Longue mémoire de l’Institut Iliade, La Nouvelle Librairie éditions, Paris, 2024.
FRIEDEL Helmut (sous la direction de), La Städtische Galerie im Lenbachaus Munich, Prestel, Munich, 1999.
KOKTANEK Anton Mirko, Oswald Spengler. Leben und Werk, Lindenbaum Verlag, Beltheim-Schnellbach, 2020.
MARTYNKEWICZ Wolfgang, Salon Deutschland. Geist und Macht 1900-1945, Aufbau Verlag, Berlin, 2009.
MOHLER Armin, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, Friedrich Vorwerck Verlag, Stuttgart, 1950.
SPENGLER Oswald, Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens, München, 1931.