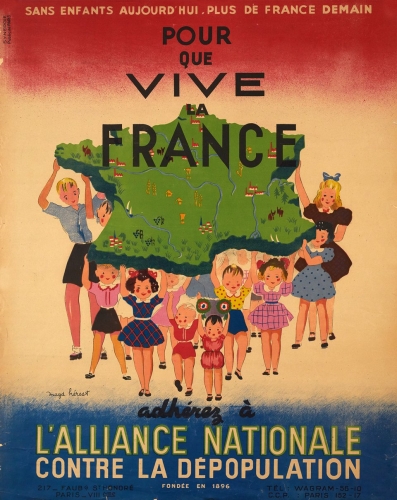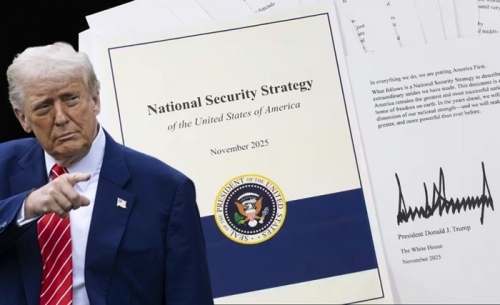L’Amérique sonne le glas de l’Europe – et l’Europe ne l’entend pas
Dans ma cuisine de Lechiagat, là où les vents du large s’invitent comme des hôtes anciens, une langue de bœuf d’un kilo quatre repose dans une grande marmite et s’attendrit à feu doux. Ce morceau, autrefois le plus humble des abats, presque un cadeau du boucher, est devenu un bien précieux, preuve minuscule mais obstinée de l’augmentation générale du prix de la vie, y compris des nourritures les plus frugales. Son bonheur, c’est qu’elle se prête à plusieurs apprêts. À la sauce tomate elle devient franche et populaire, à la vinaigrette elle prend un tour aristocratique, presque madré. Et puis elle nourrit plusieurs jours, ce qui n’est pas un mince avantage pour qui mène, comme moi, une existence partagée entre mer, papier et solitude.
Pendant qu’elle cuit paisiblement, je suis à ma table où s’accumulent journaux froissés, peaux d’oignons, casseroles qui sèchent et je lis le document qu’a publié la Maison-Blanche, censé présenter au monde la vision géostratégique de l’Amérique. J’avais promis de le parcourir sans hâte, parce qu’un tel texte demande plus que de l’attention, il exige cette vieille discipline personnelle à laquelle les Bretons étaient attachés, mélange de prudence et d’obstination.
Je m’attendais à un exercice rhétorique, à des formules convenues. Je découvre un acte de rupture.
Le fragment le plus saisissant du document américain ne tient pas seulement dans l’usage de quelques mots durs, mais dans la construction méthodique d’un réquisitoire, presque d’un acte d’accusation contre l’Europe. Jamais, depuis la rédaction du Traité de l’Atlantique Nord, Washington n’avait parlé de son «alliée» dans un ton si dénudé, sans fard, sans onction diplomatique.
L’Europe y apparaît comme un continent engagé non pas dans une simple crise passagère, mais dans un processus historique d’effacement, un glissement lent et continu vers ce que les Américains nomment sans trembler «civilizational erasure». L’expression revient à plusieurs reprises, avec une précision clinique. Elle n’appartient ni au registre polémique ni au lexique politique habituel: elle relève de la morphologie historique, presque du diagnostic anthropologique.
Les rédacteurs du texte décrivent une Europe qui aurait perdu, morceau après morceau, ce qui constituait sa colonne vertébrale. Ils évoquent une «perte de confiance culturelle», formule qui résume en quatre mots l’épuisement moral d’un continent qui doute désormais de sa légitimité à exister. Ils parlent de «cratère démographique», image frappante, rappelant un sol crevé, affaissé, incapable de soutenir la moindre construction durable. Ils insistent sur des politiques migratoires qualifiées d’auto-destructrices, non parce qu’elles accueillent, mais parce qu’elles remplacent.
Le texte ne s’arrête pas là. Il décrit des gouvernements instables, incapables de représenter des majorités réelles, enfermés dans des coalitions fragiles, dépendants de minorités bruyantes. Il y a quelque chose d’impitoyable dans la manière dont les Américains écrivent que nombre d’États européens sont gouvernés «par des responsables qui n’ont plus le soutien de leur population», comme si la démocratie représentative, chez nous, n’était plus qu’un théâtre d’ombres.
Puis vient la phrase qui, pour l’Europe, devrait résonner comme un coup de tocsin: l’idée que plusieurs nations pourraient devenir «majoritairement non européennes», non pas dans un avenir lointain, mais «dans quelques décennies au plus tard».
Le document ne suggère pas un risque, il annonce une transformation irréversible, presque accomplie : «Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable dans vingt ans.»
Ce n’est pas une image, c’est une prophétie.
Ce n’est pas une alerte, c’est un verdict.
Voilà ce que l’Amérique pense désormais de nous. Voilà ce qu’elle ose écrire, en pleine lumière, sans prendre soin de ménager les susceptibilités européennes. Le voile diplomatique est tombé: il ne reste plus que la nudité du jugement.
Mais le plus extraordinaire n’est pas seulement le diagnostic. C’est ce qui le suit. Car Washington ne propose pas d’aider l’Europe à se sauver d’elle-même. Elle propose d’ouvrir un siège à l’intérieur même des nations européennes, de «cultiver la résistance à leur trajectoire actuelle». Autrement dit: soutenir, encourager, financer, accompagner toutes les forces politiques qui voudraient rompre avec l’ordre institutionnel et idéologique dominant.
Ce n’est plus un rapport stratégique. C’est une intervention doctrinale, une feuille de route pour remodeler l’Europe en profondeur, au profit des intérêts américains.
Et l’on comprend soudain que ce texte marque une rupture radicale dans l’histoire atlantique.
Les Américains ne craignent plus de dire qu’ils doutent de l’Europe. Ils doutent de ses gouvernements. Ils doutent de sa survie civilisationnelle. Ils doutent même de sa capacité à rester une alliée fiable.
Ils ne voient plus en nous un partenaire. Ils voient un champ de bataille idéologique, culturel, démographique.
Voilà la nouveauté. Voilà la bombe politique. Voilà le morceau de vérité brutale qui, d’un seul coup, éclaire tout le reste.
Il faut mesurer ce que représente une telle franchise. Depuis Woodrow Wilson, souvent guidé par l’influence moins visible mais décisive du colonel House, les États-Unis ont développé un universalisme qu’ils ont présenté comme un idéal mais qui fut avant tout un outil. La Société des Nations puis l’Organisation des Nations unies n’étaient pas natives d’une philanthropie désintéressée. Elles étaient des instruments destinés à organiser le monde autour d’un pivot: Washington.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe, ruinée par un désastre dont les États-Unis avaient été à la fois les arbitres et les bénéficiaires, fut reliée à l’Amérique par deux chaînes scintillantes: le crédit et l’OTAN. Nous avons vécu avec cette alliance comme avec un mariage arrangé dont on finit par oublier qu’il fut d’abord une tutelle.
L’administration Trump ne se contente pas de rappeler cette vérité. Elle la proclame et l’assume. Et elle franchit un seuil jamais atteint: elle annonce vouloir «cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l’Europe au sein même des nations européennes». Ce n’est pas un détail. C’est une doctrine.
En clair: les États-Unis soutiendront désormais les forces politiques européennes qui contestent l’ordre institutionnel, migratoire et idéologique dominant en Europe. Ils ne s’adresseront plus seulement aux gouvernements, mais aux peuples, aux partis, aux courants souterrains.
C’est un renversement total de posture. Une révolution géopolitique en gants de boxe.
Les Européens, que disent-ils? Rien ou presque. Les chancelleries se raidissent, s’indignent de la forme, regrettent la brutalité, invoquent les fameuses «valeurs». On ne conteste pas le diagnostic, on conteste le ton. Comme si l’esthétique d’un texte importait plus que son contenu.
Il y a dans ces réactions une sorte de vacuité tragique. Les dirigeants européens ne semblent pas comprendre ce qui leur est dit. Ils persistent à croire que l’Amérique demeure ce protecteur bienveillant dont il suffirait de caresser l’humeur. Ils pensent que la rupture n’est qu’un orage. Elle est tectonique.
Pourtant, depuis des décennies, des voix européennes avertissent de cette dépendance. Alain de Benoist a montré que l’atlantisme avait fonctionné comme une dissolution de la souveraineté. Guillaume Faye, avec sa verve prophétique, expliquait déjà que les États-Unis n’hésiteraient pas un jour à se délier de l’Europe si leurs intérêts l’exigeaient. Alexandre Douguine voyait dans l’Union européenne un espace intermédiaire incapable d’être sujet. Même Ernst Jünger, dans ses méditations tardives, pressentait que les nations européennes étaient sur le point de perdre le contrôle sur les grandes forces historiques.
Ce que Trump dit aujourd’hui n’est que l’écho brutal de ces diagnostics longtemps méprisés.
Et pourtant, paradoxalement, ce texte américain pourrait être pour l’Europe un électrochoc salutaire. Jamais, depuis soixante-dix ans, les Européens n’avaient reçu une telle invitation à redevenir adultes. L’Amérique ne veut plus être notre tuteur. Elle nous dit: assumez-vous. Défendez-vous. Devenez ce que vous prétendez être.
Mais nos dirigeants n’entendent rien. Ils ne parlent que de ton, jamais de fond. Ils répètent que «l’alliance est indéfectible», comme si le verbe suffisait à conjurer la réalité.
La langue est prête. Je coupe le feu, la vapeur s’élève, douce et matérielle, un souffle d’autrefois dans une cuisine bretonne. Je referme le document américain. Je reste un instant immobile, les mains tièdes de chaleur et d’inquiétude.
Ce gouvernement Trump, par son cynisme franc, nous rappelle une vérité que nous avions soigneusement ensevelie sous des couches de bons sentiments et de discours atlantistes: les États-Unis ne sont pas nos amis. Ils sont une puissance. Une grande puissance, certes, mais une puissance qui agit pour elle-même et non pour nous.
Rien n’est plus normal, d’ailleurs. Rien n’est plus sain.
Le vrai scandale n’est pas qu’ils défendent leurs intérêts. Le scandale est que l’Europe ne sache plus défendre les siens.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées (Breizh-Info, 7 décembre 2025)