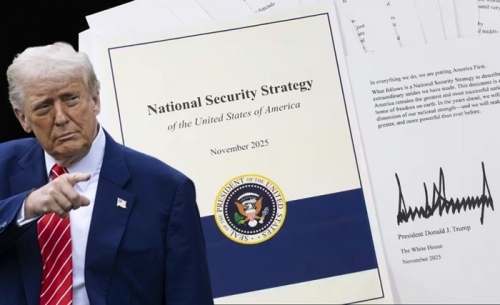Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Balbino Katz, le chroniqueur des vents et des marées, cueilli sur Breizh-Info et consacré aux menaces américaines sur le Groenland...

L’enjeu groenlandais et l’autonomie européenne
Je me tiens sur le quai du port du Guilvinec. Le jour est blafard, le vent coupe la joue et les coques quittent l’abri avec cette résolution taciturne qui fait les marins bretons. Le froid, ce matin-là, a quelque chose d’orientant. Il pousse l’esprit vers le nord, vers cette île immense et presque vide qui revient dans les conversations des chancelleries, le Groenland. Les mains dans les poches, je pense à cette possession danoise lointaine, entrée dans l’orbite de Copenhague au début du XVIIIᵉ siècle, en 1721, quand le royaume scandinave entreprit d’y rétablir une présence durable. Longtemps marginale, cette terre arctique est aujourd’hui scrutée avec une intensité nouvelle par les États-Unis.
Nouvelle dans sa forme, ancienne dans son fond. L’intérêt américain pour le Groenland n’est ni improvisé ni capricieux. Il traverse les décennies, des tentatives d’achat du XIXᵉ siècle aux accords de défense conclus pendant la Seconde Guerre mondiale, puis à l’installation de la base de Thulé, devenue aujourd’hui Pituffik, clef de voûte du dispositif antimissile nord-américain. Ce qui frappe désormais, c’est la verbalité assumée, la publicité donnée à cet intérêt par un président des États-Unis qui parle d’annexion, de nécessité stratégique, et le fait sans détour. La parole précède parfois l’acte, parfois elle le prépare.
Il suffit d’avoir la mémoire un peu longue pour se souvenir que Washington ne découvre pas aujourd’hui le goût des possessions ultramarines européennes. En 1898, profitant d’un prétexte fragile et d’une insurrection cubaine qu’ils soutenaient en sous-main, les États-Unis entrèrent en guerre contre l’Espagne. L’issue fut rapide. Cuba passa sous tutelle, Porto Rico fut annexé, les Philippines arrachées à Madrid. L’Europe observa, choquée sans doute, mais déjà résignée. L’Espagne, elle, encaissa le coup et produisit, dans la douleur, cette « génération de 98 » qui sut transformer la défaite en examen de conscience national.
L’histoire enseigne aussi l’art de l’oubli. Une fois le choc passé, le monde s’adapte. La puissance américaine est telle qu’on ne peut faire comme si elle n’existait pas, ni demeurer éternellement dans le ressentiment. En 1898, nombre de capitales européennes, Londres comprise, se félicitaient en silence de voir une puissance sœur, anglo-saxonne, prendre le relais d’un empire latin à bout de souffle. L’illusion d’une anglosphère harmonieuse faisait alors florès. Aujourd’hui, le décor a changé. Une prise de contrôle du Groenland sans l’accord de Copenhague poserait une question d’une autre nature, car elle viserait un allié, membre de l’OTAN, et mettrait à nu les lignes de fracture du continent.
Les scénarios circulent à voix basse. Action militaire rapide, pression politique locale, instrumentalisation du désir d’indépendance groenlandais, rien n’est exclu dans les hypothèses des diplomates. L’Europe, dans tous les cas, encaisserait un choc comparable à celui de l’Espagne finissante. Un choc peut-être salutaire. Le Groenland, à dire vrai, reste périphérique aux intérêts centraux européens, comme Saint-Pierre-et-Miquelon l’est pour la France. Sa perte ne bouleverserait pas l’équilibre géostratégique du Vieux Continent. En revanche, l’onde psychologique serait considérable. Elle poserait frontalement la question de l’alliance atlantique et de sa pertinence hors du cadre qui l’a justifiée, celui de la menace soviétique.
Ce moment pourrait donc être décisif. Non par la perte d’un territoire, fût-il immense, glacé et chargé de symboles, mais par la révélation brutale d’un malentendu ancien. L’Europe vit encore sur l’idée que l’alliance atlantique est un destin, alors qu’elle n’a jamais été qu’une conjoncture. La disparition de l’Union soviétique aurait dû entraîner sa dissolution naturelle ou, à tout le moins, sa transformation profonde. Rien de tel ne s’est produit. Par inertie, par confort, par peur aussi, les Européens ont prolongé un lien dont les termes se sont inversés. Le Groenland agit ici comme un révélateur chimique, faisant apparaître à la surface ce qui, jusque-là, restait dissous dans le langage diplomatique.
Cette fenêtre d’opportunité est étroite, et peut-être unique. Elle tient à la conjonction de plusieurs facteurs rarement réunis. Les États-Unis regardent désormais vers le Pacifique, vers la Chine, et considèrent l’Europe moins comme une alliée que comme un théâtre secondaire, utile tant qu’il ne contrarie pas leurs priorités. L’Europe, elle, dispose encore d’une puissance économique, technologique et démographique suffisante pour s’ériger en pôle autonome, à condition de le vouloir. Or la volonté politique naît rarement dans le confort. Elle surgit presque toujours d’un choc.
Sur ce point, les analyses de Mary Kaldor, pourtant éloignées de toute tentation continentale, méritent d’être relues. Dès les années 1990, elle soulignait que la communauté d’intérêts entre l’Amérique et l’Europe n’était ni naturelle ni éternelle, et que la divergence stratégique finirait par produire une rupture, non par hostilité idéologique, mais par simple logique de puissance. L’Amérique, écrivait-elle en substance, ne peut accepter durablement un partenaire qui aspire à l’autonomie dès lors que cette autonomie contrarie ses propres impératifs de sécurité globale.
Les penseurs français n’ont pas dit autre chose, chacun à leur manière. Raymond Aron, lucide jusqu’à la sécheresse, rappelait que les alliances ne survivent pas à la disparition de la menace qui les a fondées. Pierre Hassner insistait sur la fragilité des solidarités occidentales dès lors qu’elles ne reposent plus sur un péril commun clairement identifié. Plus récemment, Marcel Gauchet a montré combien l’Europe s’était enfermée dans une posture post-historique, croyant pouvoir substituer le droit, les normes et les procédures à la décision politique, oubliant que celles-ci ne valent que si elles sont adossées à une force capable de les défendre.
L’éventuelle prise de contrôle du Groenland par les États-Unis serait alors moins un drame territorial qu’un événement fondateur. Un rappel brutal que la souveraineté ne se délègue pas indéfiniment, que la protection a toujours un prix, et que l’Histoire ne s’arrête jamais, même sous la banquise. L’Europe serait placée devant une alternative simple, presque brutale, continuer à vivre dans l’ombre stratégique d’une puissance extra-européenne, ou accepter le risque, donc la responsabilité, de son indépendance.
Sur le quai du Guilvinec, le froid finit par engourdir les doigts. Les marins, eux, savent qu’il faut parfois sortir malgré la mer mauvaise, faute de quoi on meurt à quai. Le Groenland pourrait être cette mer mauvaise. Une épreuve rude, inconfortable, mais peut-être nécessaire pour qu’un continent cesse enfin de confondre sécurité et dépendance, et retrouve le goût âpre de la décision.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées (Breizh-Info, 8 janvier 2026)