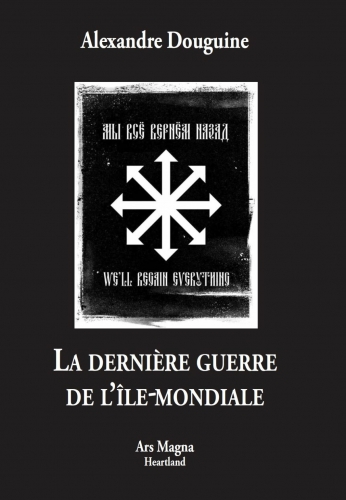Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Henrik Werenskiold , cueilli sur le site de la revue Conflits et consacré aux projets envisagés aux États-Unis d'installation sur la planète Mars...
Henrik Werenskiold est le fondateur et le rédacteur en chef du site norvégien Geopolitika.

Colonie stratégique sur Mars : les États-Unis visent-ils une « domination astropolitique »
Dans le légendaire jeu de stratégie de Sid Meier, Civilization, le premier joueur à atteindre la Lune remporte la bataille entre les civilisations. C’est une idée intéressante, mais elle manque peut-être sa cible. Il existe en effet une planète encore plus importante : Mars, la planète rouge, dont la colonisation pourrait constituer l’ultime outil « astrostratégique » pour toute civilisation terrestre.
Elon Musk, l’homme le plus riche du monde et magnat de la tech, possède une technologie clé aux conséquences potentiellement énormes pour la stratégie globale des États-Unis. Il est la seule personne au monde capable, de manière crédible, de mener à bien la colonisation de Mars dans un avenir proche, ce qui, en cas de succès, pourrait avoir d’importantes répercussions géopolitiques sur Terre.
Bien que de nombreux obstacles peuvent encore survenir, Musk affirme désormais qu’il vise à envoyer la première flotte de vaisseaux Starship non habités de SpaceX, chargés d’équipements et de fournitures essentielles, vers la planète rouge lors de la prochaine fenêtre de lancement dans un peu plus de deux ans. Si tout se déroule comme prévu, SpaceX envisage d’envoyer la première expédition habitée vers Mars lors de la fenêtre suivante, dans un peu plus de quatre ans.
Une question de temps
Ces astronautes posséderont une expertise essentielle dans des domaines clés pour établir une colonie viable sur Mars, notamment en ingénierie aérospatiale, environnementale et robotique, ainsi qu’en astrobiologie, médecine, psychologie, agronomie, géologie, sans oublier l’expertise en intelligence artificielle et en protection contre les radiations.
Ces individus feront de la planète rouge leur domicile permanent et faciliteront l’arrivée de nouveaux colons. Par la suite, d’importantes fournitures seront envoyées vers Mars à chaque fenêtre de lancement, tous les deux ans, probablement en quantités croissantes. La première colonie martienne américaine permanente et autosuffisante ne semble donc être qu’une question de temps.
Le premier à arriver gagne la véritable partie de Civilization
À l’heure actuelle, il semble que toutes les autres entreprises de fusées et d’exploration spatiale – qu’elles soient privées ou étatiques – restent loin derrière la technologie de SpaceX en ce qui concerne la capacité réelle de coloniser Mars. Cela donne donc aux États-Unis une avance considérable pour construire une base opérationnelle sur Mars, apparemment bien avant que d’autres puissances puissent suivre leurs traces.
Si les États-Unis et SpaceX parviennent à établir une base plus ou moins autosuffisante sur Mars, ils pourraient en principe créer un avantage « astrostratégique » permanent, impossible à reproduire par les rivaux terrestres du pays, en particulier la Chine. Les Américains pourraient en effet équiper leurs vaisseaux spatiaux en orbite autour de Mars de divers armements, ce qui pourrait, en théorie, empêcher tout rival d’établir une base concurrente sur la planète rouge.
Il existe un traité de 1967 – le Traité sur l’espace ou Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique – qui interdit à tout pays de revendiquer la Lune ou d’autres corps célestes comme son territoire, y compris Mars. Mais avec l’évolution de la politique mondiale au cours des dernières décennies, où les grandes puissances s’opposent de plus en plus vivement et où plusieurs traités importants ont été rompus, il n’est pas impensable que les États-Unis se retirent du Traité de l’espace extra-atmosphérique et revendiquent Mars – soit comme leur propre territoire, soit réservé aux nations alliées – dès qu’ils auront établi une base permanente et autosuffisante suffisamment grande.
Avantages géopolitiques
Étant donné la rapidité du progrès technologique, ce n’est plus de la science-fiction. Ce n’est qu’une question de temps avant que les États-Unis n’envoient leurs premiers vaisseaux spatiaux vers Mars et ne commencent leur colonisation.
Posséder une base permanente et autosuffisante sur Mars offre des avantages géopolitiques évidents sur Terre. En poussant le raisonnement, une guerre nucléaire internationale et le concept de DMA (destruction mutuelle assurée) s’appliqueraient autrement aux Américains. Cela se situe bien sûr plus loin dans le futur, mais ce n’est plus un scénario totalement irréaliste.
Astre brillant
Lorsque Mars et la Terre sont les plus proches l’une de l’autre, cela s’appelle une opposition. Cela se produit lorsque Mars, la Terre et le Soleil sont alignés, avec la Terre au milieu. C’est à ce moment que Mars est la plus proche de la Terre et apparaît donc plus lumineuse et plus grande dans le ciel nocturne. La prochaine opposition entre Mars et la Terre aura lieu le 25 janvier 2025, et la planète rouge continue de se rapprocher de la planète bleue à une vitesse record.
Il est donc temps de lever les yeux vers les étoiles, maintenant que l’hiver et la saison sombre s’installent. Un objet brille de plus en plus fort et occupe une position dominante parmi les corps célestes du ciel étoilé : la planète rouge. Nous pourrions en effet être les derniers humains de l’histoire à voir Mars « de près » sans une activité humaine significative à sa surface.
La course vers Mars a commencé, et les Américains semblent avoir un avantage de pionniers sans précédent dans la colonisation de la planète rouge, ce qui leur conférera une avance irremplaçable s’ils le souhaitent.
Henrik Werenskiold (Conflits, 7 novembre 2024)