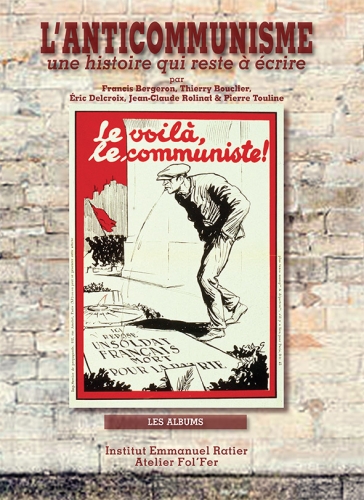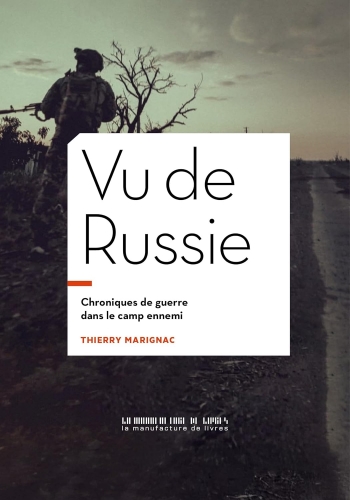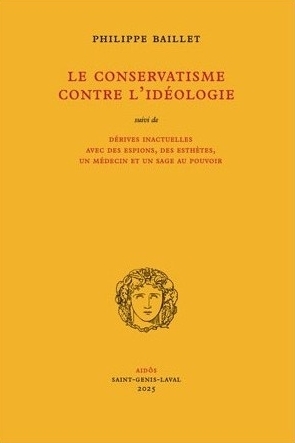Refonder la santé : pour une révolution sanitaire enracinée et souveraine
Notre système de santé est à bout de souffle. Ce n’est pas une crise : c’est une fin de cycle. L’hôpital public est devenu une usine à malades où les soignants s’effondrent et les patients errent. Les déserts médicaux s’étendent comme un cancer, jusqu’au cœur des métropoles. Les médecins libéraux désertent les gardes. Les infirmiers fuient l’hôpital. Les services d’urgence ferment. Et pendant ce temps, l’État bricole, empile les « Ségur », verse des primes et remplit des tableaux Excel.
Mais on ne répare pas un arbre pourri à la racine avec du sparadrap. Il faut une refondation. Une révolution douce, enracinée, réaliste. Une contre-utopie organisée autour de quelques principes simples : souveraineté, proximité, responsabilité.
Un système régionalisé, enraciné dans la terre des vivants
La première erreur historique fut de vouloir centraliser la santé. Un fonctionnaire à Paris n’a aucune idée de la situation à Guingamp, à Lannemezan ou dans les Hautes-Alpes. Il est temps de confier la santé… à ceux qui vivent là.
Chaque région doit avoir son propre service de santé, sous forme d’une agence sanitaire autonome, dotée de son budget, de son plan d’équipement, de ses hôpitaux et de son réseau de soins. Cette régionalisation permettra d’adapter les politiques sanitaires aux réalités locales : en Bretagne, la priorité sera aux urgences rurales et au maintien des maternités. En Alsace, peut-être à la gériatrie. Chaque peuple de France doit reprendre la main sur sa santé.
Mieux encore : pour les régions qui le souhaitent, un maillage européen à petite échelle peut être envisagé. Il ne s’agit pas de livrer notre santé à Bruxelles, mais d’organiser des coopérations transfrontalières en matière de soins rares, de transferts de patients, de formation ou de recherche. Une Europe enracinée, fondée sur les territoires et les peuples, pas sur les directives.
Une promesse fondamentale : soigner chaque Français à moins de 30 minutes de chez lui
C’est un engagement que l’on pourrait inscrire dans la Constitution. Un hôpital, une maison de santé, une structure de soins à moins de trente minutes de chaque Français, quel que soit son lieu de résidence.
Cela suppose de rouvrir des structures, pas de les fermer. De réorganiser les urgences, pas de les mutualiser à 200 kilomètres. De créer un maillage d’unités mobiles de soins, de relocaliser les plateaux techniques, et surtout, de sortir de la logique purement comptable imposée par l’ARS et Bercy.
Nous devons investir dans des soignants bien payés, bien formés et respectés, pas dans des consultants en management ou des applications inutiles. Le financement peut être assumé par les régions, à condition que l’on mette fin au gaspillage, à la bureaucratie et à la surfacturation provoquée par une complexité folle.
Le Service sanitaire national : deux ans de don pour tous
La France n’a plus d’armée du peuple. Elle n’a plus de service national. Elle n’a plus de lien social. Recréons-le par un Service sanitaire national obligatoire pour tous entre 18 et 40 ans. Chaque Français, homme ou femme, devrait consacrer au moins deux années de sa vie à servir : comme pompier volontaire, secouriste, aide-soignant, brancardier, auxiliaire de soins, logisticien de crise, etc.
Ce service sanitaire permettrait de former une réserve active de plusieurs millions de citoyens capables d’intervenir en cas de catastrophe, d’épidémie, de guerre ou de crise majeure. Cela ouvrira des débouchés professionnels, moyennant équivalence, à tous. Ce serait aussi un creuset de fraternité réelle, de discipline librement consentie, et une expérience utile pour les jeunes qui veulent s’orienter vers les métiers du soin.
À ceux qui hurleront à la militarisation ou à l’embrigadement, répondons qu’il s’agit d’un retour au réel. Le soin est un acte politique et communautaire. On ne soigne pas une société liquide avec des pixels. On la soigne avec des hommes et des femmes debout, formés, prêts à servir.
Une exigence non négociable : un système fermé, souverain, protégé
Il n’existe aucun système de santé viable dans une société ouverte à tous les vents. Une médecine gratuite, universelle, solidaire n’est possible que dans un cadre limité, fermé, défini.
La France ne peut pas soigner indéfiniment la planète entière. Il est temps d’imposer un principe clair : les soins gratuits sont réservés aux citoyens français et aux étrangers ayant contribué durablement au financement du système. Pour les autres, c’est le pays d’origine qui doit payer. Ou bien c’est le patient.
L’immigration n’est pas un droit à la santé gratuite. C’est une charge, souvent lourde, pour les hôpitaux, les urgences, les maternités. Dans un monde rationné, la priorité doit aller aux nôtres.
Soigner, c’est bâtir une civilisation
La médecine moderne s’est coupée de ses racines spirituelles, culturelles, éthiques. Elle est devenue une technique froide, parfois inhumaine. Refonder notre système de santé, ce n’est pas seulement gérer une crise ou améliorer des ratios. C’est rebâtir une civilisation autour de la vie, du soin, du sacrifice et du bien commun.
Nous n’avons plus besoin de ministères pléthoriques, de commissions inutiles ou de colloques creux. Ni d’administrations vampires qui engloutissent le budget de l’hôpital. Nous avons besoin de médecins enracinés épaulés par des robots et par l’IA, de paysans bien portants, de jeunes qui s’engagent, d’infirmières et de sages-femmes respectées, de structures agiles, de territoires fiers.
Et surtout, d’une Civilisation qui préfère soigner les siens que sauver le monde entier sur ses propres cendres. C’est possible. Il suffit d’oser.
Julien Dir (Breizh-Info, 27 mai 2025)