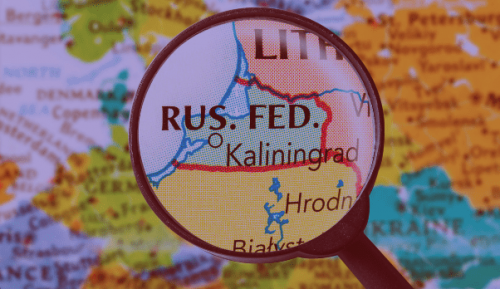Ainsi, en se concentrant tous ses efforts sur Kiev, Moscou laisse le champ libre à d’autres initiatives, toutes aussi hasardeuses, dont celle du Hamas, le 7 octobre 2023, ayant entraîné les massacres qu’on sait. Dès lors, l’enchaînement est inéluctable et la réponse de l’État hébreu aussi prévisible qu’impitoyable : Tel-Aviv peut alors se déchaîner sur le Hezbollah libanais tout en commençant, déjà, à menacer l’Iran. Principe d’opportunité oblige, ce qui demeure de Daech en Syrie en profite pour mettre à bas le régime de Bachar el-Assad. Là, ce n’est pas en deux semaines, mais seulement en quelques jours. En effet, le Hezbollah n’est plus en mesure de lui venir en aide ; pas plus que le Kremlin, bien trop occupé en Ukraine.
Résultat ? L’arc chiite qui allait de Téhéran à Beyrouth en passant par Damas n’est plus ; privant ainsi la République islamique d’Iran de toute profondeur stratégique. Pour tout arranger, Donald Trump négocie en direct avec les Houthis yéménites, l’ultime allié de l’ayatollah Khamenei. Ce principe d’opportunité, qui a profité aux Syriens de Daech, Israël le fait sien à son tour, en attaquant l’Iran à un moment d’autant plus idoine que le revenant de la Maison-Blanche n’a, malgré ses dénégations, rien à refuser à Benyamin Netanyahou.
Trump et Netanyahou : qui donne les ordres, qui les reçoit ?
La preuve en sont ces révélations d’Adrien Jaulmes, correspondant du Figaro à Washington, ce 14 juin : « Les négociations entre les États-Unis et l’Iran, rouvertes par Trump à la surprise générale en avril dernier, avaient d’abord semblé déjouer les plans de Netanyahou, depuis longtemps favorable à une action militaire contre le programme nucléaire iranien. » Mais, toujours selon la même source : « Donald Trump et ses conseillers auraient fait semblant de s’opposer publiquement à des frappes israéliennes. L’objectif était de convaincre l’Iran qu’aucune attaque n’était imminente et de s’assurer que les militaires et les scientifiques iraniens figurant sur les liste des cibles d’Israël ne prendraient pas de précautions particulières. Pour parfaire la couverture, des collaborateurs de Netanyahou avaient même déclaré aux journalistes israéliens que Trump avait tenté de retarder une frappe israélienne, lors d’un appel téléphonique, le lundi 10 juin. » Citant l’International Crisis Group, think thank américain, Adrien Jaulmes note néanmoins : « Cela n’était pas conforme à la stratégie du président américain. Netanyahou a clairement forcé la main à Trump. » Bref, de l’attelage américano-israélien, on ne saura jamais vraiment qui tient la laisse ; qui est le maître et qui est le chien.
L’incontestable supériorité technologique d’Israël
D’un strict point de vue militaire, l’opération israélienne est un indéniable succès. Pourtant, il y a une dizaine d’années, un diplomate iranien assurait à l’auteur de ces lignes : « Avec les missiles S-300 fournis par les Russes, l’Iran est sanctuarisé. Si cent avions israéliens viennent nous attaquer, seule une vingtaine en réchapperont. » C’est en 2010. Un an avant, Gérard de Villiers, dans La Bataille des S-300, un SAS redoutablement bien documenté, écrit strictement la même chose. Seulement voilà, c’était il y a quinze ans et la technologie a fait des progrès depuis et, en la matière, l’écrasante supériorité israélienne est indubitable. Ainsi, les deux cents chasseurs partis bombarder l’ancienne Perse, ce vendredi 13 juin, sont tous rentrés intacts à leurs bases respectives. Certes, la riposte iranienne n’est pas mince, mais demeure strictement anecdotique, comparée aux dégâts causés par la partie adverse.
Par certains aspects, cette guerre n’est pas comparable aux autres conflits ayant ensanglanté le Proche et le Moyen-Orient, les deux belligérants n’ayant aucune frontière en commun. L’avantage revient donc plus à celui qui maîtrise au mieux les avancées scientifiques permettant de frapper de loin qu’à celui capable d’aligner le plus de soldats pour aller se battre de près. Pour tout arranger, ce qui demeure d’aviation à Téhéran relève du domaine du dérisoire. Dans celui de la guerre du futur, l’État hébreu a déjà marqué des points décisifs. L’opération des téléphones portables piégés, fomentée dix longues années durant par les maîtres espions du Mossad et ayant décapité nombre de cadres du Hezbollah, a durablement marqué les esprits. Celle ayant intoxiqué le gratin militaire de l’armée iranienne, pour le pousser à se rassembler en un lieu et à une date évidemment connue du Mossad, afin de mieux pouvoir les atomiser, ce même vendredi 13 juin, demeure une autre remarquable manipulation.
La « menace existentielle » d’Israël fondée sur une manipulation médiatique ?
Après, quels sont les motifs de cette guerre ? Israël excipe évidemment de sa « survie », faisant de la République islamique d’Iran une « menace existentielle », surtout quand au bord d’acquérir l’arme nucléaire. À l’époque des missiles S-300 plus haut cités, il ne s’agit pourtant pas d’une priorité pour l’ayatollah Khamenei, pas plus que le président d’alors, Mahmoud Ahmadinejad n’entend « rayer Israël de la carte », tel que soi-disant prétendu lors d’une conférence prononcée le 25 octobre 2005. À croire que tout cela puisse participer d’une autre manipulation, médiatique, celle-là ; ce que semblait croire Le Point, à l’époque et qui, pourtant, n’est pas connu pour être un hebdomadaire furieusement antisioniste.
Quand Tel-Aviv écoutait Téhéran…
Ainsi, le 26 avril 2012, peut-on lire, sous la signature du journaliste Armin Arefi : « Le vent est-il en train de tourner sur l’Iran ? Présentée comme inévitable il y a encore quelques semaines, le risque de frappes israéliennes – et même d’une guerre régionale – semble inexorablement s’éloigner. Le revirement date du jour qui a vu deux responsables israéliens en exercice – le ministre de la Défense Ehud Barak et le chef d’état-major Benny Gantz – annoncer publiquement que la République islamique n’a pas décidé de se doter de la bombe atomique. Une information en réalité connue depuis plusieurs années des divers services de renseignement américains, mais aussi israéliens. » Bigre. Cela qui signifie que si les accords irano-américains sur le nucléaire iranien avaient suivi leur cours, peut-être que cette République islamique n’essaierait pas, aujourd’hui, de véritablement se doter de l’arme fatale en question…
D’ailleurs, cela aurait-il été aussi grave pour la paix dans le monde ? Après tout, au siècle dernier, l’État hébreu s’est lui aussi équipé de l’arme nucléaire, en toute illégalité et ce dans le plus grand secret. Que l’Iran rétablisse ce déséquilibre n’aurait peut-être pas été non plus un péril pour la région. C’est en tout cas ce qu’estimait Jacques Chirac, le 29 janvier 2007, cité par Le Monde : « Je dirais que ce n’est pas spécialement dangereux. (…) Ça veut dire que si l’Iran poursuit son chemin et maîtrise totalement la technique électronucléaire, le danger n’est pas dans la bombe qu’il va avoir et qui ne lui servira à rien. Il va l’envoyer où, cette bombe ? Sur Israël ? Elle n’aura pas fait deux cents mères dans l’atmosphère que Téhéran sera rasé de la carte. »
Ce que Tel-Aviv n’avait pas à craindre, Le Point officialisant, le 26 avril 2012 toujours, ce qui s’écrivait dans des rédactions moins en vue : Mahmoud Ahmadinejad, par une erreur de traduction en anglais, dont on ne sait si elle fut ou non volontaire, a vu ses propos déformés. D’où la tardive mise au point de cet hebdomadaire : « Dans une interview à Al Jazeera, reprise par le New York Times, Dan Meridor, ministre israélien du Renseignement et de l’Énergie atomique, a admis que le président iranien n’avait jamais prononcer la phrase “Israël doit être rayé de la carte”. Il a tout de fois ajouté : “Mahmoud Ahmadinejad et l’ayatollah Khamenei ont répété à plusieurs reprises qu’Israël était une créature artificielle et qu’elle ne survivrait pas.” » Dans le registre de ces « créatures artificielles », le président iranien incluait par ailleurs l’URSS, dont il disait : « Qui pensait qu’un jour, nous pourrions être témoins de son effondrement ? » Et Le Point de rappeler : « Pourtant, c’est bien cette première citation erronée qui a été reprise en boucle par les médias du monde entier, attisant d’autant plus les soupçons autour du programme nucléaire iranien. »
L’actuelle rhétorique eschatologique de Benyamin Netanyahou ne reposerait donc que sur du vent, au même titre que les sempiternels appels à un « droit international » tout aussi fumeux que paradoxalement des plus solides, depuis le temps que tant de nations s’assoient régulièrement dessus. Et la suite des événements ? Quid d’une éventuelle solution politique ? Le Premier ministre israélien parait n’en avoir guère plus à Téhéran qu’à Gaza. Certes, il compte sur l’apathie des États sunnites voisins, finalement pas mécontents de voir leur concurrent chiite dans la tourmente. Malgré ses protestations, la Russie devrait se cantonner dans la posture verbale, même si la Chine pourrait éventuellement hausser le ton, étant dépendante en grande partie du pétrole importé d’Iran.
Renverser le régime iranien de l’intérieur : une chimère ?
Et puis, il y a ce rêve de moins en moins inavoué consistant à renverser, de l’intérieur, le régime des mollahs. Là, il y a peut-être loin de la coupe aux lèvres, tel que souligné par Delphine Minoui, journaliste franco-iranienne et spécialiste incontestée de son pays natal, dans Le Figaro de ce 16 juin : « La société est divisée en trois groupes. Le premier, minoritaire, applaudit les frappes israéliennes. Le deuxième reste fidèle au régime, pour des raisons idéologiques ou d’intérêt économique. Le troisième, majoritaire, ne soutient ni la République islamique ni les frappes israéliennes. Il se réjouit de la mort des commandants corrompus des gardiens de la révolution, mais rejette toute forme d’agression contre le territoire et toute tentative d’imposer un système politique venu de l’extérieur. » Voilà qui est bien court pour subvertir le régime de l’intérieur…
De son côté, notre confrère Régis Le Sommier, dans Le Journal du dimanche, n’écrit pas fondamentalement autre chose : « L’ère du carpet-bombing est révolue, mais Netanyahou y croit toujours, pour satisfaire une partie de son opinion publique. » Et surtout jouer la montre, histoire de repousser son inévitable comparution devant la commission d’enquête qui l’attend, négligeant qu’il a été devant le massacre commis par un Hamas ayant réussi à bousculer Tsahal, armée pourtant donnée pour toute puissante, le 7 octobre 2023.
Posséder l’hégémonie technologique sur le temps court est une chose. Avoir une vision politique sur le temps long en est une autre. Tôt ou tard, Benyamin Netanyahou pourrait l’apprendre, fut-ce à ses dépens.
Nicolas Gauthier (Site de la revue Éléments, 17 juin 2025)