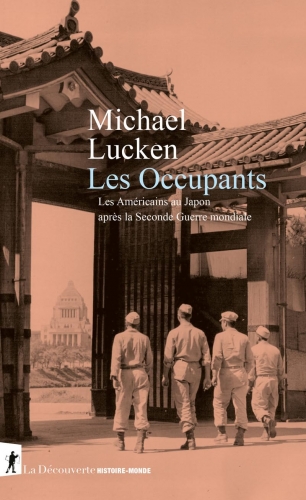Entre Moscou et Washington, l’illusion eurosibérienne
Se rendre au bar de l’Océan, au , un dimanche midi est une épreuve, non seulement car il est souvent bondé, mais parce qu’il est fort malaisé d’y accéder par la rue de la Marine, changée en marché et noire de monde où l’on avance au pas. Pour y parvenir, je choisis les quais, longeant les chalutiers à l’arrêt. Je savais qu’à cette heure mon amie Paule, cette dame sinisante d’esprit sagace, serait sans doute là. J’avais grand intérêt à l’entretenir de cette rencontre à Washington où le président Zelensky, escorté d’une cohorte d’Européens, allait implorer auprès de Donald Trump quelque esquisse de cessez-le-feu.
Discuter de la Russie avec mon amie est toujours profitable. Elle ne l’envisage pas comme un simple État, mais comme un empire de glaces, dont la capitale, Moscou, a trop longtemps été perçue comme une copie imparfaite de l’Occident, alors qu’elle puise ses rites et sa majesté jusque dans l’héritage de Pékin. Qui se souvient encore que le protocole de la cour impériale russe s’inspirait de celui des empereurs chinois, fruit lointain des chevauchées asiatiques qui avaient pénétré jusqu’au cœur de l’Europe orientale ?
En marchant, mes pensées s’envolèrent vers Bruxelles, dans ces années 1980 où j’avais rencontré Jean Thiriart. Il avait façonné une partie de l’imaginaire de la droite radicale par sa vision d’une Europe euro-sibérienne. Je m’étais laissé séduire par cette logique de projection continentale, qui promettait à l’Europe un destin impérial de Vladivostok à Dublin. Je me souviens encore du manifeste que j’avais rédigé sous le titre « Pour que la France et l’Allemagne rejoignent le pacte de Varsovie », texte que Guillaume Faye avait relu et encouragé. Placardé sur les murs de la péniche à Sciences Po, il avait désarçonné les communistes, qui nous haïssaient, autant qu’il intriguait la droite libérale, qui nous croyait des leurs. Ce fut un instant d’ambiguïté délicieux, presque schmittien, où l’ami et l’ennemi échangeaient leurs masques.
C’est dans ce climat intellectuel que j’avais adhéré à l’association France-URSS. Le premier article que je publiai dans leur revue éponyme fut une chronique anodine sur l’exposition d’un peintre russe à Paris, mais pour moi il signifiait un pas de plus : j’entrais dans l’âge adulte avec la conviction d’un destin euro-sibérien, nourri par Thiriart, par la mouvance de la Nouvelle Droite, et par une franche hostilité à tout ce qui portait l’empreinte américaine.
Je dois ici dire combien j’ai aussi subi l’influence de la revue Elements comme celle d’Alain de Benoist dont la phrase provocatrice qu’il avait lancée : « je préfère porter la casquette de l’Armée rouge plutôt que manger des hamburgers à Brooklyn » m’avait fortement marqué. Jean-Yves Le Gallou s’en est souvenu dans sa contribution au Liber amicorum Alain de Benoist – 2 : « Quel tollé ! On criait alors au scandale, au moment même où les chars soviétiques semblaient à une étape du Tour de France. Imprudence pour un journaliste de Valeurs actuelles, assurément pas le meilleur moyen de faire fortune, d’être décoré de la Légion d’honneur et d’entrer à l’Institut. Mais quelle lucidité, quand on mesure, quarante ans plus tard, les ravages de l’américanisation du monde ! L’empire, l’empire américain, l’empire marchand fut ensuite et reste encore au centre de ses critiques. Cette condamnation du « système à tuer les peuples », selon le titre d’un livre de Guillaume Faye paru aux éditions Copernic, garde aujourd’hui une pertinence absolue.»
Puis vint la fin du monde communiste. La désillusion fut rapide, brutale. Ce que nous avions rêvé comme un titan politique n’était qu’une société en ruine, minée de contradictions. Et l’arrivée, dans mon horizon, d’Alexandre Douguine m’obligea à mesurer l’abîme. Ses paroles révélaient que la Russie ne pensait pas comme nous, qu’elle ne voulait pas ce que nous voulions.
Thiriart, que j’avais tant admiré, restait un rationaliste. Son Eurosibérie était une construction géopolitique, laïque, matérialiste, où l’Europe et la Russie devaient fusionner pour rivaliser avec l’Amérique. Douguine, lui, parlait un autre langage. Là où Thiriart ne voyait qu’un équilibre des puissances, il voyait une mission quasi divine. Là où Thiriart rêvait d’un État continental centralisé et moderne, Douguine convoquait l’orthodoxie, la métaphysique et la mémoire impériale.
Les différences étaient béantes. Thiriart voulait dépasser les petits nationalismes pour bâtir un peuple continental, rationnel et uniforme. Douguine, lui, affirmait la singularité russe et son rôle messianique, au cœur d’un empire pluriel, bigarré, tourné vers l’Orient. Thiriart voyait l’ennemi principal dans l’atlantisme américain, tandis que Douguine désignait la modernité occidentale tout entière comme l’adversaire à abattre. L’un était stratège, l’autre prophète. L’un citait Schmitt, l’autre Evola.
Alors j’ai compris que ces deux visions ne se rejoindraient jamais. L’Eurosibérie de Thiriart ne trouverait pas son ciment en Russie, et l’eurasisme de Douguine n’admettrait jamais l’Europe comme partenaire, mais seulement comme province sous tutelle. C’est là que s’est brisée pour moi l’illusion eurosibérienne. Douguine, en s’imposant comme la voix d’une Russie redevenue impériale, a mis fin à ce rêve pour toute une génération européenne. Il a révélé, par sa vigueur même, que notre projet n’était qu’une chimère née sur le papier.
J’avais cru que nos deux demi-continents pouvaient s’unir dans un même élan. J’ai découvert que les Européens, concentré de faiblesses intellectuelles et morales, sont incapables de ce grand dessein, et que les Russes, enfermés dans leur univers mystique et tragique, ne songent qu’à eux-mêmes.
En dépassant le kiosque des balades en mer de Soizen, juste en face du bar, la conclusion m’était venue naturellement : nous, Européens d’extrême Occident, sommes coincés. Coincés entre un empire russe auquel nous ne sommes pas compatibles, et un voisin hyperpuissant, les États-Unis, qui représentent tout ce que nous ne sommes pas. Dans notre faiblesse intellectuelle, morale et militaire, nous n’avons d’autre recours que de tendre la main, tantôt vers l’un, tantôt vers l’autre, pour obtenir le droit de survivre.
J’ai compris ce jour-là que Douguine, par la vigueur de son verbe et la certitude de sa foi, avait clos un cycle. Il était le fossoyeur du rêve eurosibérien, celui qui révélait que la Russie n’avait jamais voulu partager notre destin mais seulement nous absorber. En l’écoutant, j’ai reconnu la fin d’un monde, le nôtre, et Spengler n’avait pas tort : l’Europe chancelle, elle se recroqueville comme un vieil arbre dont les racines pourrissent sous terre.
Et pourtant, tout n’est pas perdu. Notre péninsule, aussi malade qu’elle paraisse, n’est pas encore tout à fait morte. Elle ressemble à ce corps fiévreux que la médecine croit condamné mais qui attend, peut-être, l’électrochoc qui réveillera son pouls. Le souffle peut revenir, si la volonté renaît.
Balbino Katz, chroniqueur des vents et des marées (Breizh-Info, 19 août 2025)