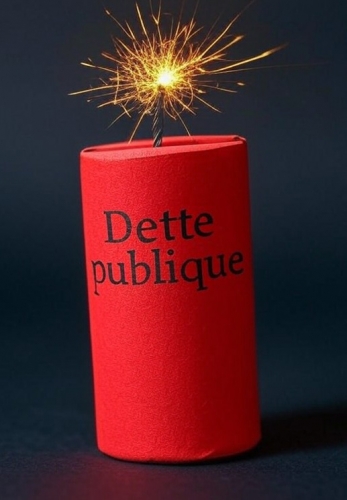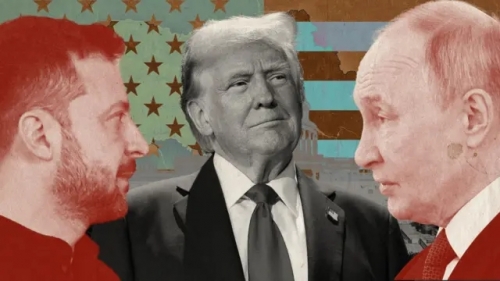La dette française, risque géopolitique
J’ai évoqué précédemment la question de l’endettement public, notamment de la France. Sujet maintenant bien familier à tous. Voyons comment cela s’inscrit dans le jeu des relations géopolitiques.
Des dettes de nature profondément nouvelle
Rappelons d’abord qu’il y a eu une expansion générale de la dette des pays développés depuis 40 ans, même si les situations varient selon les cas. Mais presque partout il ne s’agissait pas principalement de financer des investissements, mais des dépenses courantes. C’est le signe d’une incapacité à faire des choix collectifs rationnels. Ce qui n’est jamais de bonne augure en termes de puissance.
Sous cet angle, le facteur majeur est le fait que la plupart de ces pays se financent pour l’essentiel sur les marchés financiers, qui sont volatils et capables de se retourner rapidement. Trop recourir à leurs services comporte donc un risque réel. Cela dit, dans un premier temps c’est l’inverse qui se produit. En effet il est bien plus facile d’y avoir recours qu’à tout autre source, et beaucoup moins cher. En outre, ils se révèlent d’une grande patience, et même d’une certaine cécité pendant de longues périodes. De ce fait, ils n’envoient pas les signaux avertisseurs en temps utile. Mais quand finalement ils perçoivent qu’il y a un problème, ils se retournent, et c’est la crise. On l’a vu avec la Grèce.
Des situations très variables
Toujours en termes de pouvoir, la question est très différente selon la monnaie et les créanciers. Les pays endettés dans une autre monnaie que la leur, principalement les pays en développement, ont connu régulièrement des crises de la dette depuis plus de 40 ans. Et cela s’est traduit par des restructurations humiliantes et coûteuses. Pour une souveraineté, c’est une rude épreuve. A l’inverse, on a les pays endettés dans leur propre monnaie. On passera sur les détails, mais comme ils contrôlent leur monnaie, qui sont désormais de pure convention, ils ne peuvent en principe pas avoir de vraie crise des paiements, puisqu’ils pourront toujours faire des dollars, yens, livre ou autres pour payer. Quitte à subir une hyper inflation et une crise des changes : ce serait évidemment un événement majeur, mais cela leur laisserait un contrôle relatif de leurs décisions.
Et il y a enfin un cas très particulier, celui des pays de l’Union européenne. Ils ne sont pas endettés à proprement parler dans leur monnaie nationale, car l’euro est commun et géré par la BCE. Or les décisions de celle-ci résultent d’un équilibre entre des positions diverses ; les politiques internes de ces pays sont très différentes et leur niveau d’endettement très variable ; leurs intérêts divergent donc.
A proprement parler, on ne sait donc pas déterminer à l’avance comment une crise significative se règlera en zone euro. De plus, en principe, la BCE ne finance pas les Etats ; même si en pratique elle l’a fait indirectement, par achats sur le marché secondaire, mais avec des limites. C’est donc une situation sans équivalent.
Le cas de la France
Dans ce contexte, la dette de la France est un cas particulier. Sa dette croît sans cesse, en valeur absolue et relative, du fait de déficits constamment supérieurs à la croissance du PNB. Cela fait des années que de nombreuses voix autorisées avertissent du risque croissant que cela représente. Mais sans écho réel, ni des politiques, ni sur les marchés. Ce n’est que tout récemment qu’on commence, et encore, ce n’est pas à la mesure du problème.
Parmi les causes, deux principales. D’un côté, une incapacité toute particulière à mettre de l’ordre dans ses affaires et à se réformer, qui ne date pas d’hier. D’un autre côté, d’une situation favorable sur les marchés, car la France a longtemps été perçue comme un brillant second de l’Allemagne. Or dans le système financier mondial des sommes colossales doivent être placées, et dans une proportion appréciable sans risque ; les professionnels ont donc besoin d’une dette publique jugée telle. Mais l’Allemagne n’emprunte pas assez et sa périphérie non plus. Restait donc la France, qui en a bien profité et abusé.
Cela dit, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, et on ne peut continuer à emprunter indéfiniment, de façon de plus en plus élevée. Cela casse forcément un jour, même si on ne peut le prévoir avec précision. Un enfant de 10 ans peut le comprendre. Et quand, en plus, on se révèle politiquement ingouvernable, on tente le diable. Surtout si on est en Europe la seule à continuer dans ce sens.
Que peut-il se passer maintenant ?
On se placera ici dans l’hypothèse où la situation politique ne permet pas de redressement véritable à court terme. Dans ce cas, la crise est inévitable même si à nouveau on ne sait pas quand, surtout si comme la France on part d’une image favorable. Bien entendu, une rupture éventuelle serait précédée d’une période plus ou moins longue de dégradation, déjà entamée, notamment avec hausse du spread (différentiel par rapport à la dette allemande), puis difficulté à lever les capitaux voulus.
Dans une hypothèse concevable mais optimiste, cette dégradation conduirait à une forme de sursaut, permettant une stabilisation relative, quoiqu’à un très haut niveau de dette, comme en Italie ou en Belgique. Cela resterait une situation risquée, mais peut-être tenable sur une certaine durée, quoique très coûteux ; cela impliquerait aussi qu’on resterait sous la surveillance des marchés. Mais même cela supposerait l’arrêt des déficits, du moins l’apparition d’un excédent primaire du budget, avant service de la dette. Concevable, cette évolution est à ce stade peu probable, au vu de la situation politique française. Et si cela se faisait en accroissant encore la fiscalité française, cela signerait l’étouffement du pays. Déjà d’ailleurs le poids des intérêts sera un handicap considérable.
Reste alors le risque majeur, celui de la crise. On l’a dit, la difficulté des marchés est qu’on ne peut prévoir avec assurance le moment et les modalités d’une crise. Cela dépend de leur tendance du moment, des histoires qui y circulent (‘stories’), du reste de la situation mondiale etc. Ce n’est donc pas nécessairement à court terme ; cela peut prendre un temps sensiblement plus long. Mais sauf redressement vigoureux, à un moment donné il devient impossible de financer les sommes demandées.
Il va de soi que la crise en question serait majeure et dépasserait largement le cadre de la France. On l’a vu, elle ne contrôle pas sa monnaie, qui est cogérée. En même temps, on ne voit pas comment traiter la question sans un volet monétaire. Il y aura donc ici une question difficile pour ses partenaires dans la BCE, les Allemands en premier lieu. Leur ligne politique exclut en théorie ce genre d’intervention massive, surtout au profit d’un seul pays, et alors même qu’ils se considèrent, non sans motif de leur point de vue, comme bien mieux gérés et plus ‘vertueux’. En outre, leurs électeurs sont terrifiés par le spectre, qui est loin d’être irréaliste, d’une forte reprise d’inflation. De plus, les stocks de dettes sont très différents de pays à pays, et donc monétiser la dette n’aurait pas du tout le même impact partout.
Mais restera l’ampleur de la déflagration. Une action au profit de la France, au vu de son poids en Europe, serait par nature une opération énorme, sans précédent. Outre ce que pourrait faire la BCE, il faudrait jouer sur toute une panoplie : des restructurations de dette, l’action du FMI, peut-être d’autres mécanismes à inventer, etc. A cela s’ajouterait surtout ce qu’on appelle une conditionnalité : une politique de rigueur et d’économies, qui dans ces cas est presque nécessairement grossière et brutale – avec pas mal de casse, non seulement sociale, évidemment, mais aussi par ses effets sur le tissu productif. Compte tenu de ce que l’on sait de la situation sociopolitique française, cela risque de ne pas être évident du tout et pourrait déraper gravement. Et d’ailleurs, quel gouvernement assumerait cela ?
Perspectives
D’un point de vue géopolitique, une question majeure sera celle de la suite, des effets ultérieur d’une telle dérive puis crise.
En France d’abord. On a ici un banc d’essai intéressant, celui des pays d’Amérique latine après la crise des années 80. Au Brésil ou au Mexique, on a eu une stabilisation relative, même si on peut en discuter la pertinence. Mais pas en Argentine. Car la culture politique, marquée par le péronisme, n’a pas véritablement changé (du moins jusqu’à l’expérience Milei, en cours). Et le pays a connu crise sur crise, sur très longue durée. Dans quelle rubrique la France se situerait-elle ? On craint que ce ne soit pas dans la meilleure case.
En Europe ensuite. Pourquoi la France est-elle un cas, en outre symptomatique ? Il y a bien sûr les causes internes qu’on a citées, qui ont joué un rôle majeur. Mais il y a aussi un lien avec son rêve européen, plus précisément avec la manière particulière dont la classe politique française a vu l’Europe : elle a gardé en un certain sens des ambitions internationales, bien plus que la plupart des autres pays européens, mais elles les a transférées sur l’Europe. Elle n’a donc pas eu les réflexes d’un pays indépendant, qui sait ne pouvoir compter que sur lui-même, et qui d’ailleurs est averti plus tôt de ses errements éventuels (par des crises de change, par une difficulté à emprunter etc.). Elle a au contraire bénéficié d’une monnaie plus forte que ce dont elle est capable, et comme on l’a dit, d’un positionnement avantageux mais artificiel sur les marchés. Et, bien trop introvertie politiquement, elle n’a pas eu non plus le sens de ses responsabilités au sein de cette Europe.
Or une crise du type de celle qu’on peut craindre remettrait radicalement en cause ce positionnement. Le brillant second deviendrait l’homme malade, pesant sur tous ; ce qui reste éventuellement de couple franco-allemand serait définitivement enterré ; les ambitions de puissance, s’il en reste, prendraient un coup très rude. On n’est donc pas dans le cas d’une Grèce qui serait simplement démultipliée par la taille. En supposant même que cela n’aboutirait pas à une dislocation des institutions européennes, cela impliquerait un redimensionnement majeur des relations en Europe. Au risque, bien sûr, de voir celle-ci s’affaisser encore un peu plus dans la vulnérabilité, l’absence d’ambition et la vassalité à l’égard de Washington.
Pierre de Lauzun (Geopragma, 23 décembre 2024)