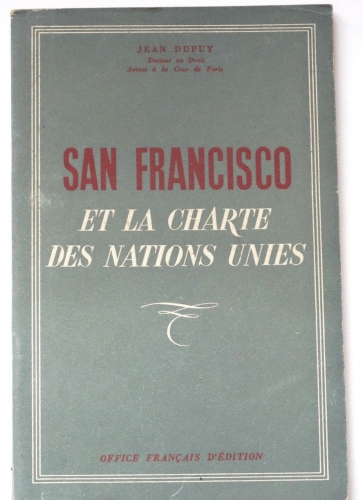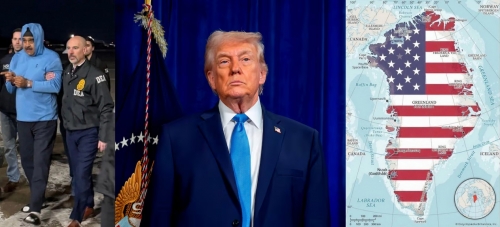Trump : le grand piège de la droite française
Qui défend Donald Trump aujourd’hui se place de lui-même dans le camp de l’ennemi. Nous sommes la France, nos alliés face au monde sont l’Europe – pas l’UE, l’Europe – et qui nous nuit est notre ennemi. Un an après sa prise de pouvoir, il devient pratiquement impossible pour une personne sensée de contester la dureté des attaques menées par les États-Unis d’Amérique envers notre continent, que ce soit sur le plan diplomatique, économique, stratégique, écologique ou symbolique. Menace d’invasion militaire du Groenland, moqueries constantes, mise à l’écart dans le conflit russo-ukrainien, extractivisme, droits de douane et menaces : on ne compte plus les exemples de manifestations de mépris de Donald Trump à notre égard. Or, une partie de la droite l’applaudit toujours sans réserve.
L’attaque du Venezuela a créé chez la droite française un nouveau sursaut trumpiste. Un dictateur communiste de moins dans ce bas monde, que demander de mieux ? Enlevé au terme d’une opération presque sans bavures – « seulement » 83 morts a priori –, le kidnapping a réjoui autant les admirateurs de la force brute que les anticommunistes. Pourtant, si la fin de Maduro est un fait positif en soi, trois problèmes majeurs en découlent.
Le premier, qui touchera directement les Vénézuéliens, c’est celui de la succession. Pour le moment, il apparaît que le pays n’a pas prévu de nouvelles élections à court terme et que Delcy Rodriguez, la vice-présidente de l’ancien dictateur, veuille en profiter pour conserver le pouvoir. Sans doute sera-t-elle sensiblement plus prudente que son prédécesseur, mais rien ne garantit pour le moment une ouverture démocratique. De même, bien que Maduro ait été largement haï à juste titre par une large part de la population, il est envisageable que la cupidité américaine puisse créer un effet de repli anti-occidental, ce qui nous emmène au deuxième point.
Ensuite, il y a donc l’interventionnisme pétrolier des États-Unis. Pour rappel, le Venezuela détiendrait les plus grandes réserves d’or noir au monde. Leur exploitation, dans un premier temps, favoriserait sans doute le peuple qui subit la grande faiblesse des infrastructures actuellement en place. Pourtant, nul doute connaissant Donald Trump que son intérêt premier reste l’extraction de cette ressource pour servir son pays : en permettant aux grandes multinationales américaines de mettre la main sur le pétrole vénézuélien, il renforce indéniablement sa puissance commerciale et sa capacité à jouer sur les cours au niveau mondial, accroissant par conséquent la dépendance de l’Europe à son voisin d’outre-Atlantique. Sur ce dernier point, il faudra un jour écrire un article sur le devenir mafieux de l’Amérique.
Le dernier problème soulevé par cette intervention militaire est celui de la légitimité des États-Unis à mener des opérations militaires extérieures sans le consentement d’aucune autre personne que du « POTUS » – les membres du Congrès n’ont été informés des détails de l’attaque vénézuélienne qu’une semaine après son déroulement. Il incombe donc à un seul homme, qui dit n’obéir à aucune loi sinon celle de sa propre morale, de décider de la légitimité d’un régime à rester en place. Pour ce qui est du mal que représente une dictature communiste, personne de notre camp ne le niera. Mais à ce compte, qu’est-ce qui peut bien empêcher Donald Trump de renverser les régimes cubain, colombien, algérien, égyptien, turkmène ou que sais-je, tout régime qu’il jugera mauvais ? Poursuivons l’exercice de pensée : alors qu’Elon Musk déclare chaque semaine s’inquiéter de la situation démocratique dans tel ou tel pays européen – le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, principalement –, on peut aller jusqu’à imaginer une intervention américaine sur notre sol. De même, les adeptes de la complaisance devant plus fort qu’eux jugeront-ils avec concupiscence l’écrasement de l’Europe sous le talon de la botte des GI, s’il venait à se produire ?
D’aucuns affirment que Donald Trump serait un adepte de sa « doctrine Donroe » et ne chercherait qu’à intervenir dans sa zone d’influence. Je rappellerai donc à toutes fins utiles qu’il se vantait il y a quelques mois d’avoir mis fin à huit guerres dans le monde, qu’il avait frappé l’Iran il y a quelques mois, que son implication en Israël et en Ukraine a replacé les États-Unis au centre du jeu. Comme isolationniste, on a vu mieux, ce que lui reproche d’ailleurs largement une partie de sa base.
Le cas du Groenland a ainsi soulevé d’inquiétantes réactions au sein de la droite française. Une part d’entre elle, souverainiste, n’a pas tardé à expliquer que le Groenland était un problème danois et qu’on ne mourrait pas plus pour Nuuk que pour Kiev ou pour Dantzig. Une autre part, libérale-identitaire, a préféré se coucher par instinct, expliquant que puisque Trump avait enterré le droit international, nous devions en faire autant ; que puisque la loi du plus fort régnait et que l’Amérique était plus forte que l’Europe, il fallait se soumettre à l’Amérique. Déjà, Donald Trump a déclaré sanctionner économiquement à hauteur de 10, puis 25 % de taxes douanières les pays qui ne soutiendraient pas son action polaire, sorte de jizya pesant sur ses ennemis.
On se demande légitimement ce que ces gens auraient fait en 40 devant un envahisseur nazi omnipotent, et comment ils peuvent soutenir une Ukraine bien plus faible que son envahisseur russe. À suivre leur raisonnement, n’eût-il pas mieux valu que M. Zelensky offrit son pays à M. Poutine quand, une semaine après le début de la guerre, les chars russes étaient à Kiev et que l’armée ukrainienne était dix fois moins puissante ? Là, on suggère de marchander les conséquences de la défaite avant même le premier coup de semonce.
Trump, champion de la droite ?
S’il n’est pas conservateur – tout juste anti-trans et anti-woke –, s’il est visiblement assez peu favorable à la liberté d’expression quand elle ne va pas dans son sens, Donald Trump mène indéniablement une guerre farouche à deux menaces qui planent sur l’Europe : le gauchisme et l’immigration de masse. Autre point essentiel : à la tête de la première puissance mondiale, nul ne peut ignorer son action. Une question se pose alors : la guerre que Donald Trump mène contre ces menaces aux États-Unis est-elle bénéfique pour l’Europe ?
Pour ce qui est de la guerre contre le gauchisme – dans son sens LFIste du terme –, il est vrai que le mouvement MAGA, largement incarné un temps par Charlie Kirk, a mené un véritable travail médiatique, rhétorique et même un peu culturel en développant ses propres « intellectuels » organiques. Le mot est à mettre entre guillemets car le niveau intellectuel des Américains étant ce qu’il est, il serait vain de lui apporter la même exigence qu’en Europe. Cela étant dit, le ralliement d’influenceurs, de personnalités célèbres, de grands patrons influents à une cause appuyée par la formidable machine de guerre qu’est le GOP (Great Old Party, soit les Républicains) a sans nul doute contribué à de nombreuses victoires. Pour le moment, on peine encore à voir les changements structurels (universités et institutions diverses), mais force est de constater qu’entre la classification des antifas comme groupe terroriste, les réformes anti-DEI (Diversity, Equity and Inclusion), l’interdiction des athlètes trans dans les compétitions sportives de leur sexe de destination, la dévalorisation sociale des études très marquées à gauche et la promotion des œuvres conservatrices, du bon travail a été fait. Il faudra sans doute s’en inspirer à l’avenir, sans la violence du langage propre à l’Amérique.
Le sujet migratoire en revanche, est autrement plus complexe. Depuis un an, Donald Trump a commencé à mettre en place une politique de remigration massive, dont acte. Ainsi, selon le Homeland Security, plus de 600 000 expulsions ont été réalisées en 2025, soit plus du double de 2024. Des résultats satisfaisants qui, en soit, réjouissent les Américains. Ce qui les réjouit moins en revanche, c’est le comportement de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement, la police aux frontières).
Selon les derniers sondages, plus de la moitié des Américains considèrent que l’ICE rend les villes américaines moins sûres quand elle y intervient (51 % contre 31 % qui les voient comme plus sûres). Dans la même veine, la mort de Renee Nicole Good, cette Américaine tuée par un agent de la police aux frontières après un refus d’obtempérer, est vue comme un usage inapproprié de la force par une majorité d’entre eux. Même le podcasteur trumpiste Joe Rogan, écouté par des dizaines de millions de républicains, s’est récemment indigné face aux méthodes employées par l’ICE. De manière générale, la droite américaine elle-même, pourtant peu connue pour sa modération, est de moins en moins convaincue par les méthodes employées.
Ce qui est en cause ici, ce n’est évidemment pas le principe de l’ICE en lui-même : plus de 80 % des Américains sont favorables à l’expulsion totale (31 %) ou partielle (51 %) des migrants illégaux. En revanche, le soutien à la manière d’expulser les migrants et le comportement de l’ICE s’érode de semaine en semaine, allant même jusqu’à modifier l’opinion des Américains sur la nécessité d’expulser les migrants !
L’affaire Good est à ce titre assez évocatrice : il est manifestement difficile d’estimer si les trois tirs sont légitimes tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux – la possibilité qu’ils le soient n’étant pas à écarter, soyons de bonne foi. Cependant, le vice-président américain JD Vance a coupé court à toutes les spéculations en déclarant péremptoirement que l’agent était dans son bon droit, et qu’il n’y aurait aucune enquête à ce sujet. Pour faire simple, l’État de droit est tout à fait enterré sur ce point.
Le problème, c’est que cette affaire n’est pas isolée. Sur les réseaux sociaux, des dizaines, voire centaines de cas de violences policières objectives, dans des situations impliquant des agents de l’ICE bien moins litigieuses que pour Renee Good, sont relayées. On y voit des personnes non-blanches sommées de montrer leurs papiers, voire arrêtées sans raison, des « Natives » (Indiens d’Amérique) interpellés à tort, des personnes ne manifestant même pas attaquées par des agents de l’ICE se comportant pour beaucoup comme des cow-boys. Couverts par leur hiérarchie, n’ayant suivi pour certains que six semaines de formation, on les voit officier comme le ferait la police d’un régime autoritaire dans de nombreux cas. Il faut bien sûr soulever la question des manifestations gauchistes, notamment dans le Minnesota, qui gênent l’arrestation des clandestins : la faute est souvent partagée. Cependant, les cas de violences policières sont loin, très loin d’être des cas isolés : ce n’est pas faire preuve de gauchisme que de le dire, à nouveau, même les Républicains se montrent de plus en plus critiques à ce sujet.
L’ultime argument brandi sur l’ICE sera qu’on ne peut pas faire d’omelette sans casser des œufs. La chose est évidente, mais il est toujours préférable que les œufs ne soient pas les citoyens et qu’on n’en casse pas trop pour dégoûter son propre peuple de la volonté de faire cette omelette. Ici, il n’est pas question d’excès d’expulsions, mais de chaos et d’amateurisme. Or, si Donald Trump rebute les Américains par sa politique migratoire, la conséquence nécessaire sera un rejet en miroir des Européens de ceux qui se placent dans son sillage. Mieux vaut une remigration ordonnée, efficace et appréciée qu’une action aveugle sous prétexte d’efficacité. Aujourd’hui, quelle valeur d’exemple ont les actes – pas les idées, les actes – de Donald Trump sur le sujet ? Il suffit aujourd’hui de dire : je suis contre l’immigration, pour la remigration des clandestins, mais pas de la même façon que Donald Trump, notre adversaire.
La droite soumise
Il y a un peu d’amour de l’humiliation dans notre pays chez cette droite. Oh, personne ne conteste la gravité de la situation de notre pays, bien sûr. Mais l’orgueil du Français ne se réveille-t-il pas en entendant le vice-président JD Vance à Munich faire l’étalage de notre faiblesse, comme le fait d’ailleurs l’ancien président russe Dimitri Medvedev ? Pourquoi se réjouit-on de l’interdiction de territoire de l’infâme Thierry Breton aux États-Unis ? Cette droite n’aime rien tant que d’entendre l’inventaire des catastrophes qu’elle attribue sans réfléchir à la gauche et au centre : il sert bien son discours. Et pourtant, comment ne pas ressentir de la gêne à raconter au monde entier que Paris est devenue une ville-poubelle tiers-mondisée, que nous sommes sur le point d’entrer en guerre civile, que nos finances s’écroulent, que l’industrie s’en va ou que sais-je ? D’aucuns se sentent comme galvanisés par l’étalage de notre décrépitude. Ils répètent à qui veut l’entendre : « Nous sommes faibles. » Or, qu’on le martèle, il n’y a pas un gramme de patriotisme dans ce discours. Lavons notre linge sale en famille. On a parfois l’impression de lire les partisans français de Vladimir Poutine qui, constatant qu’un dirigeant politique mène une action autoritaire partageant certaines de leurs convictions, sont prêts à lui faire allégeance quand bien même il menacerait notre intérêt.
Donald Trump n’est pas là pour sauver ni l’Europe, ni l’Occident, ni le monde. D’ailleurs, j’attends encore que l’on m’explique quel intérêt les États-Unis ont-ils à annexer le Groenland alors qu’ils ont déjà la possibilité d’y déployer autant de soldats que voulu et d’y extraire des minerais autant qu’ils le souhaitent. Alors, pourquoi Trump veut-il à ce point l’annexer ? Dans un entretien récemment accordé au New York Timesdans lequel on lui demandait pourquoi cette annexion était à ce point indispensable, il répondait : « Parce que c’est ce dont j’ai psychologiquement besoin pour réussir. » Annexer le territoire d’un allié pour des raisons psychologiques, est-ce donc cela, la droite ? Une offre à 700 milliards de dollars a même été proposée au Danemark, ce qui signifie que Donald Trump est prêt à dépenser cette somme pour un « besoin psychologique ». Dans le même style, le 47e Président a tout récemment envoyé une lettre au Premier ministre norvégien, expliquant que puisqu’il n’avait pas reçu son Prix Nobel, il ne se sentait aucune obligation de « penser purement en termes de paix ». Quel modèle pour la droite !
Le culte de la personnalité qui se met petit à petit en place aux États-Unis est d’ailleurs, au-delà d’être passablement inquiétant, assez évocateur quant aux ambitions réelles de son dirigeant. En fait, Donald Trump ne défend même pas les intérêts des États-Unis : il défend son intérêt propre – encore et toujours, marquer l’Histoire à tout prix, en « rendant sa grandeur à l’Amérique ».
Le phénomène interroge cependant. Pourquoi autant battre sa coulpe chez les « patriotes », si ce n’est parce qu’on ne se sent aucune responsabilité dans la situation actuelle et qu’on cherche à la fois un coupable et un sauveur ? Or, si la culpabilité appartient aux dirigeants politiques, économiques et culturels de ces dernières décennies, la responsabilité, elle, est collective. Certains ont dédié leur vie entière au combat pour une France meilleure. Ils ne se sentiront pas visés par ces propos.
Que la droite cesse un peu de se passionner pour les dirigeants étrangers. Un siècle plus tôt, des membres d’Action française ou d’autres mouvements nationalistes commettaient précisément l’erreur de regarder avec fascination l’Italie mussolinienne ou l’Allemagne hitlérienne, dépité par la démocratie parlementaire radicale : Trump n’est certes pas Hitler, mais le principe aujourd’hui est le même. Ceux qui se soumettront deviendront les traîtres à la France : déjà, on voit de façon grotesque les centristes se faire les chantres de l’indépendance nationale face à une gauche tiers-mondiste et une droite encore trop soumise. Je rappelle qu’alors, parmi les nationalistes, beaucoup résistèrent. C’est d’eux qu’il faut nous inspirer, pas des « réalistes » d’alors qui nous menèrent au fond du gouffre. Cela, je l’évoquais déjà il y a six mois dans un article écrit chez Causeur.
Mais revenons à l’essence du problème.
Le problème du culte de la force
Depuis quand des États-Unis en bonne santé sont-ils une bonne nouvelle pour les intérêts européens et français ? Voilà des décennies que les souverainistes, à juste titre, condamnaient la mainmise américaine sur notre continent et sur la France, le chantage à l’industrie militaire, l’exemple d’Alstom ou de l’espionnage de la NSA en étant de bons représentants. Un affaiblissement américain signifierait en réalité plus probablement un pétrole et un gaz moins chers, des droits de douane moins élevés, une reprise en main de l’Europe sur ses domaines de prédilection comme l’automobile, l’aviation, le tourisme, le luxe, la défense et bien d’autres. Voilà des décennies que l’Europe peine à reprendre son destin en main, et l’influence américaine manipulatrice ou offensive selon les « POTUS » n’y est sans doute pas pour rien.
J’entends que l’on se fasse le défenseur de l’« Occident », de l’amitié franco-américaine. Mais alors, comment penser que l’homme qui menace tous les mois notre continent, souhaite s’emparer du territoire d’un allié, nous taxe et impose une jizya soit aujourd’hui un partenaire fiable auquel il faudrait se soumettre ?
C’est là le problème du culte de la force. La loi du plus fort est un principe simple : plus on est fort, plus on a la capacité d’imposer sa volonté à l’autre. Elle est une évidence en relations internationales. Le culte de la force est autre chose : c’est la mise en place d’une pyramide alimentaire dans laquelle le fort domine le faible. La nuance est importante, car, dans le premier cas, il s’agit simplement d’un constat que l’on peut d’ailleurs retrouver dans toutes les guerres : à la fin, c’est le plus fort qui l’emporte. Dans le second cas, le plus faible doit se soumettre au plus fort. Sur l’exemple de l’Ukraine, la loi du plus fort dispose que l’Ukraine doit devenir plus forte, de façon militaire ou diplomatique, pour l’emporter ; le culte de la force eût exigé qu’elle se rende dès le départ.
Sur le Groenland, le culte de la force demanderait qu’on le cédât en en tirant quelques avantages, la loi du plus fort voudrait que l’on trouve un moyen d’inverser le rapport de force pour empêcher sa perte. On peut ici relever en embryon de solution une constante chez Donald Trump : alors qu’il refuse toujours de s’enliser dans de longs conflits coûteux comme l’Afghanistan, on a bien de la peine à l’imaginer tuer des soldats européens si faible que soit leur nombre. Les conséquences seraient trop graves. Tous disent : « Cela prouve bien qu’à la fin, il n’y a que la FORCE qui compte. » Or, le fort s’affaiblirait trop ici en nous attaquant : il perd déjà des alliés à mesure que les semaines passent, et ce faisant, il perd aussi des soutiens dans son propre camp. Le mauvais usage de la force rend souvent vulnérable. Cela ne signifie pourtant par qu’il faille rejeter la force, bien au contraire. Pourtant, on aimerait, en temps de crise, entendre la droite appeler au renforcement avant l’asservissement. La réponse à notre faiblesse n’est pas la nécessité de notre soumission, mais l’urgence de notre montée en puissance.
Passer du campisme à l’espérance
Nombreux sont ceux qui considèrent qu’il ne faudrait jamais critiquer son propre camp car ce serait l’affaiblir. L’histoire leur donne tort : c’est parce que le camp national a fait son autocritique qu’il est passé de 13 à 20 % aux élections, c’est parce qu’il a fait son autocritique qu’il est passé de 20 à 44 %. D’autres arguent que c’est la radicalité – au sens commun du terme – qui nous permettra de l’emporter. Est-ce en se radicalisant que le RN a triplé son électorat ? C’est en se radicalisant que La France insoumise s’est marginalisée à gauche, que la gauche a perdu l’ascendant moral et intellectuel qu’elle avait. Il ne s’agit pourtant pas de devenir centriste, mais de permettre aux centristes de trouver l’action de la vraie droite suffisamment acceptable pour l’emporter. Ne perdons pas de temps à essayer de convaincre la gauche militante qui nous haïra toujours : consacrons-nous à bâtir un projet – même radical – qui puisse paraître attrayant pour le peuple majoritaire.
La droite, particulièrement en France, s’attache encore à son idéal d’homme providentiel. Exaspérée par la médiocrité du personnel politique qui la représente, elle agit comme un orphelin battu qui verrait une figure paternelle dans chaque homme qui le gifle. C’est parce qu’elle ne croit plus dans la politique que cette droite adule Trump. Alors, elle se met à genoux. Devant Poutine il y a dix ans, devant la guerre menée par Netanyahou il y a deux ans, devant Trump aujourd’hui.
C’est d’ailleurs toujours la même phrase : « Lui au moins, il défend son pays. » Dans la même veine, une figure souverainiste déclarait récemment que Maduro avait beau être autoritaire, son taux de popularité était supérieur à celui de Macron. Avec ce raisonnement, nul doute qu’une telle droite aurait défendu Staline en son temps. Mais par-delà ces mots, il y a un désespoir tremblant de ne voir aucun mouvement se dédier tout à fait à la défense du pays, un sentiment d’abandon de la part des « grands serviteurs de l’État » d’autrefois, et toujours sans doute un défaut d’incarnation au sein même de notre camp. Au fond, qui croit vraiment que l’un des partis en lice « sauvera le pays » ?
Le manque d’espérance conduit au réalisme, à la froideur, à l’amoralité, voire l’immoralité. À quoi bon être les gentils dans l’affaire, si ce ne sont pas les gentils, mais les plus forts qui l’emportent ? À quoi bon les règles, à quoi bon la morale ? Sans espérance, sans esprit de conquête, nous nous enfermons dans un bunker, dans l’esprit de résistance qui autorise tout, et ce alors même que nous ne sommes plus en résistance, mais en conquête.
On me répondra là encore que la gauche, elle, se permet tout : mais précisément, c’est parce qu’elle se permet tout qu’elle ne l’emporte pas. Sa violence, sa passion du chaos, son affection pour l’outrance permanente sont sans doute jalousables parce qu’ils nous sont interdits à nous, mais aussi une chance parce qu’ils nous interdisent l’inutile excès. Des libertés sont sans doute à conquérir, mais que les militants se souviennent toujours qu’ils sont des militants, et que le peuple n’est pas militant.
L’idéal aristocratique, essence de la droite, prône la force, l’amélioration constante, le service du faible, la noblesse, la chevalerie, la défense du bien et de sa capacité à faire le bien. Soyons-y fidèles. N’ayant pu faire que le fort soit juste, faisons que le juste soit fort.
Alexandre de Galzain (Site de la revue Éléments, 22 janvier 2026)