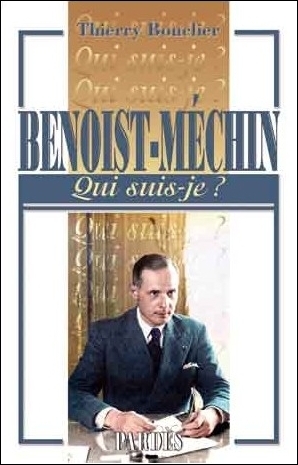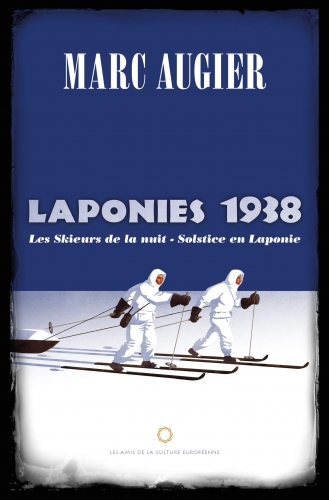Nous reproduisons ci-dessous une analyse de Paul Tormenen, cueillie sur Polémia et consacrée à la nouvelle vague migratoire que subit l'Europe depuis quelquies mois.

En France, pas de passe sanitaire pour les immigrés
Un prêtre à de nouveau été assassiné par un extra-européen en France. Après le père Hamel tué par les terroristes islamistes Adel Kermiche et Abdel Malik Nabil-Petitjean, c’est le père Olivier Maire qui a été assassiné par Emmanuel Abayisenga, clandestin rwandais… qui était sous le coup d’une procédure judiciaire pour avoir voulu incendier la cathédrale de Nantes le 18 juillet 2020. Pendant que les Français sont soumis à une incroyable tyrannie sanitaire, les immigrés extra-européens bénéficient toujours d’un laxisme insupportable. Dans le texte qui suit, Paul Tormenen le démontre de manière implacable.
Polémia
Il y a quelques mois, en mai 2020, trois organisations internationales soulignaient que le rétablissement des transports internationaux, interrompu momentanément en raison de la crise sanitaire, risquait d’entrainer un afflux de clandestins en Europe (1).
Les informations disponibles en la matière montrent que ces prévisions étaient totalement fondées : depuis quelques mois, l’émigration clandestine redouble, en particulier vers la France.
Le gouvernement français, fidèle à la ligne de conduite laxiste tracée par le chef de l’État, apparait incapable d’endiguer cette vague montante. Pendant ce temps, en Europe, d’autres gouvernements prennent des mesures fermes pour contenir l’immigration extra-européenne, en dépit des protestations de la commission européenne et des O.N.G. Alors que la France apparait comme le maillon faible, ils ont compris qu’il y avait urgence à réagir pour éviter le chaos et les conflits communautaires.L’Europe plus vulnérable que jamais
Depuis le rétablissement des traversées clandestines d’Afrique et de Turquie vers l’Europe, les Organisations Non Gouvernementales déplorent de très nombreuses noyades de migrants en mer méditerranée. Ces événements tragiques sont révélateurs de l’essor considérable du nombre de départs de clandestins des côtes africaines et turques.
Fin juillet, les arrivées clandestines en Europe par la mer et par la terre étaient en augmentation de 53% par rapport à l’année dernière, selon l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) (2).
Nombre d’arrivées clandestines recensées A fin juillet 2020 Au 28 juillet 2021 Évolution IOM 41 440 63 798 + 53% Source : OIM. Arrivées en Europe au 31 juillet 2020 et au 28 juillet 2021
Il faut ajouter à ce nombre toutes les arrivées non comptabilisées qui viennent grossir le stock des clandestins, comme les étrangers venus en Europe avec un visa de tourisme ou d’études qui ne repartent pas dans leur pays à l’échéance de leur titre de séjour.
Plusieurs facteurs concourent à l’importance actuelle de l’immigration clandestine :
- La crise économique au Maghreb, et plus largement en Afrique, causée par le ralentissement de l’activité, notamment touristique, se traduit par un développement de la pauvreté. La conquête progressive du territoire afghan par les Talibans amène de nombreux Afghans à demander l’asile en Europe ou à y pénétrer clandestinement via la Turquie (3).
- Le retour en mer méditerranée des bateaux des passeurs et autres trafiquants d’êtres humains. Il s’agit d’un secteur florissant de l’économie informelle en Afrique, avec des passeurs qui viennent démarcher les jeunes dans les pays de départ (4).
- Le retour en mer méditerranée des bateaux des O.N.G. et l’accroissement de leur budget grâce à des subventions publiques. SOS méditerranée et son bateau Océan Viking bénéficient ainsi depuis le début de l’année de financements pérennes. En plus de bailleurs de l’O.N.G. comme la Croix rouge et le Croissant rouge, une cinquantaine de collectivités territoriales et locales françaises, dirigées par des élus de gauche, se sont engagées au sein d’une « plateforme des collectives solidaires françaises » à apporter leur soutien financier à SOS méditerranée (5).
- Les contraintes imposées par l’Union européenne. Au travers de ses interventions intempestives, la commission européenne ne cesse d’affaiblir la capacité des pays européens à endiguer l’immigration clandestine.
Des parlementaires européens ont récemment accusé des agents du corps de garde-côtes Frontex de pratiquer des refoulements de clandestins en haute mer. La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a immédiatement demandé au directeur de Frontex d’augmenter sensiblement le nombre d’« observateurs des droits fondamentaux », chargés notamment de veiller à ce que les clandestins puissent faire une demande d’asile en haute mer ( ! ) ou aux frontières terrestres et entrer sur le territoire européen (6).
Dans le prolongement de cette demande, la commission européenne vient de saisir la cour de justice de l’Union européenne pour faire condamner les autorités hongroises, au motif qu’elles pratiqueraient des refoulements aux frontières, en violation d’une directive européenne (7).C’est ainsi la capacité même des pays européens à contenir l’immigration clandestine qui est remise en cause. Les bureaucrates européens sont par contre beaucoup plus discrets quand des douaniers hongrois se font agresser par des migrants à la frontière avec la Serbie, comme cela s’est passé le 29 juillet (8).À défaut de volonté d’endiguer les flux migratoires, la commission européenne organise la répartition des migrants dans les différents pays européens. La « solidarité » avec les pays de premier accueil des clandestins (Espagne, Italie, Grèce) souhaitée par la commission européenne s’exprime en effet au travers des relocalisations des migrants dans les pays européens volontaires. Le gouvernement français y répond toujours favorablement. Pour favoriser ces mouvements de population, la commissaire européenne a annoncé qu’un budget de 300 millions d’euros allait être dédié à la relocalisation de 30 000 migrants d’ici fin 2022 (9). Pendant ce temps, l’organisation du retour des étrangers arrivés illégalement en Europe dans leurs pays semble à peine envisagée, tant les Etats européens ont su avec force traités et directives entraver leur capacité à maitriser l’immigration.
- L’utilisation de l’immigration comme arme diplomatique. La sous-traitance à des pays tiers du contrôle des frontières extérieures de l’espace Schengen a placé les pays européens dans une situation de très grande vulnérabilité. En mars 2020, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, téléguidait des milliers de migrants à la frontière grecque, afin de faire monter les enchères en vue de la renégociation de l’accord migratoire conclu avec l’Union européenne en 2016. En mai 2021, plusieurs milliers de Marocains ont, parfois en agressant des douaniers espagnols, forcé la frontière pour accéder au territoire espagnol de Ceuta, au nord du continent africain. Depuis le mois de juin, la Lituanie fait face à un afflux de migrants tacitement autorisé, voire organisé, par le gouvernement du pays voisin, la Biélorussie.
À chaque fois, les gouvernements hostiles ouvrent les vannes à l’immigration clandestine pour faire pression sur l’Union européenne (dans le cas de la Grèce et de la Lituanie) ou sur le pays voisin (dans le cas de l’Espagne) en raison de divergences diplomatiques. A chaque fois, ce sont des flux d’immigration supplémentaires qui arrivent en Europe.
La France désarmée
Dans ce contexte, la France apparait particulièrement vulnérable. L’incurie du gouvernement français en la matière se manifeste sous différentes formes :
- Le nombre de placements en rétention d’étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement et le nombre d’éloignements effectifs du territoire se sont effondrés, comme en témoigne un rapport paru récemment (10).
- Le refus de certains clandestins de faire des tests PCR apparait comme une nouvelle parade, qui s’ajoute à la guérilla juridique, pour faire échouer l’application des Obligations de Quitter le Territoire Français (11).
- Des associations immigrationnistes prennent l’opinion publique à témoin lors d’occupations de places publiques complaisamment médiatisées, pour que des « mises à l’abri » collectives de migrants soient organisées. Rien qu’à Paris, 9 opérations de ce type ont été menées depuis le début de l’année. A aucun moment les autorités françaises n’évoquent le retour dans leur pays des clandestins, en lieu et place de leur orientation vers des structures d’accueil.
- La liste des pays sûrs dont les ressortissants ne peuvent se prévaloir du droit d’asile a récemment été réduite sur décision du conseil d’Etat, afin de garantir les droits des LGBT (12).
- Au lieu de restreindre les conditions d’accès à l’Aide Sociale à l’Enfance, massivement détournée de son objet initial par des jeunes extra-européens, le gouvernement et des départements s’emploient à leur bâtir des parcours d’insertion après leur majorité, au travers notamment de la Garantie Jeunes (13).
Dans ces conditions, les rares indicateurs qui filtrent en dehors des statistiques annuelles sont au rouge :
- +40% de demandes d’asile déposées en France en juin 2021 par rapport à l’année dernière (14),
- chaque mois, plus de 1 000 clandestins supplémentaires bénéficient de l’Aide Médicale d’Etat, en dépit des sorties du dispositif grâce aux très nombreuses régularisations largement accordées par le gouvernement français (15).
Le gouvernement français regarde ailleurs
Face à une situation qui va rapidement devenir chaotique, le gouvernement français se fixe comme objectif bien peu ambitieux d’expulser les étrangers en situation irrégulière radicalisés et les délinquants, avec un succès pour le moins mitigé (16). Contrairement à d’autres pays européens, les autorités françaises se refusent à conditionner l’aide au développement et l’octroi de visas à la délivrance de laisser passer consulaires par les pays d’origine des clandestin, le précieux sésame permettant d’organiser leur retour.
En Europe, des gouvernements ne restent pas inertes face à la submersion migratoire
Si le gouvernement français apparait tétanisé à l’idée de prendre le problème de l’immigration à bras le corps, d’autres pays européens prennent des initiatives résolues.
Le Royaume-Uni a récemment annoncé conditionner la délivrance des titres de séjour à la bonne volonté des pays tiers à délivrer des laisser passer consulaires. Les autorités de ce pays rejoignent celles du Danemark pour organiser l’externalisation, notamment en Afrique, des procédures d’asile. L’objectif assumé est d’éviter l’immigration économique subie et que les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière s’enlisent dans les méandres administratifs et judiciaires.
La Suède vient pour sa part d’adopter une loi limitant la durée des titres de séjour accordés aux bénéficiaires de la protection internationale (17). Le gouvernement hongrois exige désormais que les demandes d’asile soient effectuées en dehors du pays, ce qui a contribué à en réduire drastiquement le nombre, qui était déjà très faible (18). Pour stopper la pression migratoire, la Lituanie et l’Autriche déploient des militaires aux frontières (19).
Pendant ce temps, le ministre de l’intérieur français demande l’aide de Frontex pour…contenir les départs de migrants de France vers le Royaume-Uni ! (20). Chacun ses priorités. Dans le cas présent, le gouvernement français semble faire du pédalo dans une mer agitée.
En 2017, le mentor d’Emmanuel Macron, Jacques Attali, exprimait sa conception de l’immigration : « Tout pays doit se penser comme un hôtel et ses habitants comme des hôteliers. Recevoir sans cesse des étrangers. Être accueillant » (21). Avec le recul, on peut constater que l’élève a suivi scrupuleusement les préceptes du maitre, « quoiqu’il en coûte » pour la France et les Français. Le réveil sera rude.
Paul Tormenen (Polémia, 10 août 2021)
Notes
(1) « Après le confinement, la submersion migratoire ? ». Polémia. 19 mai 2020
(2) Flow monitoring Europe. Arrivals to Europe. IOM. Requête au 2 août 2021
(3) « As Taliban advances, Europe fears an afghan migration crisis ». VOA news. 2 août 202
(4) « Au Sénégal, des passeurs face à la justice ». Jeune Afrique. 30 avril 2021
(5) « La plateforme des collectivités solidaires ». Site de SOS méditerranée
(6) « Commissioner Johansson’s remarks at Libe working group on Frontex scrutiny »
(7) « La commission européenne saisit la cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la Hongrie pour restriction illégale de l’accès à la procédure d’asile ». Commission européenne. 15 juillet 2021
(8) « Migrants attack guards on Hungarian-Serbian border ». RMX News. 29 juillet 2021
(9) « EU aims for 30 000 refugees resettlements until 2022 ». Infomigrants. 13 juillet 2021
(10) « Centres et locaux de rétention administrative ». Rapport 2020. La Cimade.
(11) « Refuser les tests PCR permet au moins de retarder l’expulsion ». La Voix du nord. 21 mai 2021
(12) « Immigration : le conseil d’Etat retoque la liste des pays sûrs ». Le Figaro. 2 juillet 2021
(13) « La Garantie Jeunes doit devenir un droit pour tous les précaires ». 20 minutes. 7 janvier 2021
(14) « Récapitulatif des indicateurs de l’OFFI en juin 2021 ». Tweet de l’OFII. 20 juillet 2021
(15) Rapport n°4195 sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020. Assemblée nationale
(16) « Macron demande un tour de vis sur l’expulsion des étrangers irréguliers ». L’Express. 9 juin 2021
(17) « Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’immigration ». Euronews. 22 juillet 2021
(18) « En Hongrie, il n’est actuellement plus possible de demander l’asile ». Infomigrants. 31 août 2020
(19) « Immigration : l’Autriche mobilise des centaines de soldats à ses frontières ». Valeurs actuelles. 25 juillet 2021
(20) « Darmanin demande à Frontex de s’occuper du nord de l’Europe ». Euractiv. 26 juillet 2021
(21) « La Suisse doit se penser comme un hôtel ». Interview de Jacques Attali. 24 heures.Ch. 17 octobre 2017