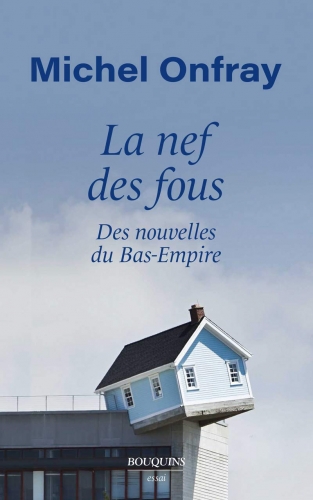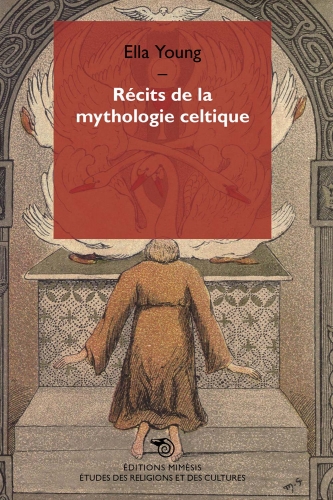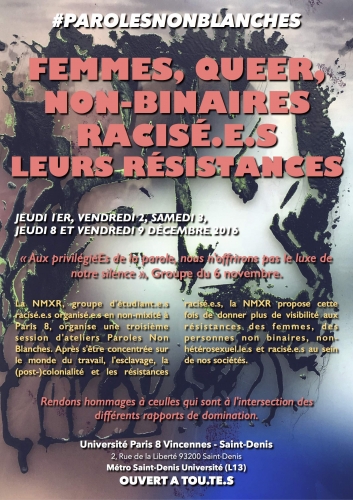La France, fille des États-Unis et de l’Europe
On pourrait appeler ça un lapsus géopolitique. « Hésiter entre autonomie stratégique (européenne, NDLR) et alliance atlantique, c’est un peu comme demander à un enfant s’il préfère sa mère ou son père », a déclaré la ministre des Armées, Florence Parly, lors d’un long entretien avec la revue Le Grand Continent.
L’on comprend intuitivement ce que veut dire Madame Parly : dans l’esprit de ceux qui nous gouvernent, particulièrement depuis Nicolas Sarkozy, l’OTAN et la construction européenne sont deux processus qui auraient pour l’avenir force de destin. Il n’y aurait pas d’autre ligne d’horizon que cette double intégration de la France dans deux ensembles plus grands qu’elle mais qui, entre eux, ne seraient pas pour autant en concurrence. A l’Union européenne, l’édification des normes juridiques, politiques, économiques et sociales ; à l’OTAN l’expression de la puissance par le biais de l’outil militaire. Ce sont deux logiques impériales distinctes, mais compatibles l’une avec l’autre, dont les centres respectifs se situeraient respectivement à Bruxelles et à Washington. Nous sommes tellement habitués à cette subordination à deux têtes qu’elle nous apparaît des plus naturelles, même si elle est rarement formalisée comme telle. Attention, quand je parle d’empire, je ne pense pas à une hégémonie totale qui s’exercerait en tout lieu avec la même force. Un empire ne demande pas à chacun de ses membres – notamment aux plus éloignés – d’être des Romains à part entière. Qu’ils soient des Gallo-Romains suffit largement à la logique impériale. C’est un régime de semi-liberté au sens où, sur toutes les questions d’ordre secondaire, l’ancien barbare a la chance de pouvoir le rester un peu. Mais le centre de l’empire rayonnant, il perd un peu de sa barbarie par l’action de cette force d’attraction qui l’influence. Plus on se rapproche du centre, plus les Gallo-Romains sont romains et moins ils sont gaulois. Plus on se rapproche du centre, moins cette semi-liberté se manifeste, mais, en échange, plus le pouvoir au sein de l’empire est grand. Dans les marches de l’empire, où la force d’attraction est la plus faible, la liberté y est la plus grande, mais le pouvoir le plus faible. On y vit comme en Gaule, mais on n’y écrit pas l’histoire. Ce qui y manquera toujours, c’est l’alliance de la liberté et du pouvoir. On peut avoir plus de l’un et moins de l’autre, mais pas les deux. Ce qui manquera donc toujours, c’est la souveraineté politique, ligne rouge infranchissable de la logique impériale.
Comme l’a bien montré Régis Debray, cette logique impériale est celle qui s’impose aujourd’hui dans l’ordre occidental. Que des vieux Etats souverains se réveillent aujourd’hui – Russie, Turquie, Iran, Inde, Chine – nous laissent aussi pantois que décontenancés. Mais comment peut-on ne pas vouloir de la douceur d’être gallo-romain ? Comment peut-on être seulement gaulois ?
C’est bien là que ces quelques mots de Florence Parly, si clairement exprimés, nous sautent à la figure. « Hésiter entre autonomie stratégique (européenne, NDLR) et alliance atlantique, c’est un peu comme demander à un enfant s’il préfère sa mère ou son père. » Voici que la France millénaire, par un étonnant retournement chronologique, devient la fille de l’OTAN, née en 1949, et de l’Union européenne, née en 1958. Dit autrement, la France est la fille des Etats-Unis et de l’Europe. Va encore pour les Etats-Unis, cela peut se comprendre comme la simple traduction d’un rapport d’autorité entre deux autorités distinctes, l’une l’emportant sur l’autre. Mais quid de l’Europe ? La France et les autres pays européens (il faudrait quand même demander aux Allemands ce qu’ils en pensent…) seraient filles de l’Europe, qui, elle-même, a été engendrée par la France et ces autres pays européens ? Un psychanalyste se régalerait d’une telle filiation enchevêtrée.
Si encore la France acceptait en conscience de n’être plus que la fille de l’Europe et des Etats-Unis, soit. Nous rentrerions sagement dans la logique impériale et profiterions ainsi de la douceur de vivre du barbare qui ne l’est plus complètement. Mais, en France, quelque chose résiste, dont Emmanuel Macron est lui-même la plus pure incarnation. Se vit-il comme le gouverneur d’une satrapie éloignée ou comme le président de la cinquième puissance mondiale ? Ai-je besoin de répondre ? A l’étranger, le président français fait doucement sourire avec son ego surdimensionné, sa prétention à régir le monde entier, à refonder l’Europe, à réinventer le capitalisme (Angela Merkel a bien ri en prenant la parole après lui lors du dernier sommet de Davos, il y a un mois environ) et à se ceindre (aucune petite gloire n’est à négliger) du titre de Haut-commissaire de France au Levant (eh oui, réglons le problème libanais puisque les Libanais eux-mêmes n’en sont pas capables). You’re so French, Hubert.
Ce reliquat de puissance française, qui prête à sourire quand il n’exaspère pas, est la marque un brin pathétique de notre ambivalence : nous vivons selon la logique impériale, sans l’accepter pleinement. Reste alors le déni, les actes manqués et les lapsus pour faire remonter à la surface cette phrase du juriste Jean de Blanot (1230-1281) : « le Roi de France est empereur en son royaume ». Toute l’histoire de France a représenté un mouvement de résistance à la forme impériale, et en particulier l’édification de notre nation par un Etat souverain qui l’a précédée, de Philippe IV le Bel à Charles de Gaulle en passant par la Révolution française. Cette histoire séculaire ne sait aujourd’hui comment s’exprimer sinon par l’expression d’une grandeur un peu fantoche et par la présence réconfortante d’un président de la République qui – au-delà du cas extrême d’Emmanuel Macron – conserve l’apparence d’un monarque tout puissant. Notre droit conserve lui aussi une certaine force d’inertie. Si l’intégration du droit de l’Union européenne diffuse jusque dans les plus lointaines juridictions et administrations, notre Constitution, elle, demeure légèrement épargnée. Certes, diront les plus eurosceptiques, l’Union européenne fait depuis 1992 l’objet d’un passage entier, le titre XV, aujourd’hui intitulé « De l’Union européenne » et dont l’article 88-1 dispose que « la République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des Traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Mais justement, l’on comprend à travers ces mots – n’en déplaise à Madame Parly – que c’est l’Europe qui est la fille de la France et des autres pays qui la constituent ! Quant à l’OTAN, on a beau chercher, mais on n’en trouve trace (en revanche, l’organisation nord-atlantique est inscrite dans les Traités européens). Lors, la France pourrait-elle être la fille de deux organisations dont notre Gründ Norm nous dit pour l’une, qu’elle en est la mère et pour l’autre, qu’elle n’existe pas ? Par ailleurs, bien avant le Titre XV, vient le Titre I intitulé… « De la souveraineté » où l’on peut lire en son article 3, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Ni aucune organisation ou Etat, a fortiori. Si la France peut bien sûr lier son destin à celui d’autres nations – et cela est même souhaitable, notamment avec pays les plus proches d’elle culturellement et historiquement, dont les Etats-Unis – elle ne pourra jamais le faire en tant que « fille », même avec le réconfort narcissique de se dire qu’elle est la « fille aînée ». Cela ne signifie pas que l’on doive sortir de l’OTAN ou de l’UE, seulement que l’on vive ces coopérations comme l’expression même de notre propre souveraineté et non comme celle d’une filiation qui, comme l’expression présidentielle de « souveraineté européenne », ne repose que sur du sable. Il n’y a ni mère ni fille, ni père ni fils, mais des Etats souverains disposant d’un pouvoir plus ou un grand et d’une histoire plus ou moins longue. La souveraineté n’est pas la croyance mégalomane que l’on peut faire ce que l’on veut, mais un choix premier d’où découle toute l’action politique.
Alexis Feertchak (Geopragma, 1er mars 2021)