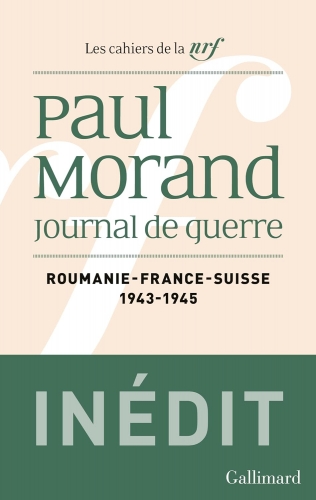Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Rodolphe Cart, cueilli sur le site de la revue Éléments et consacré aux choix diplomatiques à faire dans le conflit israélo-palestinien...
Collaborateur occasionnel d’Éléments, Rodolphe Cart est l'auteur de deux essais Georges Sorel - Le révolutionnaire conservateur (La Nouvelle Librairie, 2023) et Feu sur la droite nationale ! (La Nouvelle Librairie, 2023).

Conflit au Proche-Orient : peut-on encore défendre le non-alignement ?
Si le conflit russo-ukrainien a donné lieu à des anathèmes, des attaques verbales et des disputes d’une rare intensité, il faut reconnaître que ce n’était qu’un avant-goût en comparaison du climat médiatique actuel. Suite à l’embrasement du Proche-Orient, l’ensemble des boussoles idéologiques, passionnelles et géopolitiques se sont affolées dans un capharnaüm peu commun. Oubliés le cas ukrainien et le nouveau passage en force du gouvernement par le 49.3, et place au conflit israélo-palestinien qui doit servir de vecteur de reconfiguration de la vie politique française. Chacun est sommé de choisir un camp, sous peine d’être considéré comme un « confusionniste », un « lâche » ou même un « collabo’ ». Une chose est certaine, la majorité de la classe médiatique et politique (hors LFI) s’est rangée dans le « soutien inconditionnel à Israël » – même si les bombardements israéliens sur Gaza font émerger des voix discordantes. Toutefois, l’intérêt de la France consiste-t-il à prendre parti pour l’un des deux camps ? Le chamboulement international ne permet-il pas à la France de pouvoir renouer avec le non-alignement ?
Un climat de dénonciation
Ces derniers mois, l’enchaînement des événements dramatiques bouscule le monde politique. Preuve de cet emballement, une expression est revenue dans les débats : « cinquième colonne ». Pour le député franco-israélien Meyer Habib, les réactions d’une partie de la gauche, Insoumis en tête, à l’attaque contre l’État hébreu, confirment l’existence d’une « cinquième colonne » pro-islamiste. Arnaud Robinet, maire de Reims (Horizons), reprend aussi l’expression et appelle même à lever l’immunité parlementaire pour porter plainte contre les députés Insoumis. Comme si cela ne suffisait pas, un groupe de seize sénateurs français, avec en tête le sénateur Stéphane Le Rudulier (LR), a présenté un projet de loi visant à pénaliser la critique du sionisme.
L’émergence de cette expression, dans le débat public, n’est pas anodine. Aussi faut-il rappeler qu’elle nous vient de la guerre civile espagnole (1936-1939). La « cinquième colonne » désigne le traître embusqué à l’intérieur d’un pays ou d’une armée, prêt à se réveiller – ou à pactiser avec l’envahisseur –pour prendre à revers les forces en place. Cette notion est fondamentale pour comprendre la politique moderne, car c’est elle qui permet de faire bloc contre un ennemi clairement désigné. Aussi sert-elle à désigner un « camp » de façon englobante et sans nuances, installant par là une grande confusion intellectuelle au sein de la société. « La manifestation pour la République et contre l’antisémitisme sera un marqueur pour savoir de quel côté chacun se trouve », a estimé le journaliste Pascal Praud sur CNews en évoquant la manifestation du 12 novembre.
Le climat du débat politique actuel nous ramène directement en 2015, lors des attentats commis sur le sol français. Au moment de la commémoration de l’attaque contre l’Hyper Cacher, le Premier ministre de l’époque, Manuel Valls, avait rejeté toute tentative d’explication à la fabrique de jihadistes. « Pour ces ennemis qui s’en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille ; car expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser. » Il avait renchéri devant l’Assemblée en affirmant qu’« aucune excuse ne doit être cherchée, aucune excuse sociale, sociologique et culturelle » ne devait être cherchée au terrorisme. À l’époque, Marcel Gauchet jugeait « particulièrement regrettable » cette phrase. « Pour bien combattre un adversaire, avait rappelé l’historien au micro de France Inter, il faut le connaître. C’est le moyen de mobiliser les esprits et de donner une efficacité à l’action publique. »
Expliquer n’est pas excuser
Si certains intellectuels ou journaux résistent à ces périodes d’émotion, la grande majorité de la classe médiatique – commentateurs de l’actualité, personnalités politiques et chaînes d’information en continu – discrédite ces initiatives d’historiens, de sociologues, de géopoliticiens ou de politologues, qui essaient de comprendre ces situations de crise sans tomber dans le jugement ou la punition. C’est proprement la démarche critique et objective de ces chercheurs qui est niée ; la recherche des causes est alors pointée du doigt comme une attribution des fautes.
Or, nous avons besoin de ces regards critiques sur des phénomènes tels que le terrorisme, l’islamisme, le sionisme et les affrontements armés au Proche-Orient. Sans cela, nous nous empêchons de comprendre ce qui les a rendus possibles et nous tombons dans le travers des explications binaires – comme le « conflit de civilisations » ou autres. Le sociologue Bernard Lahire, dans son livre Pour la sociologie (2016), explique : « Le droit à la connaissance la plus indépendante possible des questions morales, politiques, juridiques ou pratiques, ne devrait jamais être remis en question. Rien, en démocratie, ne devrait faire obstacle à la recherche désintéressée de la vérité. Comprendre n’a jamais empêché par ailleurs de juger, mais juger (et punir) n’interdit pas de comprendre. »
Le lendemain de l’attaque du Hamas, le vice-président des Républicains François-Xavier Bellamy avait dit au micro d’Europe 1 : « C’est un crime injustifiable, indéfendable, que personne n’a le droit de relativiser ». Une fois passée l’émotion des attaques, une telle déclaration, venant d’un homme politique aspirant à de hautes responsabilités, est blâmable pour la raison qu’elle empêche toute explication et suggère un jugement moralisant disant « ce qui est bien » et « ce qui est mal », ce « qu’il faut faire » et ce « qu’il ne faut pas faire ». Pourtant, le réalisme doit être la seule boussole de l’homme d’État – tout particulièrement dans les moments de crise.
Force est de constater qu’une reconfiguration idéologique se produit dans le paysage politique français. Si Serge Klarsfeld avoue que le RN de Marine Le Pen a rompu avec l’antisémitisme de ses origines, il s’inquiète de la résurgence d’un antisémitisme d’extrême gauche. Sur le sujet, l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, conseillait déjà de toujours soutenir Israël, dans le but de pouvoir avancer sur une ligne dextrogyre sans encourir de reproche – on retrouve cette position à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), ou encore chez Bolsonaro au Brésil ou chez Orban en Hongrie. Néanmoins, l’assimilation de l’antisionisme à l’antisémitisme impose, de fait, une épée de Damoclès dès lors que la politique de Tel-Aviv est mise en question.
Le Sud se rebiffe
L’offensive dans la bande de Gaza a démontré que la restructuration des relations internationales entre les pays du « Nord » et ceux du « Sud global » s’accélérait. Si le « Sud » désigne traditionnellement les pays de l’ancienne périphérie coloniale en retard vis-à-vis du « Nord » (pays historiquement développés et représentatifs du système euro-atlantique), aujourd’hui, il faut voir que les lignes bougent. Que ce soit aux Nations Unies (ONU) ou lors du cas de la guerre en Ukraine – où de nombreux pays (Brésil, Afrique du Sud ou Inde) ont refusé de condamner l’agression russe et donc sapé les sanctions occidentales –, nous voyons apparaître une opposition à la diplomatie internationale des États-Unis, d’Israël et des « caniches » européens (c’est ainsi que nombre d’entre eux nous désignent).
« La Chine est profondément préoccupée par l’intensification des tensions et la montée de la violence entre la Palestine et Israël, et elle est profondément attristée par les pertes civiles causées par le conflit », a déclaré le 9 octobre le ministère chinois des Affaires étrangères, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à une désescalade. Le 1er novembre, la Russie a même haussé le ton, par la voix de son représentant permanent à l’Assemblée générale des Nations Unies (Vassili Nebenzia), en expliquant que l’État hébreu peut faire la guerre aux terroristes, mais pas à l’ensemble des Palestiniens. Ces positions marquent bien une affirmation du Sud, notamment sur la critique récurrente du « deux poids deux mesures » dans la condamnation des crimes commis de part et d’autre. Si la Chine ne figure plus dans « Sud » économiquement parlant, il faut aussi constater que ces pays rejettent de plus en plus l’autorité morale et politique occidentale – notamment la distinction entre autoritarisme et démocratie.
En accueillant six nouveaux membres lors du sommet de Johannesburg, les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont affirmé cette volonté des pays émergents d’œuvrer au rééquilibrage planétaire en créant des réseaux de puissance diversifiés. On retrouve plusieurs signes de l’influence grandissante des pays émergents sur la scène mondiale. Tout d’abord, le « club des cinq » produit un quart du PIB mondial et rassemble 42 % de la population du globe. Avec l’entrée de l’Arabie saoudite, de l’Iran et des Émirats, les Brics contrôlent dorénavant 54 % de la production mondiale de pétrole. Ce n’est pas tout puisque, comme le souligne le chercheur Sébastien Abis, les Brics « représentent désormais 23 % des ventes mondiales agricoles (en valeur), contre 16 % au début du siècle ». Et cela sans parler des métaux rares, où des gisements sont présents en Russie, au Brésil et en l’Afrique du Sud – à noter aussi que la Chine qui détient déjà les deux tiers des terres rares sur la planète.
Les intérêts géopolitiques et stratégiques sont déterminants dans les élargissements des Brics. Pour preuve, bien que Alger et Moscou entretiennent des rapports cordiaux, l’Algérie ne fut pas acceptée lors du dernier élargissement – sûrement à cause des tensions avec le Maroc. Aussi la cooptation de l’Égypte se fit sur insistance de la Chine pour s’assurer une influence le canal de Suez par lequel transite une grande partie du commerce international. Malgré des divisions internes, les Brics n’hésitent alors plus – surtout la Chine – à se poser en faiseurs de paix contre le bloc occidental (sous domination américaine) assimilé au désordre, à la guerre et aux rapports de domination.
L’Occident en perte de vitesse
La restructuration du système international penche vers le polycentrisme. Alors qu’ils avaient dominé pendant un siècle et demi sur les plans économique, technologique et politique, les pays euro-atlantiques ne sont plus dans une position de prédominance – ce qui va augmenter les dangers de collision et les potentialités de conflits. À ce titre, il faut se souvenir que la gestion de la crise de 2008 provoqua un impact profond pour des pays comme la Chine. Maintenant détenteurs de moyens économiques, financiers et militaires importants, ces pays s’opposent à cet ancien ordre qu’ils considèrent comme profondément injuste et en décadence.
Les signes de l’affaiblissement de l’Occident sont multiples. Bien que le dollar reste dominant, les pays des Brics insistent pour encourager les monnaies nationales dans le commerce international et les transactions financières entre elles et leurs partenaires commerciaux. Aussi malgré l’intégration, dans le G20, de l’Union africaine, cet essoufflement se voit jusque dans les promesses occidentales faites auprès des pays pauvres. Dernièrement, la proposition, avancée par le président Joe Biden, de créer un « corridor » – pour contrer la Chine et sa « route de la soie » – reliant l’Inde et l’Europe via les Émirats arabes unis, Israël et la Jordanie, n’a pas été à la hauteur de ses promesses. Les dollars promis n’étaient pas là ; ce qui contraste avec la concrétisation d’autres corridors (comme l’International Nord-South Transport Corridor reliant la Russie, l’Inde, l’Iran, etc.).
Cette mise en concurrence internationale oblige les États à repenser leurs intérêts propres et les coopérations à même de pouvoir répondre à leur position stratégique. La fin du « moment unipolaire » signifie, comme le rapporte le professeur John Mearsheimer, la fin de l’imposition d’un « ordre planétaire fondé sur les valeurs de la démocratie libérale – État de droit, économie de marché et droits humains, sous la bienveillante autorité de Washington ». Cette reconfiguration internationale dévoile au grand jour la compétition ouverte entre les États, mais aussi les questions d’autonomie et de souveraineté. Exemple : la liberté de décision nationale de choisir ses fournisseurs et ses clients pour vendre, dans le cas français, des Airbus et acheter du gaz à l’Iran ; ou encore celle d’investir et d’utiliser ses capitaux sans tomber sous les sanctions du Trésor américain et de la dépendance à l’égard du dollar.
Dans ce genre d’« interrègne », le réalisme politique le plus froid impose cette seule ligne directrice : il n’y a aucun protecteur vers lequel se tourner en cas de menace de la part d’un État rival. Chaque État ne doit prendre soin que de lui-même – ce qui revient à s’assurer qu’il n’est pas faible. Née sous la protection américaine, l’Union européenne de la défense est un piège pour la France et la fin d’une politique de puissance et d’autonomie stratégique. L’intérêt français consiste à s’éloigner de cette dépendance pour devenir cette puissance régionale souveraine et dominatrice du continent, car « les ententes entre grandes puissances se nouent toujours à l’ombre d’une rivalité relative à leur sécurité » (Mearsheimer). Une France qui se maintient dans l’OTAN, c’est une France amoindrie, dominion et qui sort de cette compétition entre États.
La France à la croisée des chemins
La grande majorité des politiques et des médias s’est focalisée sur les crimes de guerres commis par le Hamas pour se ranger du côté de l’État hébreu. Si Von der Leyen affirma que « l’Europe soutient Israël », la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braund-Pivet déclara « au nom de la représentation nationale » un « soutien inconditionnel » à Tel-Aviv. Le Président Macron, toujours si prompt au dilettantisme, et même s’il parle dorénavant de cessez-le-feu (9 novembre), avait émis l’idée de transposer à la lutte contre le Hamas, la coalition internationale mise en place en 2014 pour détruire l’État Islamique. De son côté, Éric Zemmour, en déplacement dans le pays meurtri, n’hésita pas à associer la France et Israël – qu’il qualifie d’avant-poste civilisationnel – dans le même bloc occidental « en danger de mort ».
La politique française a depuis longtemps basculé vers une position pro-israélienne, héritage d’une diplomatie résolument atlantiste, otanienne et suiviste des Américains. Pourtant, au moment de la guerre des Six Jours de 1967, la France, si elle avait toujours soutenu Israël, critiquait aussi son appétence territoriale – De Gaulle désirant proposer aux pays arabes une alliance de rechange à l’influence soviétique. Si Giscard d’Estaing (action européenne de reconnaissance de la Palestine) et Mitterrand (deux fois des forces françaises sont envoyés pour sauver la direction de l’OLP au Liban) emboîtent le pas du général, une rupture intervient avec Sarkozy. Ce dernier purge les discours officiels des mots « occupation » et « colonisation » ; et Hollande poursuit la voie de son prédécesseur – on se souvient de son « chant d’amour pour Israël et pour ses dirigeants » à l’État juif lors de sa visite d’État hébreu.
L’intérêt de la France est-il de pousser à cet affrontement de « l’Ouest et le reste », entre le Nord et un « Sud global » ? La France doit-elle continuer à inscrire son destin dans celui de l’Union européenne quand 19 pays de l’Union sur 27 refusent de soutenir une résolution équilibrée des Nations Unies, présentée par la Jordanie, demandant un cessez-le-feu humanitaire à Gaza ? Doit-elle s’aligner derrière Israël et accepter cette promotion du choc de la civilisation occidentale, dominante mais contestée, contre la civilisation musulmane ou islamique, dominée mais montante ? En tout cas, le gardien mais aussi geôlier du Vieux Continent, l’Empire Américain, après 70 ans de domination sans partage sur le monde, perd petit à petit de son hégémonie. Pour les États-Unis qui ont le regard tourné vers le Pacifique et le Proche-Orient, l’Europe ne compte plus autant qu’auparavant. Dernier exemple en date, les députés républicains du Congrès rechignent à financer la résistance de Kiev, mais soutiennent Israël, qui est un vrai partenaire stratégique et commercial.
Le narratif opposant un Occident représentant du « monde libre » contre celui de la « jungle » – selon le mot du chef de la diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell – est une bêtise caractéristique de la « géopolitique » libérale ainsi qu’une insulte pour le reste du monde. La France doit avant tout penser à sa survie ; seuls ses intérêts doivent prévaloir. L’unipolarité cédant de plus en plus à la multipolarité, Paris doit refuser l’engrenage des rivalités géopolitiques que les États-Unis et ses alliés engagent.
À l’horizon 2100, l’Allemagne va perdre 10 millions d’habitants, passant de 81 à 71, pendant que l’Hexagone la dépassera avec 74 millions d’habitants. Deux autres grands pays européens, l’Italie et l’Espagne, vont voir leur population fortement baisser – l’Espagne va passer de 46 à 36 millions d’habitants et l’Italie qui va perdre 12 millions d’habitants. Malgré des problèmes évidents (religion, type de population, pyramide des âges, etc.), ces données nous donnent à penser que la France a l’opportunité pour devenir la future grande puissance régionale européenne. Encore faut-il qu’elle s’en donne les moyens (non-alignement, politique de puissance, réindustrialisassion, maintien de sa population autochtone, politique familiale, etc.).