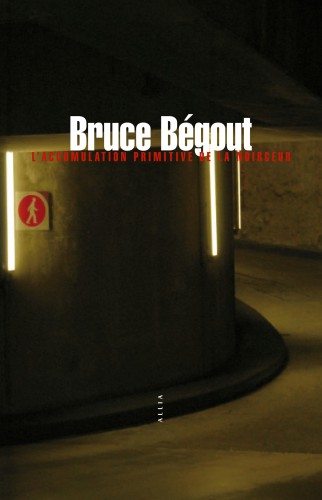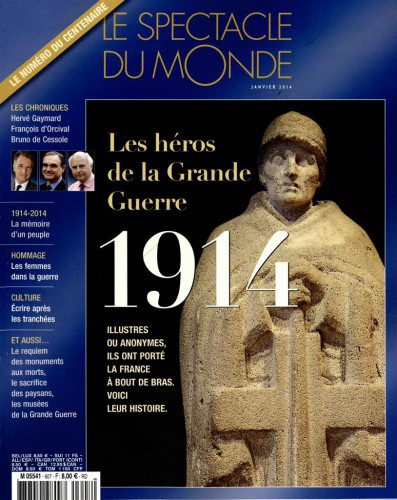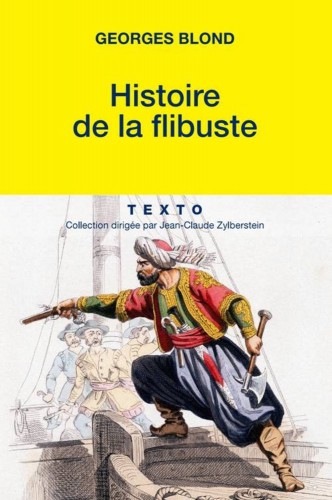Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Jean-Paul Baquiast, cueilli sur le site Europe solidaire et consacré aux révélations d'Edward Snowden sur la mise au point par la NSA d'un ordinateur quantique, véritable graal dans le domaine de la recherche en informatique...
Jean-Paul Baquiast est l'animateur du site Europe solidaire, ainsi que du remarquable site d'actualité technoscientifique Automates intelligents.

L'ordinateur quantique de la NSA
Dès janvier 2004, nous présentions en détail (1) les promesses et les difficultés de réalisation d'un ordinateur quantique pleinement développé. Nous indiquions également que, pour assurer sa cohésion et sa croissance, l'Europe, qui en a les moyens, devait s'inscrire dans cette course au Saint Graal de la science et de la technique. Il n'est pas de difficultés qui ne se résolve quand on fait l'effort nécessaire. A preuve le succès du premier homme sur la Lune, inenvisageable sérieusement au début du 20e siècle. Cet article, bien que lu par plusieurs centaines de milliers de personnes, selon nos statistique, n'avait suscité en France aucune réaction. Sans doute parce que personne n'avait la culture politico-technologique pour en comprendre la portée - encore que cette culture, ne nous vantons pas, était , comme le montre notre exemple, à la portée de presque chacun.
Aujourd'hui, dans la suite des révélations Snowden/NSA annoncée par le trio Snowden/Greenwald/ Poitras - dont certaines encore plus importantes seraient selon eux prêtes à être divulguées - on apprend que la NSA développe un tel ordinateur quantique. Or quand la NSA et derrière elle le système politico-industriel américain et celui dit de Sécurité Nationale, investissent des trillions de dollars dans un objectif, ils l'obtiennent. Preuve en est que la NSA, la CIA et autres agences de renseignement, associées aux entreprises américaines qui contrôlent le Net, disposent désormais dans leurs serveurs d'un univers de Big Data leur permettant de connaître et de cibler les activités de chacun d'entre nous. Il est vrai que cela ne leur suffisait pas. La découverte, par les gouvernements et les citoyens de ce nouveau « goulag électronique » a relancé les efforts de certains Etats et de certaines entreprises pour développer des investissements de cryptologie encore plus difficiles à « casser » que ceux aujourd'hui disponibles. (2)
Il était bien évident que la NSA et le Système de Sécurité Nationale américain n'allait pas laisser faire. Nous savions dès 2007 que la Darpa et le ministère de la Défense finançaient des recherches dans le domaine de l'ordinateur quantique, en collaboration avec la firme D.Wave. (3) Clairement, ils n'allaient pas se limiter à réaliser des ordinateurs quantiques de seulement quelques q.bit. Les révélations NSA/Snowden, qui viennent d'être documentées par le Washington Post (4) puis par toute la presse (5), montrent que l'effort est d'une toute autre ampleur, et sans doute déjà en partie couronné de succès.
Un tel outil, aux mains de la NSA, même s'il n'est pas encore complètement développé (il sera toujours perfectible) constitue déjà une menace pour le reste du monde, si du moins celui-ci veut échapper à l'emprise du Système de Sécurité Nationale américain. Non seulement il pourra ruiner tous les efforts mondiaux de cryptographie, mais il donnera à ce Système, associé au Système politico industriel, des moyens de calculs permettant d'augmenter encore leurs performances et leurs ambitions, tant dans la défense que dans les domaines spatiaux, scientifiques et technologiques. Inutile de dire que l'Europe, pour ce qui la concerne, n'aura d'autres choix que disparaitre en tant qu'entité propre, à moins d'accepter de devenir dans les domaines de faible importance stratégique un simple satellite de l'Amérique.
Les arguments de l'incompétence
Comme précédemment, les Européens et en tous cas les Français, gouvernement en tête, estimeront du haut de leur incompétence que le risque est très surestimé, voire illusoire. Un série d'arguments est déjà présentée en ce sens. Evoquons les principaux, en indiquant selon nous leur fausseté :
L'ordinateur quantique ne sera pas réalisable avec des années. On cite à cet égard les éminents spécialistes que sont Seth Loyd (6) et David Deutch (7). Répondons que ceux-ci ne sont sans doute pas informés des investissements faits récemment dans ce domaine, à coups de milliards de dollars, par la NSA. Quant à notre expert national, le Prix Nobel de physique Serge Haroche, il n'a même pas voulu répondre à notre question sur ce thème.
La NSA est en train d'être reprise en mains par Barack Obama. Il s'agit d'une illusion, comme le montrent les inquiétudes croissantes des milieux « libertariens » américains. Obama et le gouvernement fédéral ne feront rien en ce sens. Même si certaines restrictions de crédit ou d'influence étaient imposées à la NSA, elles n'atteindront en rien le coeur du système de Sécurité Nationale appuyé sur les ressources informatiques immenses accumulées. L'argument de la lutte contre le terrorisme, de toutes façons, découragera tout effort sérieux pour brider la NSA. Merci Allah.
L'Amérique partagera. L'ordinateur quantique apportera très vite de tels bénéfices, non seulement en cryptologie, mais comme évoqué plus haut dans les domaines scientifiques et technologiques, que la course à la puissance quantique, comme précédemment la course à la Lune, deviendra un enjeu si grand que toutes les forces du pays y seront consacrées, sous la protection bienveillante de l'armée et de la police. De plus, comme dans le domaine de l'Espace, le système de pouvoir américain ne partagera avec personne, même avec les prétendus proches alliés, les succès obtenus. Quant à la Russie, la Chine et les autres BRICs, elles ne doivent se faire d'illusion. Le retard accumulé ne se rattrapera pas.
Nous ne pouvons donc que souhaiter, en ce début janvier 2014, une bonne et heureuse années aux sots qui ne se rendent pas compte à quel point l'équilibre du monde est en train de changer, au bénéfice non pas de la prétendue Humanité, mais pour les seuls profits de l'étroite minorité qui contrôle cette Humanité, grâce à la puissance financière et scientifique accumulée. Les sots trouvent toujours moyen d'être heureux. Grand bien leur fasse.
Jean-Paul Baquiast (Europe solidaire, 6 janvier 2013)
Notes
1) Automates Intelligents. Pour un grand programme européen, l'ordinateur quantique.
2) Voir The Year in Crypto
3) Voir sur le site Agoravox, qui n'a pourtant guère d'ambitions scientifiques, un article de février 2007.
4) Voir Washington Post.
5) Voir Le Figaro.
6) Automates Intelligents. Seth Loys, Programing the Universe.
7) Automates Intelligents David Deutch The Beginning on Infinity.