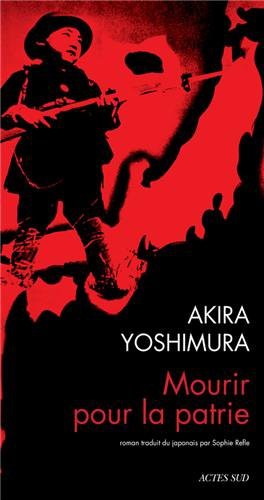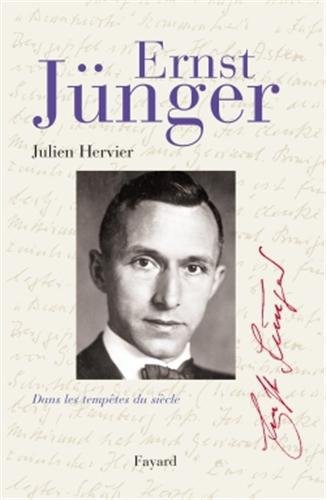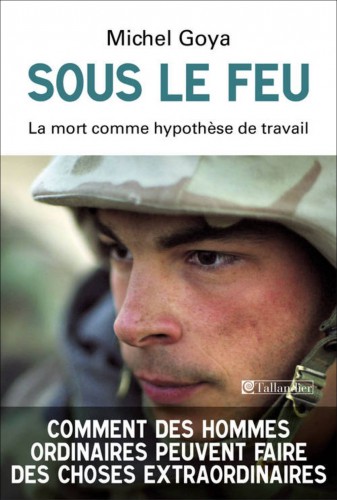Le changement de la guerre
Cinq drones supplémentaires Falco seront opérationnels début avril en Afrique pour l'observation militaire dans la région des grands lacs où se sont repliés les ex-rebelles du Nord-Kivu, aux confins orientaux de la République démocratique du Congo (RDC). Capables d'opérer , de jour comme de nuit, de voler à 14.000 pieds (4.200 m), de tenir 12 heures en l'air, les drones sont devenus de véritables multiplicateurs de force. Ces drones seront non armés car ils participeront à la force de paix onusienne au Congo, au Soudan du Sud, où 7 500 casques bleus sont débordés par la guerre civile et en République centrafricaine où tout indique qu'une mission onusienne devrait remplacer, au printemps prochain, les forces africaines de la Misca. Les frais d'exploitation de ces cinq drones semblent plus que raisonnables: 15 millions de dollars pour cinq aérodynes et leur maintenance. Mais les drones sont loin d'être pacifiques !
Le Washington Post a rapporté que les frappes de drones au Pakistan ont été "nettement réduites" à la demande du gouvernement pakistanais pendant que celui-ci poursuit des pourparlers de paix avec les Talibans. Le gouvernement américain a précisé qu’il continuerait d'effectuer des frappes contre des cibles d’Al-Qaïda. Pendant ce temps, les frappes de drones ont continué au Yémen où un missile tiré sur un convoi de mariage a tué 11 personnes au mois de décembre.
C'est le 23 janvier 2009 que le président Barack Obama autorisait sa première frappe de drone. L’attaque, lancée contre un camp au nord-ouest du Pakistan, tua entre 7 et 15 personnes mais manqua le repaire Taliban que la CIA pensait alors viser. Au cours des cinq années suivantes, la CIA a effectué plus de 390 frappes de drone connues au Pakistan, au Yémen et en Somalie. (L’Agence a effectué 51 frappes de drone entre 2004 et 2009, durant l’administration Bush.) Il y a donc bien une montée en puissance spectaculaire de ce genre d'attaques. Obama y a même fait une brève référence dans son discours de janvier 2014 sur l’Etat de l’Union, assurant le Congrès qu'il avait imposé ''des limites prudentes sur l’usage des drones''.
Ce n’est pas la première fois que le président américain reconnait la nécessité d’une politique plus claire sur les bombardements par drones interposés, nouvelle forme de la guerre moderne et de l'interventionnisme américain appelée dans le jargon militaire la ''force létale''. En mai dernier, Obama faisait remarquer à l’Université de Défense nationale que "cette nouvelle technologie soulève de lourdes questions, à propos de qui est ciblé, et pourquoi". Les réponses fournies depuis restent toujours vagues. Effectivement, qui est réellement ciblé ?
Selon l’administration Obama, la force létale ne peut être utilisée que contre "Al-Qaïda et ses groupes affiliés". Or, officiellement, le gouvernement américain n’a identifié publiquement aucun groupe affilié à Al-Qaïda en dehors des Talibans ! L’examen des rapports des renseignements étasuniens couvrant la plupart des frappes de drone au Pakistan entre 2006 et 2008 et entre 2010 et 2011, montre que "les opérateurs de drone n’étaient pas toujours certains de qui ils tuaient, malgré les garanties du gouvernement sur l’exactitude des renseignements de ciblage de la CIA". Plus de la moitié des 482 personnes tuées entre septembre 2010 et septembre 2011 n’étaient pas des hauts dirigeants d’Al-Qaïda, mais furent "évalués" comme des extrémistes afghans, pakistanais ou inconnus. En fait, les drones n’ont tué que six hauts dirigeants d’Al-Qaïda au cours de ces mois-là. La ''force létale'' implique pour son usage "une menace imminente et continue envers des ressortissants étasuniens" mais les recommandations militaires du Pentagone précisent que les États-Unis doivent toujours être capables "d’agir en légitime défense dans des circonstances où il y a des éléments d’attaques supplémentaires imminentes, même s’il n’y a pas d’éléments spécifiques sur le lieu d’une telle attaque ou sur la nature précise de l’attaque." Cette très large définition - c'est le moins qu'on puisse dire ! - semble donc permettre à l’administration Obama de frapper n’importe quand. En dehors d’une liste de cibles à éliminer, un élément clé de la guerre des drones est aussi l’utilisation américaine des fameuses ''signature strikes'' — attaques autorisées contre des cibles affichant une "signature" terroriste, telle que "des camps d’entraînement et des enceintes suspectes". Le gouvernement américain a refusé jusqu'alors de reconnaître l’utilisation de ces "signature strikes" ou d’en discuter les justifications légales. La CIA déclare qu'elle ne dévoile pas les critères qu’elle emploie pour identifier une "signature" terroriste et nous la comprenons : il est particulièrement difficile de le faire par exemple au nord-ouest du Pakistan, où les militants et les civils peuvent s’habiller de la même manière, et où il est coutumier de porter publiquement une arme.
Les Commissions du Congrès sur le renseignement surveillent le programme de drone. Cependant, leurs capacités à établir des limites sont sévèrement restreintes car le programme de la ''force létale'' est totalement classifié secret défense. Le gouvernement américain a systématiquement refusé de répondre aux demandes d’informations complémentaires de la part des législateurs. Par exemple, depuis 2011, 21 demandes de membres du Congrès sollicitant l’accès aux mémorandums du Bureau du conseil juridique qui fournissent les bases légales de l'usage des drones ont été refusées. Les ''frappes létales'' ne peuvent être réalisées seulement qu'avec "la quasi certitude que des non-combattants ne seront pas blessés ou tués". Cependant, les militaires américains comptent tous les individus masculins d’âge militaire tués par drones comme des militants. Le Bureau of Investigative Journalism estimait que le nombre total de victimes civiles depuis 2004 au seul Pakistan était passé de 416 à 951. Puis, se pose aussi la question de la frappe par des drones de citoyens américains.
En septembre 2011, Anwar Al-Awlaki, un pasteur né aux États-Unis et donc citoyen américain a été tué lors d’une frappe de drone au Yémen. Un mémo secret du département de la Justice a fourni la justification légale pour cibler un citoyen étasunien. Le mémo, obtenu par NBC News, estimait qu’il était légal d’utiliser la force létale dans un pays étranger contre un citoyen étasunien qui est un haut dirigeant d’Al-Qaïda ou d’un groupe affilié si un haut représentant a déterminé que l’individu posait une menace imminente, que sa capture était impossible, et que l’opération était compatible avec les lois de la guerre. Le mémo note que de tels assassinats de citoyens étasuniens sont justifiés à condition que les victimes civiles ne soient pas "excessives". Le fils de 16 ans d’Al-Awlaki, Abdulrahman al-Awalki, également citoyen étasunien, a été tué dans une frappe séparée deux semaines plus tard. Lorsqu’il fut interrogé sur les justifications légales de sa mort, Robert Gibbs, conseiller d’Obama et ancien porte-parole de la Maison Blanche, a répondu qu’Abdulrahman al-Awlaki "aurait dû avoir un père beaucoup plus responsable".
En fait, de manière générale, les drones ont étendu la fluidité et l'indistinction au monde de la guerre. En somme, au Pakistan ou au Yémen, en Somalie ou au Sahel et demain dans la région stratégique des grands lacs, n'importe qui peut être attaqué par un drone, n'importe où et n'importe quand. Or, cette fluidité accélère le processus d'éparpillement des combattants. En fait, les attaques de drones amplifient la création de foyers de terrorisme diversifiés et autonomes, la dilution de la guerre, loin de toute stratégie clausewitzienne de concentration des forces. Le nouveau drone britannique de combat spectaculaire sélectionnera demain quasi automatiquement et de manière autonome ses cibles. Ce sera en fait le premier avion de chasse robot. Enfin, parce que les médias sans doute ne nous le diront pas, il faut savoir qu'à huis clos, le Congrès américain vient de voter l’autorisation d’armer de ''force létale'' Al Nosra (Al Quaïda) en Syrie. Là encore, on notera la double fonction permanente et militaire d'Al Qaeda : à la fois, épouvantail et en même temps, collaborateur, plus ou moins conscient, plus ou moins instrumentalisé par le service de l'intendance des armuriers américains.
Michel Lhomme (Metamag, 13 février 2014)