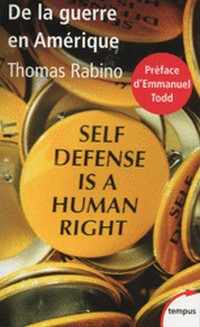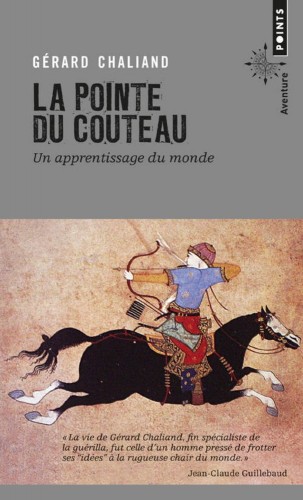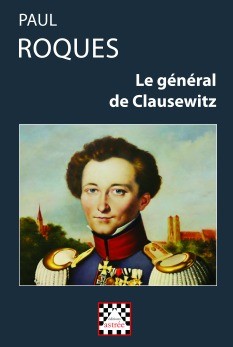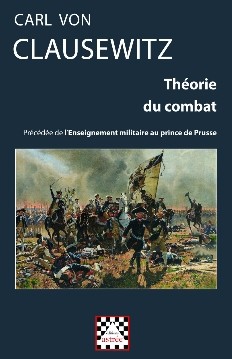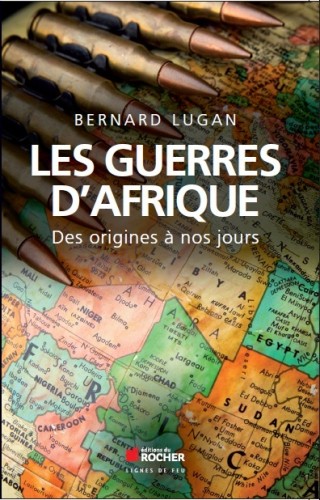Les éditions du Rocher publient cette semaine Les guerres de l'Afrique, le nouveau livre de Bernard Lugan. Historien, africaniste de terrain et universitaire, Bernard Lugan est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment d'une monumentale Histoire de l'Afrique, des origines jusqu'à nos jours (Ellipses, 2009), d'une Histoire de l'Afrique du sud (Ellipses, 2010), et d'une Histoire du Rwanda (Bartillat, 1999). Il a aussi publé récemment un essai tonique intitulé Décolonisez l'Afrique (Ellipse, 2011).
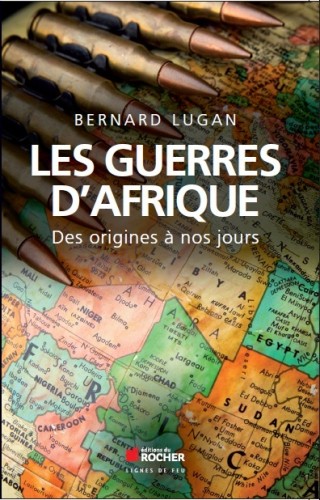
" Le long déroulé de l’histoire du continent africain est rythmé par une succession de guerres. Les plus anciennes sont figurées sur les parois peintes du Sahara et de l’Afrique australe ; les plus récentes font l’actualité, de la Libye au Kivu et de la Somalie au Mali.
Dans l’Afrique d’ « avant les Blancs », la guerre entraîna la mutation de nombre de sociétés et fut créatrice d’empires, dont ceux d’el Hadj Omar, de Samory, de Rabah, de Shaka Zulu etc.,).
Avec la conquête coloniale, à l’exception de l’échec italien en Ethiopie, les guerres tournèrent toutes à l’avantage des colonisateurs, même si, ici ou là, des batailles retardatrices dont le livre rend compte, furent occasionnellement remportées par les Africains.
La parenthèse impériale fut ensuite refermée sans affrontements majeurs, les guérillas nationalistes n’y étant jamais en mesure de l’emporter sur le terrain.
Après les indépendances, l’Afrique fut ravagée par de multiples confits qui firent des millions de morts et des dizaines de millions de déplacés.
Après la « guerre froide », l’Afrique redevint l’actrice de ses propres guerres, donc de sa propre histoire. Les placages idéologiques et politiques qui lui avaient été imposés depuis des décennies volèrent alors en éclats et le continent s’embrasa. Durant la décennie 2000-2010, 70% des décisions de l’ONU et 45% des séances du Conseil de Sécurité furent consacrées aux conflits africains. "