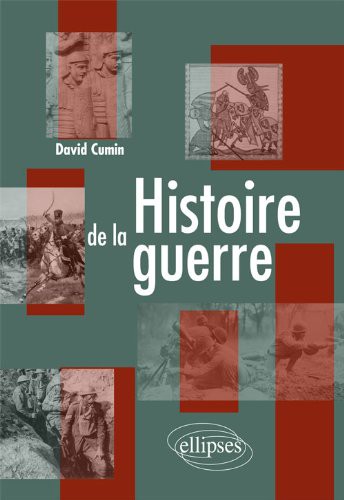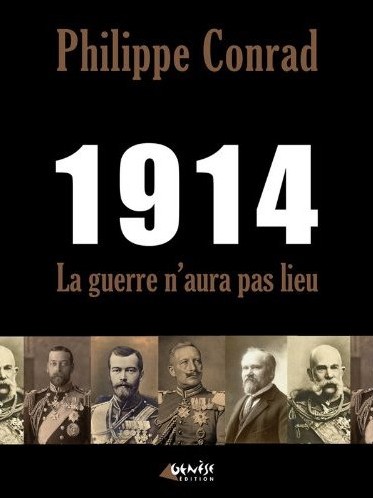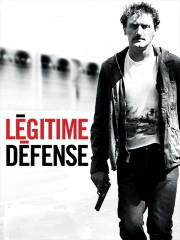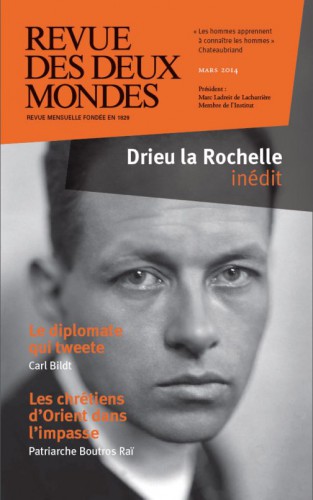Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Robert Redeker, cueilli sur Iphilo et consacré à la place du soldat dans la société d'aujourd'hui. Professeur de philosophie, Robert Redeker vient de publier un essai intitulé Le soldat impossible (Pierre-Guillaume de Roux, 2014).

Vivons nous les temps de la fin du soldat ?
Le soldat ne fait plus rêver, il n’est plus un modèle pour la jeunesse. Notre époque – dans ce cap de l’Asie qu’est l’extrême ouest européen – se singularise par rapport à toutes les autres époques et à la plupart des civilisations par ce trait : le soldat n’y occupe plus une place centrale, sacrée, vénérable, dans l’imaginaire collectif. Il n’est plus objet de désir. Plus personne n’écrirait comme Hugo : « J’aurais été soldat si je n’avais été poète ». Les familles ne souhaitent plus la carrière des armes pour leurs fils : le prestige de l’uniforme s’est fané, la nation et la patrie sont désaimées, la relation au sacrifice et à la mort s’est radicalement reconfigurée au cours des dernières décennies. Au-delà de la fin du soldat, nous vivons les temps du soldat impossible.
Qui se met en quête des raisons de cette désaffection rencontrera l’assomption des valeurs féminines, le règne symbolique de la femme dans l’univers occidental, la pathologie de la repentance et la maladive honte d’être soi qui placent l’Europe, et tout singulièrement la France, dans le mouroir de l’Histoire, sans oublier l’ombre portée du nazisme. Le nazisme a eu pour effet à long terme de rendre la guerre, les armées, les valeurs guerrières, les drapeaux et les uniformes insupportables. La reductio ad hitlerum que fustigeait Leo Strauss touche bien plus que les arguments : elle délégitime les choses, en particulier la chose militaire. C’est pourtant la guerre, et non le pacifisme, qui a triomphé du nazisme ! Ruse de l’Histoire : le pacifisme, qui n’a lutté ni contre le nazisme ni contre le stalinisme, pourrait remercier le nazisme d’avoir dévalorisé à son insu la guerre.
Le soldat a été tué par le mot de passe et passe-partout contemporain : les valeurs. Quand le sens s’est enfui, quand toute morale s’est évanouie, quand principes et fins sont tombés en décrépitude, le concept de valeur s’impose pour masquer le vide. Quand plus rien ne vaut, on ne parle plus que de valeurs ! Le soldat tuait et mourait pour des objets d’amour, auxquels il se donnait à la vie à la mort, éperdument : la France, la nation, la patrie, l’Empereur, le roi. Il est à remarquer qu’il s’agit là d’êtres, certes fictifs, et non de valeurs, c’est-à-dire d’idées. Aujourd’hui on propose au soldat, à cette fonction qui porte encore ce nom, de se battre pour les droits de l’homme, la démocratie, l’humanitaire, bref on fait de lui un militant. Le soldat a été remplacé par le militant armé des droits de l’homme. Par quoi la nation et la patrie ont-elles été remplacées ? Par des valeurs. Par des idéologies.
Les valeurs sont synchroniques quand les êtres comme la nation et la patrie sont diachroniques. La nation s’enracine à la fois dans le passé et dans la terre, sans manquer de dessiner un avenir. Sa dimension charnelle, elle dont la peau des hommes et les rides de la terre sont la chair, ne doit échapper à personne. Le discours sur les valeurs – on réécrit l’Histoire en clamant que les soldats de 14 et ceux de la guerre de la guerre d’Algérie sont morts pour des valeurs, alors qu’ils sont morts pour la France – exprime le présentisme, l’enfermement dans la prison du présent, dans la mesure où il refuse de regarder la dimension diachronique de l’engagement militaire. Il est un bâillon posé sur l’âme du soldat autant que sur celle de la nation, leur imposant le discours de l’idéologie : vous vous battez pour des idées, pas pour la France. Ainsi, cette substitution de la valeur à la nation rend-elle compte d’un abandon du passé, d’un délaissement qui ne parvient pas à masquer un rejet.
La fin du soldat, son remplacement par un militant armé d’Etat et en uniforme, s’inscrit dans une pathologie sociale plus large : le rejet de l’héritage. Le soldat est désaimé, le soldat est méprisé, le soldat est marginalisé, parce que son uniforme rappelle le temps long et ses exigences. Un instant, brigands de pensée, volons un mot à Renaud Camus, celui d’inhéritier. L’Armée et l’Ecole sont deux institutions sœurs, les deux institutions d’héritage ; le soldat et le professeur sont frères parce que tous deux ils sont des passeurs d’héritage ; la crise de l’Armée et la crise de l’Ecole sont la même crise, peut-être mortelle, issue des tentatives d’utiliser ces institutions à la fabrication d’hommes tout opposés à ceux qu’elles étaient supposées engendrer : des inhéritiers.
Les mots restent, les choses qu’ils recouvrent changent donnant l’illusion de la permanence. Penser le soldat est, du côté des philosophes, chose encore plus rare que penser la guerre. Pourtant, rien n’éclaire autant sur les mutations des sociétés présentes, sur leurs dérives pathologiques, sur les transformations des régimes d’anthropofacture (de fabrication des hommes), que l’application à la chose guerrière du concept de valeur, que le remplacement du soldat par le militant des droits de l’homme, que la fabrication des inhéritiers, que le dispositif imaginaire qui rend le soldat impossible.
Robert Redeker (Iphilo, 4 mars 2014)