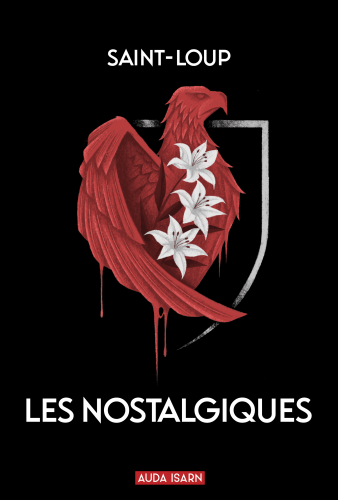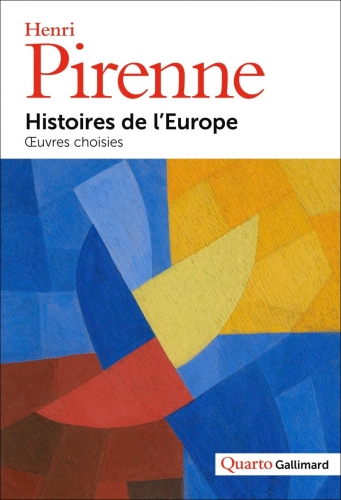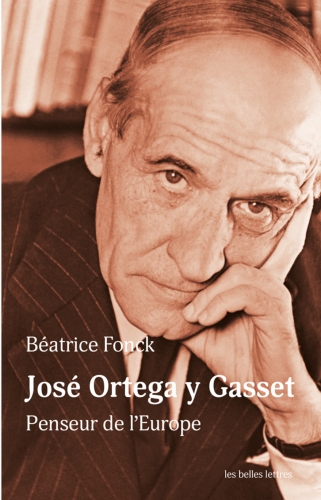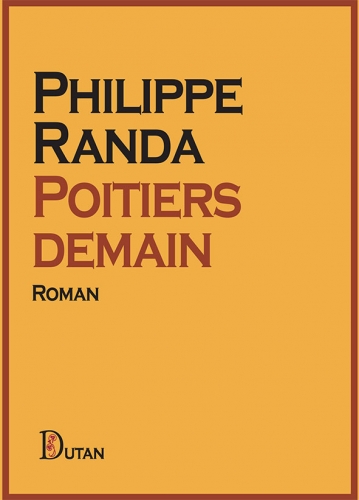Immigration. Blocus naval militaire, bombardements des passeurs, sortie des traités internationaux, abandon de Lampedusa..oui, il y a des solutions pour empêcher l’invasion migratoire
A entendre la presse gauchiste mainstream ces derniers jours, l’immigration serait une fatalité. Impossible en endiguer. Il faut régulariser tous les migrants. Il faut ouvrir les frontières et laisser des millions d’Africains venir se partager notre territoire. C’est comme ça. Vous n’avez plus votre mot à dire bien que cela fasse 50 ans que vous votiez contre l’immigration sans être écouté par vos élus.
Et bien si pourtant, il y a des solutions simples contre l’immigration
Premièrement, plutôt que d’envoyer des soldats français mourir aux quatre coins du monde pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres, il faut déployer l’armée en mer, pour faire un blocus militaire européen en Méditerranée. Plus de possibilité pour la moindre embarcation de passer, retour en Afrique ou au Proche-Orient pour tous ceux qui tentent. Neutralisation de tous les navires appartenant aux ONG complices de l’immigration ? Et le droit là dessus ? C’est très simple. Il faut supprimer les traités internationaux. Et construire une Europe débarrassée des textes qui entendent l’asservir. Nous ne sommes plus en 1945 ni en 1970, nous sommes en 2023. Et nous sommes envahis. Blocus naval donc, et frappes massives visant à détruire toute l’ossature constituée par les passeurs. Des frappes, et des envois de forces spéciales pour éliminer physiquement ceux qui participent à la traite d’êtres humains.
Deuxièmement, il faut couper immédiatement toutes les aides financières pour les pays africains qui refusent de reconnaitre leurs ressortissants, et de les récupérer dans leur pays d’origine. Toutes les aides pour ceux qui incitent au départ de leurs pays plutôt qu’à la construction et au développement sur place. Il faut rendre son indépendance totale et définitive à l’Afrique, et la laisser se développer à son rythme, en coupant tous les ponts qui nous lient ou nous liaient à elle. Tout comme il faut inciter financièrement tous les africains présents en Europe à retourner sur la terre de leurs ancêtres pour la développer.
Ce n’est pas une question d’être intégré, de travailler. C’est une question de vivre ensemble. Les masses culturelles différentes ne peuvent plus vivre ensemble, massivement. Sinon, demain, c’est la guerre civile et le chaos, dont on voit poindre les bribes à l’horizon, au coeur même de nos sociétés.
Quid troisièmement d’abandonner Lampedusa, Ceuta, Melilla, ces petits bouts de territoires d’Europe sur lesquels se jettent les migrants d’Afrique ? Si ces territoires ne faisaient plus partie de l’UE, alors les traversées deviendraient encore plus compliquées et demanderaient d’autres types de logistiques.
Ce n’est pas, par ailleurs, parce que Madame Meloni semble pieds et poings liés (qui la menace ? De qui dépend-elle aujourd’hui ? Qui fait pression ?) que d’autres dirigeants européens ne peuvent pas agir. Il faut raser une bonne partie des accords, des traités, qui ont été signés dans l’Union Européenne, et construire une autre Europe, celle des peuples autochtones qui la composent. Et qui demandent instamment à leurs dirigeants, pour le moment encore plutôt gentiment, d’en finir immédiatement avec l’immigration. Et à la presse qu’ils financent de cesser de les faire passer pour des monstres inhumains qui ne veulent pas accueillir la misère.
Les Européens n’arrivent plus à se chauffer. A remplir leurs caddies. A se loger. Ils ne sont plus en sécurité dans les métropoles d’Europe de l’Ouest. Ils voient leur niveau de vie s’effondrer du jour au lendemain et leur sécurité sanitaire de moins en moins assurée. Ils constatent l’effondrement civilisationnel jour après jour. Ils sont au bord de la révolte. En raison de l’aveuglement (ou de l’idéologie) de leurs dirigeants.
Nous n’avons pas le temps de nous occuper du sort des migrants qui prennent la Mer en sachant parfaitement ce qu’ils risquent. La santé, la sécurité, la prospérité des autochtones d’Europe nous est plus importante, elle est prioritaire. Rien d’autre ne compte. Demi tour. Blocus. Liquidation des passeurs. Pression sur les pays d’origine. Et retour de l’Europe puissance, pas de l’Europe tiers monde qui est en train de se construire sous nos yeux.
Du courage en politique.
Julien Dir (Breizh-Info, 19 septembre 2023)