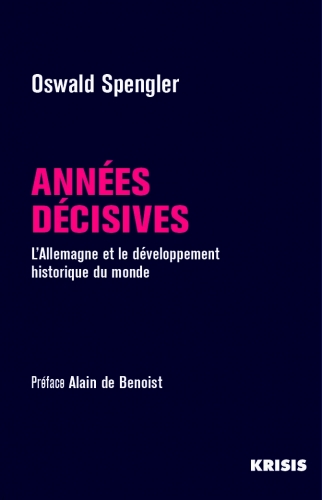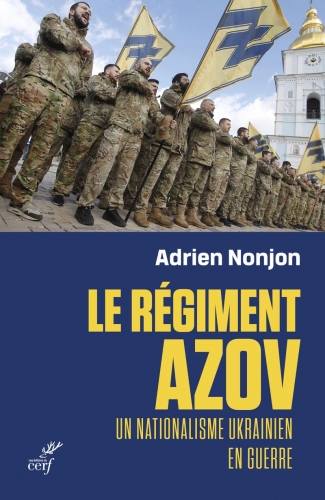Relations Europe / Etats-Unis : de l’alignement stratégique au « découplage » économique
Sur le dossier ukrainien, l’Union Européenne (UE), après quelques velléités de discours nuancé, a vite endossé les raisonnements et la stratégie des Américains ; au Moyen-Orient, après quelques ratages matamores d’Ursula von der Leyen, l’Europe s’est vite retirée du jeu, laissant les Etats-Unis seuls à essayer de calmer les ardeurs guerrières des uns et des autres ; en Afrique, après le départ des troupes françaises, l’Europe n’a plus guère d’influence et s’en remet aux Etats-Unis pour tenter de réduire les tensions internes et contrecarrer les immixtions russes ou chinoises. L’énumération pourrait continuer, et montre que, sur le plan géopolitique, l’UE, tout en revendiquant haut et fort son « autonomie stratégique », s’est totalement alignée sur les Etats-Unis, leader incontesté du « camp occidental ». Ce n’est bien sûr pas nouveau, voilà longtemps que l’Europe confie sa sécurité à une OTAN contrôlée par les Etats-Unis et accepte que ces derniers, grâce à l’extraterritorialité de leur droit, dressent la liste des pays avec lesquels elle-même a ou n’a pas le droit de commercer.
Dans le domaine économique le contraste est au contraire flagrant entre des Etats-Unis qui connaissent une belle prospérité et une Europe qui essaie difficilement d’éviter une récession. Alors que le PIB des premiers a cru de 2,5 % en 2023, celui de la zone euro a stagné (1) et l’écart continuera à s’accroître en 2024 puisqu’on prévoit des augmentations de, respectivement, 2,1 % et 0,8 %. Le chômage a été ramené à 3,5 % aux USA mais à 6,5 % dans la zone euro (7,5 % en France). L’inflation, aujourd’hui, à peu près identique dans les deux zones, est montée aux USA à 6 % mais à près de 9 % en Europe. Au total, le PIB aura augmenté, depuis 2013, de 17 % dans la zone euro mais de 54 %, soit plus du triple, aux USA ; en conséquence le PIB des USA, qui excédait alors celui de la zone euro de 32 %, le dépasse aujourd’hui de 74 % : l’écart a plus que doublé (2).
Bien sûr les causes de cette divergence, de ce « découplage » (3), sont multiples. Depuis 2002 la productivité par tête a cru de 43 % aux USA mais de seulement 10 % dans la zone euro. Les Américains, attirés par l’innovation et les ruptures technologiques, acceptent de prendre des risques et trouvent aisément les financements pour leurs projets novateurs ; les Européens, au contraire, font preuve d’un conformisme technologique, financier et social peu propice aux initiatives susceptibles de générer des gains de productivité. Rien d’étonnant, par conséquent, à ce que les investissements dans les nouvelles technologies, les dépenses pour la recherche & le développement et le nombre de brevets déposés soient bien supérieurs aux USA qu’en UE, que les magnificient seven (4) américaines n’aient pas d’équivalentes en Europe ou que l’IA générative et le new space aient prospérés plus vite de l’autre côté de l’Atlantique.
Mais les décisions prises par l’Europe après le déclenchement du conflit en Ukraine expliquent aussi ce « découplage ». En obligeant les entreprises européennes à se retirer de Russie, où elles étaient bien plus nombreuses que les américaines, et en leur interdisant, par des « paquets » successifs de sanctions dont l’efficacité reste à démontrer, de commercer avec ce pays, l’UE leur a imposé des charges considérables dont le financement aurait pu être consacré à des investissements d’avenir et à la transition climatique. Les entreprises européennes ont dû, pour leur approvisionnement en gaz, remplacer la Russie par les Etats-Unis auxquels elles ont multiplié par trois leurs achats, faisant d’eux le premier exportateur mondial de GNL (5) ; elles ont de surcroît dû accepter que ce gaz leur soit vendu à des prix nettement supérieurs à ceux du marché intérieur américain, et de ce fait ont dû affronter la concurrence de leurs homologues en payant leur énergie trois fois plus cher. Compte tenu de l’absurde politique énergétique menée précédemment par l’UE sur la pression de l’Allemagne, reposant sur un mix gaz/ENR (6) excluant le nucléaire, ce bouleversement du mode d’approvisionnement en énergie a contribué fortement à aviver les tensions inflationnistes et dégrader la croissance en Europe. Par ailleurs, les Etats européens ont engagé une politique de réarmement mais la plupart d’entre eux ont préféré acheter du matériel américain plutôt qu’européen (et particulièrement français). Au total, les décisions prises par l’UE et ses membres ont pesé négativement sur les entreprises européennes et positivement sur les entreprises américaines.
Les différences entre les politiques climatiques menées des deux côtés de l’Atlantique sont également frappantes. Alors que les USA cherchent à favoriser les technologies nouvelles susceptibles de contribuer à terme à la décarbonation de l’économie, l’Europe préfère agir en imposant des interdictions ou contraintes d’usage réduisant le recours aux énergies carbonées. Elle en détermine le calendrier d’application sans se préoccuper de savoir si elle dispose en interne des technologies alternatives, ce qui fait dire à certains (7) que les grands plans européens pourraient s’appeler Buy China Act. Elle pousse le paradoxe jusqu’à présenter son « excellence normative » comme un instrument de soft power. La comparaison entre les grands plans gouvernementaux (IRA (8) et Chips Act (9) aux Etats-Unis, Fit for 55, Green Deal et Net Zero Industry Act (10) en Europe) est éclairante. Les premiers sont décidés rapidement par une administration réactive alors que les seconds ne voient le jour qu’après un délai de prise de conscience, de fastidieuses concertations avec les groupes de pression et la « société civile » et enfin de longues procédures entre les Etats et les instances communautaires du Trilogue. Les dispositifs américains privilégient des aides financières rapides à mobiliser, en particulier les crédits d’impôt, alors que les européens préfèrent l’octroi de subventions qui nécessitent un long processus bureaucratique, l’accord de nombreuses instances puis la mise à disposition de fonds budgétaires dont on connaît la rigidité des procédures. La pression mise en Europe par les pouvoirs publics surprend compte tenu de ce que l’UE n’est à l’origine que de 6,7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (11) (les USA de 11,2 %) et les diminue d’environ 1,5 % en moyenne par an (les USA de 0,4 %) (12).
Le « découplage » économique entre les Etats-Unis et l’Europe est donc important. Est-il possible qu’à l’avenir l’écart se stabilise, voire se réduise ? La prospérité des USA recèle une fragilité bien connue : le déficit public. Mais cette fragilité n’est pas propre aux Américains. La planète entière, et particulièrement l’Europe, n’a fait face aux crises économiques récentes qu’en s’endettant massivement, grâce à la politique de quantitative easing menée par les banques centrales, la FED américaine comme la BCE européenne. Surtout, si la dette américaine est plus importante que celle de la zone euro (123 % du PIB contre 90 %) (13), le Trésor américain n’a aucune difficulté à se financer sur les marchés mondiaux parce que le dollar reste la seule monnaie de réserve mondiale ; le mouvement de « dédollarisation » est encore limité et ne profite pas à l’Euro, dont la part dans les réserves des banques centrales varie peu, mais à l’or, dont les banques centrales sont acheteuses nettes depuis 2010.
Les menaces les plus importantes pèsent autant sur l’Europe que sur les Etats-Unis. Les montagnes de dettes qui conditionnent la prospérité économique de la planète peuvent à tout moment transformer la défaillance d’un acteur économique mineur en crise systémique mondiale. Rien ne garantit qu’on parviendra à maîtriser les conflits en cours, aujourd’hui en Ukraine ou au Moyen Orient, peut-être demain en Asie, susceptibles de s’étendre et de dégénérer, mettant en péril l’économie mondiale. La façon dont les pays gèrent le changement climatique relève davantage de l’affichage à court terme que de la volonté d’affronter réellement les défis à relever.
Cependant se pose pour les Etats-Unis une question spécifique : leur futur président sera-t-il en mesure de gérer les crises déjà ouvertes et les nouvelles qui surviendront ? Pourra-t-il sauvegarder les conditions de la prospérité économique actuelle des Etats-Unis ? L’on ne peut qu’être inquiets, compte tenu de l’âge et de la personnalité des candidats probables.
Jean-Philippe Duranthon (Geopragma, 19 février 2024)
Notes :
1. En rythme annualisé la croissance américaine a été de 3,3 % au dernier trimestre 2023 et la croissance européenne nulle. Le Royaume-Uni est officiellement entré en récession, l’Allemagne ne l’a évitée que de justesse.
2. Source : FMI reprise dans https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal
3. Le terme a plusieurs acceptions. On l’utilise ici pour illustrer le fait que les deux membres du « couple » formé par l’Europe et les Etats-Unis ont des évolutions économiques très différentes, voire divergentes.
4. Appellation ironique, utilisant le titre originel du film Les sept mercenaires pour parler des Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla, qui tirent la croissance aux USA.
5. Gaz naturel liquéfié.
6. Energies renouvelables.
7. Christian Saint-Etienne et Philippe Villin : https://www.lefigaro.fr/vox/economie/les-agriculteurs-sont-les-lanceurs-d-alerte-sur-le-declin-auto-impose-de-l-europe-20240204
8. Inflation Reduction Act. Voir mon billet du 5 février 2023 : https://geopragma.fr/ce-que-lira-nous-dit/
9. Crédit d’impôt en cas d’implantation aux USA d’usines de semi-conducteurs.
10. Procédures accélérées pour l’octroi de subventions intéressant les technologies vertes produites en Europe.
11. La France 0,8 %.
12. https://www.touteleurope.eu/environnement/union-europeenne-chine-etats-unis-qui-emet-le-plus-de-gaz-a- effet-de-serre/
13. Mais 112 % pour la France.