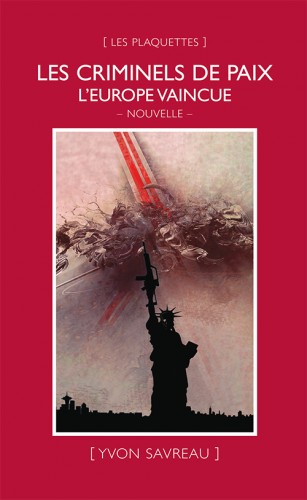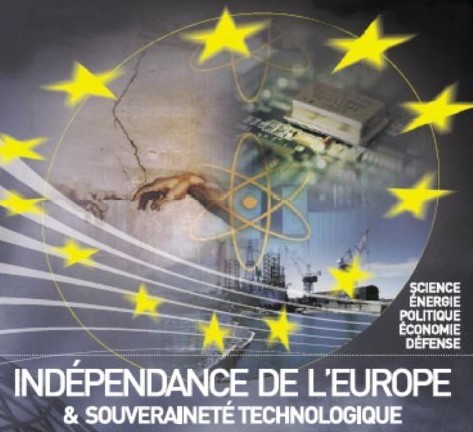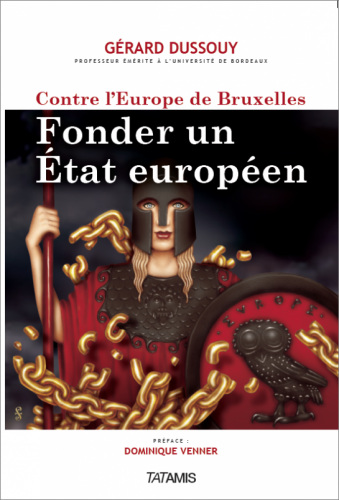L'Europe au bord du gouffre
Alors que la Russie semble avoir trouvé en mars un nouveau souffle, la zone Euro quant à elle s’enfonce dans la crise. Le chômage a atteint les 12% de la population active, mais avec des pointes à plus de 25% en Espagne et en Grèce. L’activité continue de régresser en Espagne, Italie et Portugal et, désormais, c’est la consommation qui flanche en France, annonçant une nouvelle détérioration de la situation économique à court terme. En effet, deuxième pays de la zone Euro, la France, par la vigueur de sa consommation avait jusqu’à ces derniers mois, évité le pire pour la zone Euro. Si la consommation française continue de se contracter sur le rythme qu’elle suit depuis le mois de janvier, les conséquences seront importantes, tant en France que dans les pays voisins, et en premier lieu en Italie et en Espagne.
Cette détérioration générale de la situation économique pose ouvertement le problème de l’austérité adoptée par l’ensemble des pays depuis 2011, à la suite de la Grèce puis du Portugal et de l’Espagne. Mais, la volonté allemande de poursuivre dans la voie de cette politique est indéniable. Pourquoi un tel entêtement ?
La zone euro rapporte à l’Allemagne environ 3 points de PIB par an, que ce soit par le biais de l’excédent commercial, qui est réalisé à 60% au détriment de ses partenaires de la zone Euro ou par le biais des effets induits par les exportations. On peut parfaitement comprendre que, dans ses conditions, l’Allemagne tienne à l’existence de la zone Euro. Or, si Berlin voulait que la zone euro fonctionne, elle devrait accepter le passage à un fédéralisme budgétaire étendu et à une Union de transfert. C’est une évidence connue par les économistes, mais aussi au-delà. Au mois d’octobre 2012, dans le cadre du Club Valdaï, le Président Vladimir Poutine avait souligné que l’on ne pouvait pas faire fonctionner une union monétaire sur des pays aussi hétérogènes sans un puissant fédéralisme budgétaire. Mais, si l’Allemagne devait accepter ce fédéralise, elle devrait alors accepter en conséquence de transférer une partie importante de sa richesse vers ses partenaires. Rien que pour l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal, les transferts nécessaires à la remise à niveau de ces économies par rapport à l’Allemagne et la France représenteraient entre 245 et 260 milliards d’euros, soit entre 8 et 10 points de PIB par an et ce pour au moins dix ans. Des montants de ce niveau sont absolument exorbitants. L’Allemagne n’a pas les moyens de payer une telle somme sans mettre en péril son modèle économique et détruire son système de retraite. Elle souhaite donc conserver les avantages de la zone euro mais sans en payer le prix. C’est pourquoi elle a toujours, en réalité, refusé l’idée d’une « Union de transferts ». Au-delà, le problème n’est pas tant ce que l’Allemagne « veut » ou « ne veut pas » ; c’est ce qu’elle peut supporter qui importe. Et elle ne peut supporter un prélèvement de 8% à 10 de sa richesse. Cessons donc de penser que « l’Allemagne paiera », vieille antienne de la politique française qui date du traité de Versailles en 1919, et regardons la réalité en face.
L’Allemagne a d’ores et déjà des réticences importantes sur l’Union bancaire, qu’elle avait acceptée à contre-cœur à l’automne 2012. Par la voix de son ministre des Finances, elle vient de déclarer qu’elle considérait qu’il faudrait modifier les traités existants pour que cette Union bancaire puisse voir le jour. Il est certes possible de modifier les textes fondateurs, mais tout le monde est conscient que cela prendra du temps. Autrement dit, l’Allemagne repousse en 2015 et plus probablement en 2016 l’entrée en vigueur de l’Union bancaire dont elle a de plus largement réduit le périmètre. On peut considérer que les arguments de l’Allemagne sur la « constitutionnalité » de l’Union Bancaire sont des prétextes. C’est peut-être le cas, mais Madame Merkel a quelques bonnes raisons de vouloir s’assurer de la parfaite légalité des textes.La création récente du nouveau parti eurosceptique « Alternative pour l’Allemagne », un parti que les sondages mettent actuellement à 24% des intentions de vote, constitue une menace crédible pour les équilibres politiques en Allemagne.
Dans ces conditions, on comprend bien qu’il n’y a pas d’autre choix pour l’Allemagne que de défendre une politique d’austérité pour la zone Euro, en dépit des conséquences économiques et sociales absolument catastrophiques que cette politique engendre. Tous les pays, les uns après les autres, se lancent dans des politiques suicidaires de dévaluation interne, politiques qui sont les équivalents des politiques de déflation des années trente qui amenèrent Hitler au pouvoir. Ainsi en est-il en Espagne et en Grèce, ou le chômage dévaste la société. En France, si l’on veut absolument réduire le coût du travail il est clair qu’il faudra baisser les salaires et les prestations sociales. Dans ce cas, c’est la consommation qui se réduit déjà, qui s’effondrera. Inévitablement nous verrons les conséquences sur la croissance ; aujourd’hui les estimations les plus crédibles indiquent que pour l’économie française l’année 2013 se traduira au mieux par une stagnation et plus vraisemblablement par une contraction de -0,4% du PIB. Le résultat en sera une hausse importante du chômage. Si nous voulons faire baisser nos coûts de 20%, il nous faudra probablement augmenter le chômage de moitié, soit arriver à plus de 15% de la population active, ou 4,5 millions de chômeurs au sens de la catégorie « A » de la DARES et 7,5 millions pour les catégories A, B et C incluant toutes les catégories de chômeurs. De plus, dans la zone euro, l’Espagne et l’Italie concurrencent déjà la France par la déflation salariale. Il faudrait donc faire mieux que Madrid et Rome, quitte à atteindre non pas 15% mais alors 20% de chômage. Quel homme politique en assumera la responsabilité ? Quelles en seront les conséquences politiques ?
Pour l’heure, nos dirigeants, et en particulier en France, font le gros dos. Le Président de la République, François Hollande, met tous ses espoirs dans une hypothétique reprise américaine pour alléger le poids du fardeau de l’austérité. Il a cependant déjà du admettre que ceci ne surviendrait pas au 2ème semestre 2013, comme il l’avait annoncé tout d’abord, et il a décalé sa prédiction au début de 2014. Mais, tel l’horizon qui s’enfuit devant le marcheur, la reprise américaine ne cesse de se décaler. C’est une illusion de croire que la demande extérieure viendra aujourd’hui nous sauver la mise. La croissance américaine est bien plus faible que prévue, et le FMI réduit à la baisse ses prévisions la concernant. Quant à la croissance chinoise, elle se ralentit de mois en mois. Hollande espère que nous serons sauvés par la cavalerie, mais la cavalerie ne viendra pas, ou alors, comme dans les tragiques journées de juin 1940 « trop peu, trot tard ».
Plus que jamais, la question de la survie de la zone Euro est posée. Les tendances à son éclatement s’amplifient. On voit que les problèmes de pays aussi divers que la Grèce, l’Espagne le Portugal et l’Italie vont converger à court terme. Il est hautement probable que nous connaîtrons une crise violente durant l’été 2013, voire au tout début de l’automne. Il est temps de solder les comptes. L’Euro n’a pas induit la croissance espérée lors de sa création. Il est aujourd’hui un cancer qui ronge une partie de l’Europe. Si l’on veut sauver l’idée européenne tant qu’il en est encore temps, il faut rapidement prononcer la dissolution de la zone euro.
Jacques Sapir (Ria Novosti, 20 avril 2013)