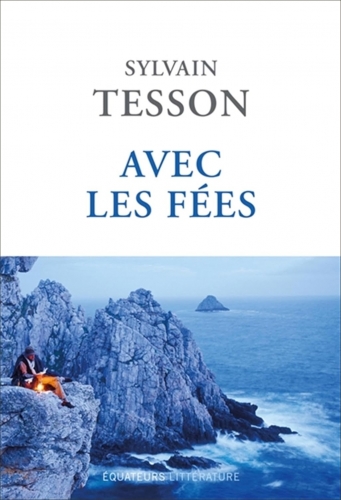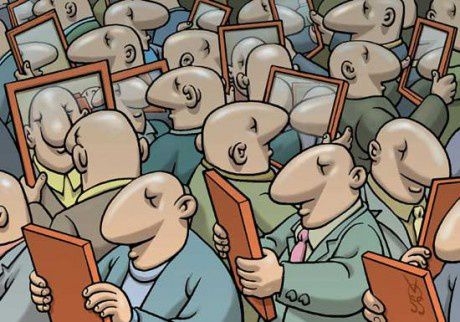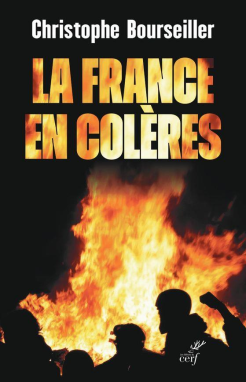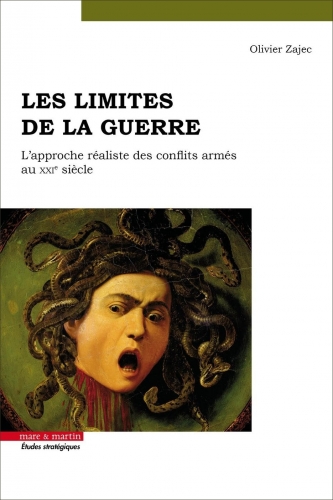Jacques Lacroix : « La Gaule nous a transmis aussi l’importance de la diversité régionale »
Les Gaulois sont toujours là, mais de façon très inattendue : davantage que dans les vestiges archéologiques – très précieux – dans les noms de lieux familiers qu’ils nous ont transmis. On en compte plus de 10 000, non seulement dans l’Hexagone mais aussi en Belgique, en Allemagne du sud, en Suisse, en Italie du nord. Se dévoile ainsi un riche patrimoine, un grand héritage dont nous n’avions pas conscience alors que nous le côtoyons chaque jour.
L’ouvrage le Grand héritage des Gaulois, signé Jacques Lacroix et édité par les éditions Yoran Embanner, ne se contente pas d’inventorier ces témoins du passé, il éclaire leur sens. Les noms restituent les principaux aspects d’une civilisation où notre pays trouve indubitablement certaines de ses racines. Le passé des Celtes est toujours présent.
Jacques Lacroix est professeur agrégé, docteur ès Lettres et Civilisations de l’Université de Bourgogne. Il a publié un ensemble d’ouvrages et d’articles sur l’héritage linguistique des Gaulois, liant toponymie, histoire et archéologie, dont Les Noms d’origine gauloise, Enquête aux confins des pays celtes, Les irréductibles Mots gaulois dans la langue française et Les Frontières des peuples gaulois.
Nous l’avons interrogé.
Breizh-info.com : Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Jacques Lacroix : J’ai fait une carrière d’enseignant de Lettres, un métier qui m’a passionné : intéresser les jeunes, transmettre, donner le goût du savoir. En même temps, en gagnant sur le temps des vacances, j’ai développé une recherche sur la langue gauloise et les souvenirs qu’elle nous a laissés. Parce que la présence de mots d’origine gauloise que je constatais dans les dictionnaires m’intriguait. Cette recherche a abouti au bout de plusieurs années à une thèse sur ce qu’on appelle le « substrat gaulois » (présidée par Venceslas Kruta, un des maîtres des études celtiques). Les membres du jury m’avaient prévenu : « Monsieur, vous verrez, la thèse n’est pas un aboutissement, c’est un début, vous vous engagerez plus avant dans la recherche ». Et c’est ce qui s’est passé : j’ai écrit des articles (une soixantaine aujourd’hui) et des livres (une dizaine), mais donné peu de conférences, afin de garder le maximum de temps pour la recherche. Elle est pour moi plus qu’un goût : une passion. Et, aujourd’hui que je suis à la retraite, je peux m’y consacrer entièrement. C’est un plein bonheur !
Breizh-info.com : Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire sur les Gaulois ?
Jacques Lacroix : Honnêtement, je crois que bien des sujets dans bien des domaines m’auraient convenu : ce qui m’anime, c’est le goût de chercher ! La recherche ressemble un peu à une enquête policière : il faut découvrir ce qu’on ne comprenait pas encore, pour cela s’engager sur différentes pistes, avec des renseignements parfois trompeurs, recourir à des témoins, faire des investigations (ici linguistiques), exhumer des documents, dégager des indices révélateurs. Enfin, par des bonds soudains dans l’enquête, la vérité se démasque.
La recherche sur les mots et les noms issus du gaulois se prête bien à ce « cheminement » – un mot du reste d’origine gauloise ! L’idiome est mal connu ; ses vestiges, fragmentaires : inscriptions parcellaires, documents linguistiques dispersés, incomplets, voire manquants. Et il faut démêler le vrai du faux pour bien mesurer l’influence du gaulois sur notre langue.
Breizh-info.com : Pouvez-vous décrire votre processus de recherche pour ce livre ?
Jacques Lacroix : Pour le livre précédent (Les Irréductibles Mots gaulois dans la langue française), j’avais travaillé sur les mots du lexique gaulois qui sont passés dans le vocabulaire du français. Pour ce nouveau livre (Le Grand Héritage des Gaulois), je me suis tourné vers les noms de lieux issus de « nos ancêtres ». Mais la démarche est la même. Dans les deux cas, il faut partir des formes anciennes, mots ou noms propres, attestés dès l’Antiquité et au Moyen Âge, en France mais aussi dans les pays d’ancienne tradition celtique : particulièrement en Irlande, en Grande et en petite Bretagne (langues celtiques). Pour toute explication avancée sur l’origine et le sens d’un nom, la comparaison est nécessaire ; un indice isolé ne suffit pas : une hypothèse portée sur un nom unique ne donne pas la vérité. On ne peut la saisir que si un ensemble de noms vont dans le même sens, que si tous les indices concordent. Le but a été ici de bien mesurer toute l’étendue des appellations d’origine gauloise, sans prétendre à l’exhaustivité.
Breizh-info.com : Quels ont été les défis auxquels vous avez été confronté lors de la rédaction de ce livre et comment les avez-vous surmontés ?
Jacques Lacroix : Travailler sur les noms de lieux (les toponymes) nécessite de manier énormément d’appellations géographiques. Cela sur de grandes étendues, car les noms d’origine gauloise se retrouvent un peu partout dans l’Hexagone (la Corse mise à part), et même au-delà : il a fallu prendre en compte certains noms de pays voisins qui ont connu un passé gaulois (car la Gaule ne se limitait pas au territoire actuel) : Belgique, sud des Pays-Bas, Allemagne du sud-ouest, Suisse, et même, à dates anciennes, Italie du nord.
Deuxième exigence : il a fallu ordonner cette matière foisonnante, distinguer noms de localités, noms de régions et petits pays, de reliefs, de cours d’eau, de forêts…Regrouper aussi selon les significations des toponymes. Car tout nom issu du gaulois voulait dire quelque chose, et le grand intérêt, pour moi, était de dégager les sens qu’ils portaient. D’où un classement thématique : noms de lieux liés aux différents peuples, à leurs frontières, à leurs préoccupations guerrières, à leurs activités de production, à leurs moyens de communications, à leurs lieux de commerce, à leur religion.
Enfin, il fallait surtout adopter une présentation aérée et tâcher de transmettre clairement les faits, sans rendre les explications absconses. Une trentaine de cartes, des encarts et même des petits jeux aident à donner respiration au texte.
Breizh-info.com : Qu’espérez-vous que les lecteurs retiendront du « Grand Héritage des Gaulois » ?
Jacques Lacroix : Les lecteurs découvriront d’abord que l’héritage gaulois est bien plus important qu’on ne croit. Les Irréductibles Mots gaulois ont établi que, contrairement à l’idée reçue, nous ne gardions pas 60 ou 120 mots français issus du gaulois mais un millier. Le Grand Héritage des Gaulois – et c’est ce qui justifie son titre – montre que les noms de lieux issus de la langue de « nos ancêtres » sont extrêmement nombreux : l’index du livre comporte 2 000 noms mais il y en existe davantage (environ 10 000) !
Deuxième enseignement, les lecteurs verront comment ces noms ne sont pas anecdotiques, n’ont pas été gardés par le simple hasard. Ils nous apportent des témoignages précieux du passé : nous soulignent des caractéristiques, des points de force des sociétés gauloises. À travers eux, c’est toute une civilisation des anciens peuples gaulois qui vient se révéler à nous, dans sa richesse, sa diversité, son originalité.
Breizh-info.com : Pouvez-vous nous donner des exemples de l’influence de la langue gauloise sur la toponymie française contemporaine ?
Jacques Lacroix : Si on prend les 50 plus grandes villes de France, on s’aperçoit que la moitié ont un nom provenant du gaulois, dont Nantes, Rennes, Amiens, Metz, Lyon, Dijon, Limoges et Paris : oui, la capitale du pays a un nom d’origine gauloise, dont le livre révèle le sens ! Près d’un tiers de nos régions et petits pays doivent leur appellation à la langue de « nos ancêtres » (Anjou, Auvergne, Médoc, Quercy, Saintonge, Vendée…) ! Remontent aussi aux parlers gaulois plusieurs centaines de noms de montagnes (Ardennes, Vosges, Morvan, Jura, Alpes…), de cours d’eau (Loire, Seine, Rhin, Rhône, Charente…), de forêts (Savoie, Margeride, Perche, Tanneron… et la mythique Brocéliande). Plus incroyable, en ce XXIe siècle, 60 noms de peuples ou peuplades gauloises ont donné leur appellation (leur « ethnonyme ») à des régions et à des villes de notre pays (le Berry est la terre des anciens Bituriges ; la Touraine est l’ancien lieu de vie des Turons ; Vannes est l’ancienne cité des Vénètes, etc.). Incroyable aussi de penser que plus de 200 communes de France tirent leur nom d’une des désignations gauloises de la forteresse. Et qu’une soixantaine de nos localités doivent toujours leur appellation à un dieu gaulois (comme Lyon, Nîmes, Toulon, Beaune, Vence). Il y a une mémoire linguistique des noms comme il y a une mémoire archéologique des sols. Il faut retrouver ce qui a été caché.
Breizh-info.com : De quelle manière pensez-vous que l’héritage gaulois influence encore la culture française moderne ?
Jacques Lacroix : Très vaste question ! La civilisation classique gréco-romaine nous est essentielle, mais elle n’est pas la seule composante qui a marqué notre pays. On ne doit pas s’enfermer dans une pensée unique, une culture unique. D’autres apports ont compté, dont l’héritage gaulois (à de moindres degrés, bien sûr). La richesse de la France : ses paysages, ses traditions, le mode de vie des habitants, son esprit, son art, sa langue, ont été pour une part non négligeable marqués par les Gaulois (1 000 ans de présence sur notre sol) ; il en reste quelques traits spécifiques.
Ce sont les Gaulois, d’abord, qui ont organisé les premiers nos espaces naturels : réparti les principales terres de culture, de pâturages, de bois, de landes, formé le premier grand réseau de routes reliant les différents terroirs (bien avant les Romains !). Ils ont également découpé cet espace vaste en nombreux territoires et petits pays (même si ces structures ont pu être ensuite remodelés, nous en gardons certaines permanences dans nos régions et nos départements). Le mode de vie gaulois a été rural pour l’essentiel, avec un habitat longtemps dispersé. Très proches de la nature, les Gaulois ont été écologistes avant l’heure ; ils construisaient leurs maisons avec des matériaux montrant cette conscience écologique ; ils avaient une grande connaissance de la nature, des arbres et des plantes.
La Gaule nous a transmis aussi l’importance de la diversité régionale. L’espace faisait coexister de nombreux peuples ; nous gardons, malgré le centralisme « jacobin », un ancrage très fort pour nos différentes régions, avec des particularismes bien exprimés. Les peuples gaulois pouvaient se diviser, peut-être avons-nous conservé parfois trop d’individualismes, un goût des querelles et un sens protestataire assez vif. Mais les Gaulois savaient aussi se rassembler dans les heures graves, avec un esprit de résistance, d’unité que nous avons parfois retrouvé.
Les populations gauloises (aux dires même de César) étaient industrieuses : intelligentes et laborieuses, avec une économie active, une haute maîtrise technologique ; la Gaule nous a transmis certaines de ces valeurs, de ces qualités. Et je montre dans le livre comment les noms de lieux rendent compte de nombre de ces aspects. En particulier l’agriculture et l’élevage (si actifs au XXe siècle), déjà les deux mamelles de la Gaule, avec de grandes plaines céréalières et des cheptels très développés. Aussi l’industrie automobile, très active en France et industrie performante à l’époque gauloise ! Ajoutons le secteur de la mode, déjà à la pointe à l’époque de nos aïeux (vêtements et bijoux). Le commerce a été un secteur très important en Gaule, entre divers peuples et aussi avec des voisins plus lointains ; nous avons gardé cet esprit d’ouverture pour les « échanges » – un mot d’origine gauloise !
Des façons de vivre spécifiques se sont peut-être également conservées, comme l’art de la table : le goût du bien manger et du bien boire. Certaines coutumes et traditions celtiques pourraient également perdurer, telle la coutume du gui et différentes fêtes, comme Halloween, jadis moment de béance entre la fin de l’année et le début d’une autre, d’échange entre monde des morts et monde des vivants. Même l’art gaulois, où prime la force de l’imagination, le génie des métamorphoses – tout à fait différent de l’art classique gréco-romain –, se reconnaît dans l’art moderne (André Breton et André Malraux l’ont bien montré).
Enfin, il y eu jadis un grand attachement des habitants à la langue gauloise et à l’acte de nomination. Une nouvelle langue a été imposée au pays, mais l’attachement aux mots des parlers traditionnels et aux appellations anciennes des lieux n’a pas disparu. Lui correspond aujourd’hui l’attachement particulier à notre langue nationale et à nos langues régionales. Nous mesurons aussi la nécessité de les protéger des attaques extérieures ! Très profondément ancrés, le français a gardé – malgré la romanisation – certains mots et certains noms venus du gaulois, ce qui est trop ignoré. Des milliers de noms de lieux d’origine gauloise nous entourent, que nous côtoyons chaque jour ; c’est le plus bel héritage de culture que nous ont transmis nos aïeux, notre plus beau patrimoine immatériel !
Breizh-info.com : Envisagez-vous de poursuivre votre travail ou vos recherches sur l’histoire gauloise ou d’autres sujets historiques ?
Jacques Lacroix : Il y a bien d’autres aspects de la culture et la langue de « nos aïeux » que je n’ai pas encore abordés, le domaine gaulois étant beaucoup plus riche qu’on ne croit ! Je vais retourner à la recherche et m’engager vers l’écriture d’un nouveau livre sur le lien entre les données linguistiques et les découvertes archéologiques. En soulignant toujours la richesse des noms de notre substrat : un vrai trésor !
Jacques Lacroix, propos recueillis par Yann Vallerie (Breizh-Info, 16 janvier 2024 )