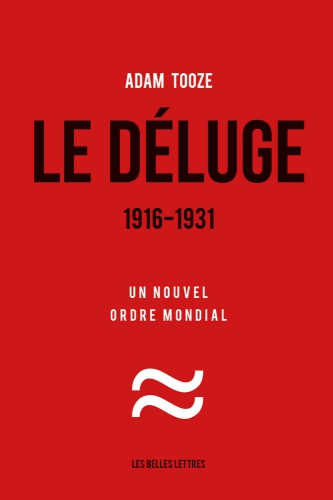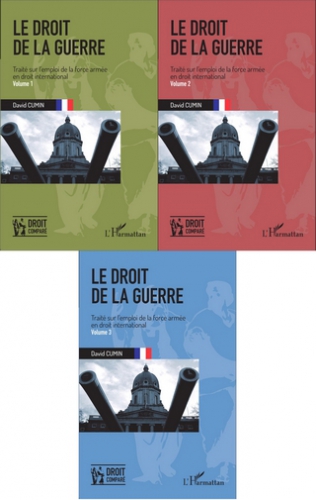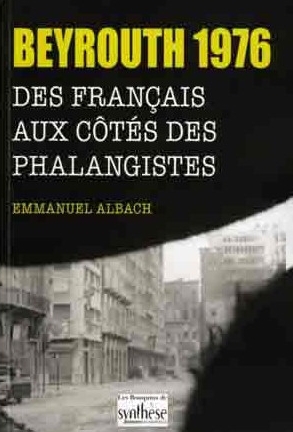" Il s'agit de comprendre pourquoi, comment et jusqu'où les progrès scientifiques (médecine, biotechnologies, nanotechnologies, informatique) permettent dès aujourd'hui de doter les membres des forces armées de capacités physiques et intellectuelles allant au delà des aptitudes normales de l'être humain, pour une meilleure efficacité dans l’action militaire.
En effet, si l’homme peut parfois apparaitre aujourd’hui comme le futur maillon faible d’un dispositif militaire, il a vocation à rester au centre des systèmes d’armes de demain. Aussi est-ce précisément pour compenser ses faiblesses sur le champ de bataille que ce Hors-Série s’attache à traiter des possibles augmentations qui peuvent être mises à sa disposition, avec les questionnements de leurs impacts potentiels sur l’homme et de leur acceptabilité. "
Au sommaire :
Éditorial
Le soldat augmenté : pourquoi ?
Améliorer les capacités humaines : actualité d’un vieux rêve
Par Pierre-Yves Cusset, chargé de mission à France Stratégie
Les forces et les faiblesses du soldat sur le champ de bataille
Par Eric Ozanne, colonel, chef d’état-major interarmées des forces armées en Guyane
Le sommeil et la performance opérationnelle
Par Dave I. Cotting, Associate Professor & Director of Core Curriculum Leadership Instruction Department of Psychology, Virginia Military Institute ; et Gregory Belenky, Research Professor, College of Medical Sciences, Washington State University
Militem increscendum. Augmenter le soldat dans l’Antiquité et le Moyen Âge
Par Olivier Hanne, agrégé et docteur en Histoire médiévale, chercheur au CREC.
Le soldat augmenté : exemples de répercussions psychologiques
Par Christian Colas, Médecin en chef des services (R), sous-direction plans capacités, direction centrale du service de santé des armées ; et Laurent Melchior Martinez, Médecin en chef, coordonnateur national du service médico-psychologique des armées, direction centrale du service de santé des armées
L’homme augmenté et la conquête spatiale
Entretien avec Jean-François Clervoy, astronaute.
Le soldat augmenté : concept et réalité opérationnelle
Par Jean-Thomas Rubino, capitaine (TA), instructeur aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Le soldat augmenté : quel intérêt pour les forces ?
Par Thomas Noizet, lieutenant-colonel, Etat-major de l’armée de Terre.
Le soldat augmenté. Quel intérêt pour une unité d’élite comme le GIGN ?
Par Christophe B., commandant de la force formation, GIGN
Aéronavale, guerre en mer et soldats augmentés
Par Pierre Vandier, capitaine de vaisseau, auditeur de la 65e session du Centre des Hautes Etudes Militaires, commandant du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle de 2013 à 2015.
Le soldat augmenté : comment ?
Les nouveaux horizons apportés par les micro et nanotechnologies pour le combattant de demain
Par Audrey Flament et Jean-Michel Goiran, Leti, institut de CEA Tech
Le fantassin du futur sera mobile et collaboratif
Par Parick Sechaud, Sagem (groupe Safran). Division Optronique et Défense, R&T Combat Numérisé
Le soldat augmenté : un soldat informé, allégé et mieux équipé
Par Gérard de Boisboissel, ingénieur de recherche au Centre de Recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC)
Les soldats augmentés mieux informés, allégés et mieux équipés – de l’imagination à l’emploi
Par Emmanuel Gardinetti, commandant (T) DGA Ingénierie des Projets, responsable du métier sciences de l’homme
Aptitude au métier des armes : les perspectives ouvertes par l’anthropotechnie
Par Lionel Bourdon, médecin chef des services HC, Praticien professeur agrégé du Service de santé des armées, Professeur titulaire de la chaire de recherche appliquée aux armées, Directeur scientifique de l’institut de recherche biomédicale des armées
Le stress, acteur oublié de l’extension capacitaire
Par Frédéric Canini et Marion Trousselard, médecins en chef, département Neurosciences & Contraintes Opérationnelles, Institut de Recherche Biomédicale de Armées (IRBA), Brétigny-sur-Orge
Perspectives ouvertes par la pharmacologie en milieu opérationnel civil. Mythe ou réalité ?
Par Olivier Lamour, docteur en médecine
Le soldat augmenté : jusqu’où ?
Le soldat augmenté est avant tout un homme
Par Jean-Michel Le Masson, médecin en chef (R), chef du Service de santé zonal pour le Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur, chercheur associé au Centre de recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Le soldat est-il prêt à se « faire augmenter » ?
Par Claude Weber, sociologue au Centre de Recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC)
Le paradoxe de la reine rouge
Par Patrick Clervoy, docteur en médecine
Quelle éthique du recrutement ?
Par Henri Hude, philosophe, directeur du pôle Ethique et environnement juridique au CREC-Saint-Cyr.
« Les gardiens de la galaxie » – l’éthique biomédicale part en guerre
Par George Lucas, Académie navale d’Annapolis
Evolution du droit et acceptation juridique de l’augmentation
Par Julien Le Gars, magistrat, ancien sous-directeur des libertés publiques
L’institution militaire face au défi de l’homme augmenté
Par Didier Danet, Pôle Action Globale et Forces Terrestres, Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan