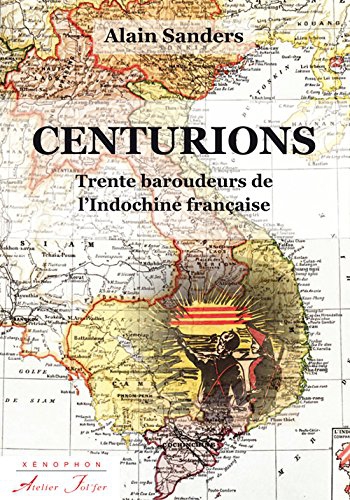Nous reproduisons ci-dessous entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré aux suites des attentats du 13 novembre...

« Nous faisons la guerre chez eux, ils font la guerre chez nous »Après les attentats commis à Paris en janvier dernier, des millions de gens avaient défilé dans les grandes villes en hurlant « Je suis Charlie ». Dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre, on a seulement vu quelques rassemblements sporadiques, auxquels s’est ajouté l’« hommage national » présidé par François Hollande dans la cour d’honneur des Invalides. Pourquoi cette différence ?
Les attentats de janvier et ceux de novembre sont très différents. En janvier dernier, les terroristes islamistes avaient massacré des journalistes auxquels ils reprochaient d’avoir « blasphémé » contre Mahomet, puis ils avaient tué des juifs au seul motif qu’ils étaient juifs. Il était alors facile pour les manifestants, qui dans leur grande majorité n’étaient ni juifs ni journalistes, de se dire solidaires de « Charlie » ! Le 13 novembre, au contraire, les terroristes n’ont pas visé de cibles particulières. Au Bataclan, ils n’ont pas demandé aux spectateurs de décliner leur origine ou leur religion. Ils ont massacré tous ceux qui étaient là sans distinction d’âge, de sexe, de croyance, d’appartenance ou de profession. On a ainsi compris que tout le monde est devenu une cible potentielle. L’équivalent d’une douche froide.
Même si dans les deux cas les auteurs des attaques étaient les mêmes (de jeunes délinquants « radicalisés »), les motifs étaient également différents. L’attaque contre Charlie Hebdo était de nature « religieuse », celle contre le Bataclan de nature politique. Le 13 novembre, les terroristes voulaient sanctionner notre engagement militaire en Syrie : c’est la politique étrangère française qui était visée. Hollande l’a bien compris, puisqu’il a immédiatement ordonné à l’aviation française d’intensifier ses frappes, tandis qu’il s’engageait lui-même dans une vaste tournée diplomatique. Comme l’a écrit Dominique Jamet, « nous ne pouvons faire la guerre au loin et avoir la paix chez nous ». Nous faisons la guerre chez eux, ils font la guerre chez nous. C’est aussi simple que cela.
Plusieurs familles de victimes ont refusé de participer à la cérémonie des Invalides, parce qu’elles considèrent le gouvernement actuel comme le premier responsable des attentats. Une réaction exagérée ?
Pas vraiment. Le 13 novembre, il a fallu plusieurs heures, durant lesquelles des dizaines de spectateurs du Bataclan ont été tirés comme des lapins, avant que l’on voie arriver les hommes de la BRI. Cela pose déjà un problème. Mais ce sont avant tout les failles du système français de renseignement qui doivent être montrées du doigt. Sur le plan intérieur, le « renseignement territorial » (recueil et analyse des données) est en effet vital, les plans Vigipirate ou Sentinelle, qui font patrouiller dans les rues des soldats réduits à l’état de vigiles, se bornant à créer une présence visible qui a pour seul but de rassurer la population sans vraiment la protéger.
La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a succédé, l’an dernier, à la DCRI, née en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, de la fusion de la Surveillance du territoire (DST) – service à vocation avant tout judiciaire et opérationnelle – et des Renseignements généraux (RG) – service d’information sans aucune attribution judiciaire. Cet organisme hybride, qui a cumulé les défauts de ses deux composantes, a rapidement accumulé les échecs et les erreurs (voir le rapport Verchère-Urvoas de 2013). Plus douée pour espionner les journalistes que pour lutter contre le djihadisme, la DGSI dispose de beaucoup de renseignements sur des milliers d’individus dangereux mais, par manque de formation criminologique sérieuse, elle peine à trouver les moyens d’identifier ceux qui sont véritablement prêts à passer à l’acte. Elle n’a, en outre, toujours pas compris que les terroristes ne sont plus aujourd’hui des Ben Laden mais des jeunes bandits des « quartiers ». Les attentats de ces dernières années en sont le résultat. En Tunisie, après l’attentat du musée du Prado, tous les responsables du renseignement ont été démis de leurs fonctions. On peut regretter qu’il n’en soit pas allé de même en France.
L’État islamique ne se cache pas de mépriser une civilisation occidentale qu’il estime « décadente et dépravée ». Que lui répondre ?
Que l’Occident soit aujourd’hui décadent est un fait – et c’est également un fait que les interventions occidentales au Proche-Orient n’ont abouti, depuis 1990, qu’à généraliser la guerre civile et le chaos. Mais la pire des réponses serait de se faire gloire de nos tares. C’est, au contraire, la décadence qui nous rend incapables de faire vraiment face au djihadisme, dans la mesure où elle est toujours le prélude à une dissolution. Après les attentats de janvier, François Hollande exhortait à se remettre à « consommer ». Ces jours-ci, il appelait à continuer à « se distraire ». La cérémonie des Invalides donnait elle-même envie de pleurer, pas de se battre. Ce n’est pourtant pas avec des chansons de variétés que l’on stimule le courage et la volonté, ou que l’on recrée les conditions d’une amitié nationale. Comme l’écrit Olivier Zajec, « ce sont les nations, et non la consommation ou la morale, qui redonnent forme et sens au monde ».
La guerre est une forme de rapport à l’autre qui implique aussi un rapport à soi. Cela signifie que, « pour savoir ce que sont nos intérêts, il nous faut d’abord savoir qui nous sommes » (Hubert Védrine). Dans L’Enracinement, Simone Weil constatait que « des êtres déracinés n’ont que deux comportements possibles : ou ils tombent dans une inertie de l’âme presque équivalente à la mort, ou ils se jettent dans une activité tendant à déraciner toujours plus, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou qui ne le sont qu’en partie ». Face à l’universalisme qui conduit au déracinement, l’Europe n’a d’autre alternative que d’affirmer ce qui la constitue en propre.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 29 novembre 2015)