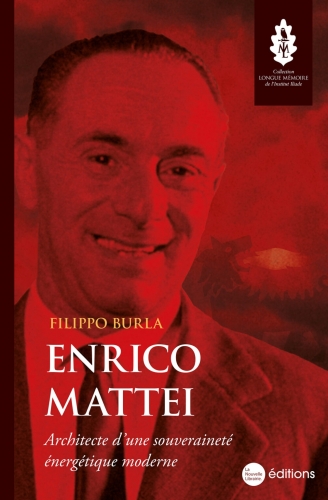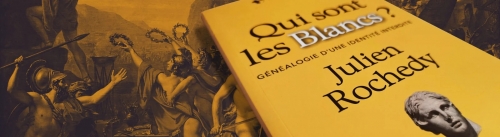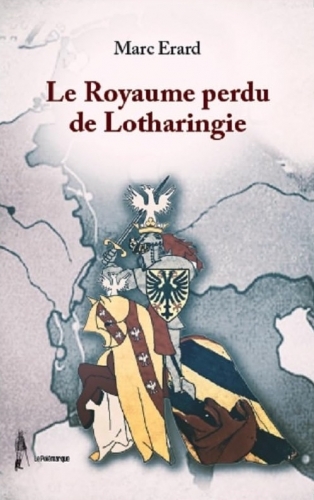Qui sont les Blancs ? Une question taboue posée par Julien Rochedy
Une question taboue
« Qui sont les Blancs ? » : avec ce nouveau livre, Julien Rochedy s’attaque à un tabou.
Pour les décolonialistes et les « progressistes », la réponse est simple : ce sont des « salauds », coupables de la Shoah, de la colonisation, de l’esclavage, du réchauffement climatique. Pour beaucoup d’autres, les Blancs sont « cancellisés », niés. Ils n’existent pas, ou s’ils existent, il est plus prudent de n’en point parler ! Car l’essentialisation est recommandée pour les autres groupes humains, mais interdite pour eux.
Et pourtant, quiconque prend le métro dans une grande ville d’Europe trouve vite la réponse à la question : « Qui sont les Blancs ? » — la nouvelle minorité. La « question blanche » se pose ici et aujourd’hui comme il y eut hier une « question noire » dans les périphéries urbaines américaines.
Rochedy affronte le problème sans faux-semblants ni complexe, en commençant par l’origine : l’ethnogenèse lors de la préhistoire et de la protohistoire, c’est-à-dire la fusion de trois groupes de peuples très proches :
- Les chasseurs-cueilleurs, artistes de la grotte Chauvet, à l’origine de nos « 30 000 ans d’identité » selon Dominique Venner, dont les caractères ont été sélectionnés par les exigences de l’âge glaciaire ;
- Les agriculteurs anatoliens arrivés il y a 7 000 ans, porteurs de la révolution néolithique et des mégalithes ;
- Et, il y a 5 000 ans, la grande vague des Yamnayas, issus eux aussi des chasseurs-cueilleurs, apportant les langues indo-européennes et une vision du monde fondée sur les trois fonctions que l’on identifie dans toute l’histoire européenne.
Rochedy insiste sur l’unité biologique des Européens : du Portugal aux pays baltes, de l’Italie à l’Irlande, on retrouve les mêmes composantes génétiques d’origine — variables dans leurs proportions, mais marquant une grande homogénéité. Ce socle, absent chez d’autres peuples plus diversifiés, est resté inchangé et imperméable à toute immigration externe jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle.
Le récit civilisationnel : de la Grèce au nihilisme contemporain
Après ce développement sur les origines, Rochedy passe au récit civilisationnel. De généticien pensif, il devient historien méditatif. Après les millénaires de la préhistoire glaciaire viennent les périodes historiques:
- La rationalité, avec l’empreinte grecque — Grèce, Rome, Moyen Âge (Aristote et les thomistes), Renaissance, Lumières ;
- Le pragmatisme, avec Rome et son droit : « pour schématiser, le monde grec imprime l’Être du Blanc, celui de Rome inspire son Faire » ;
- La moralité, avec l’empreinte chrétienne ;
- La force, avec l’empreinte germanique — le Moyen Âge y est vu comme un « sas de décompression avec l’origine orientale du christianisme » ;
- L’individualisme, avec la Renaissance ;
- Le sentimentalisme, avec les Lumières, perçu comme une « réponse à une bascule anthropologique tragique », substituant aux liens anciens des affects volatils et un altruisme abstrait ;
- Le travail, avec l’empreinte industrielle ;
- Le nihilisme, avec l’époque contemporaine.
Pour Rochedy, les maux actuels — wokisme et transhumanisme — prolongent des tendances anciennes : le constructivisme social des XIXe et XXe siècles, mais aussi l’hybris grecque. Ce qui nous bouleverse aujourd’hui vient de loin, mais aussi de nous-mêmes. D’où la nécessité de retrouver des contrepoids : mesure, limites, héritage commun, continuité historique. Face à la déferlante démographique de l’immigration, il y aurait urgence.
Un essai polémique dans la tradition des penseurs européens
Ce livre s’inscrit dans une lignée d’ouvrages sur la civilisation européenne : La Formation de l’Europe de Gonzague de Reynold, Le Génie de l’Occident de Louis Rougier, L’Europe a fait le monde d’André Amar, ou Histoire et tradition des Européens de Dominique Venner.
Rochedy s’en distingue par le choix du terme « Blanc », assumé, justifié par la minorisation démographique mondiale et par les apports récents de la génétique. Il soutient que la sélection naturelle des peuples européens sous le froid glaciaire a marqué durablement leur civilisation. Certains y verront un « matérialisme biologique » irritant pour les culturalistes.
Des passages susciteront débat, notamment sur le christianisme, que Rochedy crédite d’un rôle moral, intellectuel et même eugénique — favorisant le brassage des familles et la faible consanguinité européenne. D’autres critiqueront son approche téléologique : chez lui, ce qui advient devait advenir, comme si l’urinoir de Duchamp se trouvait déjà au pied de la grotte de Lascaux.
Il reconnaît cependant, dans sa conclusion, la part de l’imprévu : la démographie du Nigeria face à l’Europe pourrait « plier le match », mais il croit encore à un sursaut.
Livre polémique, certes, mais solidement construit, Qui sont les Blancs ? relance un débat ancien sur l’identité et la continuité de la civilisation européenne. Rochedy, « loup solitaire » ardéchois, y apparaît aussi comme une chouette qui réfléchit — et nourrit le débat.
Jean-Yves Le Gallou (Polémia, 17 octobre 2025)