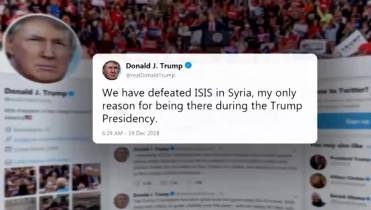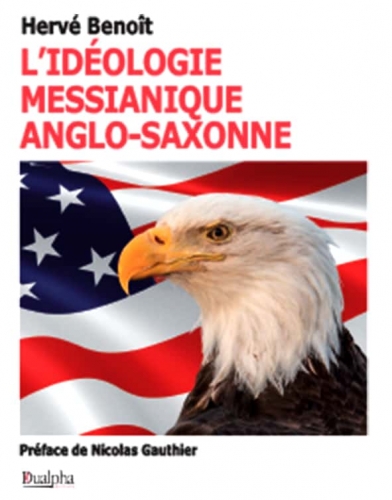Nous reproduisons ci-dessous entretien avec Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire, dans lequel il évoque l'arrivée au pouvoir au Brésil de Jair Bolsonaro... Philosophe et essayiste, directeur des revues Nouvelle École et Krisis, Alain de Benoist a récemment publié Le moment populiste (Pierre-Guillaume de Roux, 2017), Ce que penser veut dire (Rocher, 2017) et L'écriture runique et les origines de l'écriture (Yoran, 2017).

Alain de Benoist : le programme de Jaïr Bolsonaro est consternant !
Élu président du Brésil en octobre dernier, avec plus de 55 % des suffrages, Jaïr Bolsonaro vient de prendre ses fonctions. La gauche, qui multiplie les anathèmes contre lui (homophobe, sexiste, raciste, etc.), parle d’une nouvelle poussée de « populisme » et dit que sa victoire réjouit tout ce que le monde compte de gens « de droite et d’extrême droite ». Vous en faites partie ?
Pas du tout. Bolsonaro a certainement bénéficié de la vogue actuelle du populisme et capté le vote des classes populaires qui votaient auparavant pour le Parti des travailleurs, mais le populisme, je vous le rappelle, n’a pas de contenu idéologique précis. C’est seulement un style, une manière de faire se répondre l’offre et la demande politiques, et ce style peut se combiner avec des idéologies très différentes (Luiz Inácio Lula, l’ancien président, était lui aussi un « populiste »). La droite frétille toujours de façon pavlovienne quand elle entend dire qu’on va rétablir « la loi et l’ordre ». Le problème est que la loi peut être injuste et que l’ordre n’est souvent qu’un désordre établi.
Je me garderai, bien sûr, de faire un procès d’intention à Bolsonaro. J’espère de tout cœur qu’il pourra mettre un terme à la corruption et ramener un peu de calme dans un pays où l’on enregistre 64.000 homicides par an (plus d’un demi-million en dix ans). Ce que je constate en même temps, c’est qu’il était avant tout le candidat des marchés financiers (la Bourse de São Paulo a bondi de 6 % au lendemain de son succès), des multinationales, à commencer par Monsanto, et du lobby des grands propriétaires terriens (la bancada ruralista), et que ce sont les églises évangéliques, contrôlées par les télé-évangélistes nord-américains et pétries de messianisme sioniste, qui lui ont apporté le soutien le plus décisif (ancien catholique, il s’est lui-même converti à l’évangélisme en se faisant symboliquement baptiser dans le Jourdain en 2016).
Mais que lui reprochez-vous essentiellement ?
J’ai écouté les diverses interventions de Bolsonaro et j’ai lu avec attention son programme, que je trouve à bien des égards consternant. Après avoir décidé de se retirer de l’accord de Paris sur le climat, il a annoncé la construction d’une nouvelle autoroute à travers l’Amazonie, l’ouverture à l’exploitation pétrolière et minière de territoires autochtones dont les habitants seront expulsés, et la promotion systématique de l’agriculture industrielle au détriment de la protection de l’environnement. Pour que les choses soient claires, il a d’ailleurs froidement supprimé le ministère de l’Environnement, dont les fonctions ont été transférées à celui de l’Agriculture, et annoncé la disparition du ministère de la Culture. Sur le plan social, il entend recourir à la privatisation quasi intégrale des entreprises publiques, installer un système de retraite par capitalisation des fonds de pension, alléger la fiscalité des groupes industriels les plus puissants, multiplier les exemptions d’impôts pour les tranches de revenu supérieures et réaliser une large dérégulation du secteur financier. S’il y a des gilets jaunes au Brésil, ils y trouveront difficilement leur compte !
En politique internationale, Bolsonaro a adopté la même ligne que Donald Trump dans ce qu’elle a de plus contestable : transfert de l’ambassade de son pays de Tel Aviv à Jérusalem, soutien inconditionnel à l’Arabie saoudite et à Israël, méfiance vis-à-vis de l’Europe et hostilité envers la Chine et la Russie. À cela s’ajoute encore sa nostalgie avouée pour la dictature qui a régné au Brésil de 1964 à 1985, ce qui n’a rien pour me plaire. J’ai vu, dans le passé, s’installer un certain nombre de dictatures militaires, des colonels grecs aux généraux argentins en passant par Pinochet et ses « Chicago Boys ». Je les ai trouvées plus lamentables les unes que les autres.
On présente pourtant Bolsonaro comme un nationaliste…
Plus qu’un nationaliste, ce personnage, humainement assez creux et dénué de scrupules, est en réalité, tout comme Macron, un libéral. Il suffit de voir son entourage. L’homme fort de son gouvernement, qui cumule à lui seul cinq portefeuilles de ministres, est Paulo Guedes, cofondateur de la banque d’affaires BTG Pactual, un ultralibéral formé à l’école de Chicago, ancien élève de Milton Friedman, qui a également fondé l’Institut Millenium, d’orientation libertarienne et pro-pesticides, avant de sévir sous la dictature militaire chilienne. Le ministre des Affaires étrangères, Ernesto Araújo, est un diplomate anti-écologiste lié aux intérêts de l’agro-business. Le ministre de l’Agriculture, Tereza Cristina, est la représentante de la bancada ruralista. Le ministre de l’Éducation, Ricardo Vélez Rodriguez, un Colombien naturalisé brésilien, est un disciple d’Antônio Paim, ancien intellectuel communiste devenu aujourd’hui ultralibéral. Et leur gourou commun, Olavo de Carvalho, est un « penseur » résidant aux États-Unis où il propose des cours de philosophie « online ».
Tout cela est, pour moi, rédhibitoire. Par principe, je ne cautionnerai jamais un virage à droite qui s’accompagnerait d’un retour en force du libéralisme.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 11 janvier 2019)