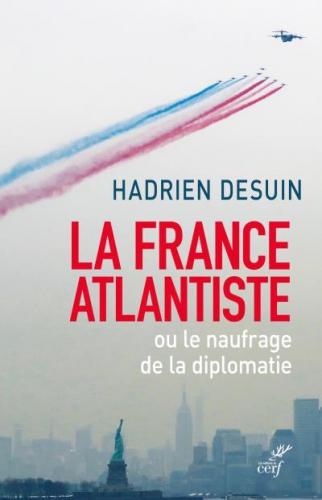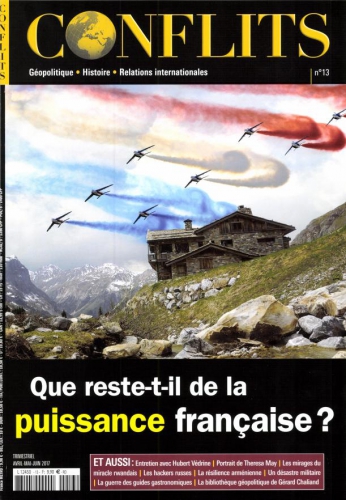Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Hadrien Desuin au Figaro Vox à l'occasion de la sortie de son essai La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie.(Cerf, 2017). Géopoliticien, ancien élève de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, Hadrien Desuin est un collaborateur régulier de la revue Conflits

Du gaullisme au néo-conservatisme, comment la diplomatie française est devenue atlantiste
FIGAROVOX. - Qu'est-ce que «l'atlantisme»? Une suprématie ou une soumission? Peut-on aussi l'entendre comme une coopération d'égaux?
Hadrien DESUIN. - L'atlantisme est un courant de pensée très ancien. Dès la Première Guerre Mondiale, des personnalités politiques comme Léon Bourgeois prônent la mise en place d'une diplomatie à l'américaine, ce que Pierre Hassner a appelé «wilsonisme botté». Léon Bourgeois fut le premier président de la SDN en 1919. Le Président Wilson, fils de pasteur presbytérien de Virginie, voulait en finir avec la vieille diplomatie européenne. Selon lui le droit et la morale devaient remplacer les notions d'équilibre des forces et de concert des Nations. Avec le traité de Versailles imposé à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, il proposait à l'ancien monde une évangélisation démocratique sous garantie américaine. Avec les résultats que l'on sait.
Dans la relation transatlantique, il faut, au-delà des grands discours, mesurer le rapport de forces entre alliés. L'Amérique n'est certes plus l'hyperpuissance des années 90. Elle n'en reste pas moins la première puissance au monde et son budget militaire est encore supérieur à la totalité de ses concurrents ou partenaires. Elle finance à 70% la défense européenne grâce à l'OTAN. Il n'y a donc pas d'égalité dans les rapports transatlantiques. Les puissances européennes sont largement morcelées et disproportionnées. L'Europe de la défense, dépendante de Bruxelles est congelée à l'état embryonnaire depuis dix ans. Sur le continent européen, seules les armées françaises et britanniques sont encore «autonomes», la Turquie étant un cas à part.
L'OTAN cadre donc les rapports euro-atlantistes. Héritage de la guerre froide, cette alliance militaire dirigée par les États-Unis contre le bloc soviétique s'est maintenue voire renforcée par des opérations partout dans le monde depuis 1999. Or l'OTAN est restée sous commandement américain. Instrument de tutelle militaire sur ses alliés européens qui sont en première ligne, l'OTAN est aussi une tête de pont américaine sur le continent mondial qu'est l'Eurasie. Elle contient la puissance ré-émergente russe.
Suprématie ou soumission sont des termes un peu polémiques. Ils ne reflètent pas complètement la réalité parce qu'il y a toujours une part de dialogue entre alliés. C'est une vassalité douce et tranquille. La suprématie américaine est acceptée bon gré mal gré, on n'y fait presque plus attention. Avec Donald Trump cette relation transatlantique déséquilibrée apparaît cruellement à nos yeux parce que le président américain ne se donne même pas la peine de consulter ses alliés. Les atlantistes Français sont dès lors dans une situation encore plus délicate qu'à l'époque de Bush junior. Le parti atlantiste a pris une première claque avec l'élection de Trump. Et une seconde avec le retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. En général, les atlantistes sont plus à l'aise avec le parti démocrate. Lequel prend plus de gants pour exercer son leadership.
Comment, traditionnellement, se caractérisait la position diplomatique de la France?
Grande puissance européenne, la France avait toujours su jouer des rivalités des grandes puissances pour tenir son rang de membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. C'était le sens des ouvertures de De Gaulle vers l'URSS ou vers la Chine mais aussi ce qu'on appelait le Tiers-Monde. Ce qui a changé au cours de la décennie 2007-2017, c'est l'absorption pleine et entière (hors nucléaire) dans les structures militaires de l'OTAN. Le bouclier antimissile américain en Europe de l'Est diminue parallèlement l'intérêt de notre force de frappe. Parfois, la France a tellement voulu jouer les bons élèves de Washington, qu'elle a dépassé le maître et contribué à placer des pays comme la Libye ou la Syrie dans des situations analogues à l'Irak post 2003.
Le général de Gaulle avait décidé de quitter en 1966 les structures militaires intégrées de l'alliance après des années de discussions assez vives sur la direction politique de cette alliance. Autrement dit, la France quittait le noyau dur de l'OTAN ayant constaté que le directoire tripartite de 1949 composé des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France n'existait pas. Il profite de l'émancipation nucléaire et coloniale de la France pour faire un pas de côté par rapport à l'alliance atlantique. La France est de nouveau indépendante.
Au sommet de l'OTAN de Strasbourg-Kehl de 2009, Nicolas Sarkozy accepte de réintégrer le comité militaire intégré en échange de quelques postes d'officiers généraux. Le pilier européen de l'OTAN qui était présenté comme la condition préalable à cet accord n'a jamais été sérieusement garanti. Il s'agissait d'assumer et d'officialiser une réintégration qui s'était progressivement reconstituée de facto depuis le bombardement de Belgrade.
Existe-il un néo-conservatisme à la française? De quand date-t-il? Peut-on percevoir une continuité dans les affaires internationales entre Nicolas Sarkozy et François Hollande?
En 2012, il n'y a pas eu d'alternance en politique étrangère. Le passage de relais entre Alain Juppé et Laurent Fabius a été très fluide. Un grand Moyen-Orient démocratique devait forcément surgir des Printemps arabes.
Le néo-conservatisme à la française est un mouvement bien connu. Jean Birnbaum dans Les Maoccidents (éd. Stock) a très bien décrit l'origine de la chose. Ses membres les plus célèbres sont Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner ou André Glucksman. Beaucoup sont d'anciens maoïstes qui ont fait leurs premières armes contre l'URSS dans les années 70 et 80. Ils en veulent à Moscou d'avoir trahi leurs idéaux de jeunesse. Ils ont définitivement rallié la bannière américaine dans les années 90 pensant qu'elle serait l'amorce d'une mondialisation démocratique et cosmopolite. Venus de la gauche et du monde associatif, ils ont soutenu George W. Bush en 2003 en Irak à rebours de l'opinion publique de l'époque. Il s'agissait selon eux d'une guerre humanitaire qui devait délivrer le peuple irakien de la dictature de Saddam Hussein. Dix ans plus tard, malgré un bilan désastreux, ils ont remporté la bataille des idées et surtout des places. Les atlantistes sont très présents dans les différentes directions de planification et de réflexions stratégiques au Quai d'Orsay ou au ministère des Armées. Le principal think tank «néo-cons» est d'ailleurs la fondation pour la recherche stratégique (FRS) qui est sous tutelle financière de l'État. Le journaliste Vincent Jauvert a dressé la liste de «la secte» néo-conservatrice dans son best-seller La face cachée du Quai d'Orsay (éd.Robert Laffont). Thérèse Delpech, qui fut son égérie jusqu'à son décès est probablement celle qui a fait le pont avec la maison mère américaine.
Emmanuel Macron a reçu en grande pompe Vladimir Poutine cette semaine. Que vous inspire ce virage dans les affaires étrangères françaises? Espérez-vous un retour du gaullisme chez le nouveau président?
Il est encore trop tôt pour parler de virage dans la politique extérieure française. Les nominations de Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay et dans une certaine mesure de Sylvie Goulard aux Armées sont plutôt de bons signes. La première visite d'un chef d'État a été réservée à Vladimir Poutine dans le cadre somptueux de Versailles. Il s'agissait de tourner la page de cinq ans de relations très dégradées avec Moscou, ce qui a été plutôt réussi d'un point de vue symbolique. Reste désormais à passer aux actes: en finir avec les sanctions économiques et coopérer enfin avec la Russie contre Daech et Al Qaïda en Syrie.
À l'ENA, Emmanuel Macron a gardé le souvenir du discours de Dominique de Villepin à l'ONU en 2003, dont on dit qu'il a beaucoup influé le candidat. Sans doute que l'atlantisme à outrance, celui qui a conduit la France dans les aventures libyennes et syriennes sera tempéré. Encore qu'il ait repris à son compte l'idée d'un bombardement automatique et d'une ligne rouge en cas d'usage d'armes chimiques. Nous verrons bien ce qu'il en sera lorsque les djihadistes d'Idlib repasseront à l'acte.
Je ne crois pas à un retour au gaullisme car il faudrait une personnalité suffisamment forte et légitime pour ressortir des structures intégrées de l'OTAN et donner à l'Europe une direction inter-gouvernementale et non pas fédérale. Or les Français sont fatigués et résignés. Le pays est financièrement exsangue. Ils ont plus ou moins intériorisé l'auto-dissolution stratégique de notre pays.
Le projet d'une Europe de la défense prend peu à peu forme: percevez-vous ces propositions comme bénéfiques pour les affaires étrangères de la France?
Le mythe de l'Europe de la défense est tenace. Il y a bien quelques budgets pour faire des formations ici ou là, quelques accords techniques de partage des infrastructures et des matériels, mais aucune guerre n'a été menée par l'Union Européenne. D'un point de vue opératif c'est le néant et ça le restera. La France est la seule en Europe à sauter comme un cabri et à crier «l'Europe de la défense, l'Europe de la défense, l'Europe de la défense!» Les Allemands comme ses voisins de l'Est préféreront toujours la tutelle américaine à la tutelle européenne dans un continent qui désarme depuis 30 ans. Pour eux l'Europe de la défense existe déjà, elle s'appelle l'OTAN. De Gaulle l'a malheureusement constaté dès 1963.
Dans un contexte très tendu d'opposition avec Donald Trump, ils développent l'idée d'une OTAN émancipée de l'Amérique plutôt que d'une Europe de la Défense. Ce qui est un non-sens. L'Allemagne reste quadrillée de bases américaines. Angela Merkel fait le dos rond pendant sa campagne électorale. Elle craint par-dessus tout un retrait américain. Elle n'hésitera pas à mettre la main au portefeuille pour s'en prémunir.
Vous démontrez l'imposture de la notion oxymorique de «guerre humanitaire» de Bernard Kouchner. Est-ce à dire que la diplomatie doit se passer complètement de la morale?
Absolument. Les expressions comme «soldats de la paix» prêtent à confusion. Un soldat fait la guerre. Son objectif est de détruire l'ennemi. Un diplomate doit négocier avec l'adversaire. Il ne sert à rien de pérorer entre amis sur la grandeur de ses idéaux. Ce n'est pas un prophète ou un humanitaire qui appelle les populations à s'aimer les uns les autres.
Une intervention militaire doit être possible uniquement dans le cadre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies. Ce conseil oblige à une négociation entre les grandes puissances. C'est une garantie pour préserver les équilibres du monde et un garde-fou contre la politique des bonnes intentions. Lesquelles mènent le plus souvent à la catastrophe, non seulement militaire mais aussi humanitaire. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder l'état de l'ex-Yougoslavie, de la Somalie, de l'Afghanistan et bien sûr de l'Irak.
Vous dîtes que la France renonce à ses intérêts politiques pour des intérêts financiers notamment avec les pétromonarchies du Golfe qui nourrissent un islam radical. Mais n'est-ce pas la preuve d'un réalisme dépassionné?
Le réalisme est dépassionné par définition. Mais c'est justement au nom de ce réalisme que la coopération financière avec les pétromonarchies du Golfe doit être réévaluée. À court terme, on peut espérer des rentrées d'argent, encore qu'il s'agisse surtout de promesses de contrats plus que de signatures fermes. À long terme, est-il responsable de renforcer à ce point des monarchies théocratiques qui propagent un islamisme rétrograde à travers le monde? Il y a une façade que les émirats présentent à l'occident et puis il y a les soutiens plus discrets, salafistes ou fréristes, qu'ils financent en Europe et ailleurs. Les émirs jouent aux despotes éclairés. En réalité, ils sont dans une surenchère hypocrite avec des mouvements islamistes qui les dépassent.
Hadrien Desuin, propos recueilli par Eloi Thiboud (Figaro Vox, 2 juin 2017)