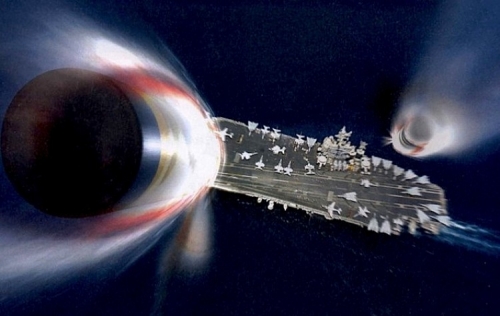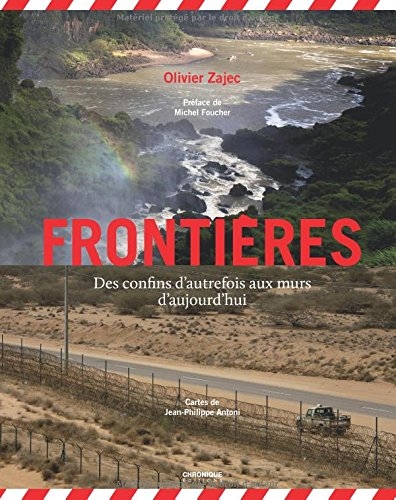Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Caroline Galactéros, cueilli sur Figaro Vox et consacré aux frappes aériennes contre la Syrie annoncées par les États-Unis, auxquelles Emmanuel Macron a déclaré vouloir associer la France. Docteur en science politique et dirigeante d'une société de conseil, Caroline Galactéros est l'auteur de Manières du monde, manières de guerre (Nuvis, 2013) et publie régulièrement ses analyses sur le site du Point et sur celui du Figaro Vox. Elle vient de créer, avec Hervé Juvin, Geopragma qui veut être un pôle français de géopolitique réaliste.

Caroline Galactéros: «Pourquoi la France ne doit pas s'associer aux frappes en Syrie»
La messe semble dite et une atmosphère de veillée d'armes plane sur Paris, tandis que le jeune prince d'Arabie Saoudite quitte la capitale et que notre président est en étroit dialogue avec son homologue américain. La France pourrait, en coordination avec Washington, frapper de manière imminente les forces du régime syrien en représailles d'une nouvelle attaque chimique imputée de manière «très probable» mais en amont de toute enquête, aux forces de l'abominable tyran Assad soutenu par les non moins affreux régimes russe et iranien.
Il faudrait agir vite, se montrer ferme, intraitable, juste! Il s'agirait là d'un «devoir moral»! On a bien entendu et lu. Le discours moralisateur sur la sauvegarde des civils innocents, pourtant inaudible après sept ans de guerre et de déstabilisation de la Syrie, est toujours le même. C'est là le comble du cynisme en relations internationales, que nous pratiquons pourtant sans états d'âme depuis des décennies. Pendant ce temps, la guerre silencieuse du Yémen continue. Ces civils-là n'existent pas, ne comptent pas.
Mais certaines images de guerre et de civils otages d'une sauvagerie généralisée irritent plus que d'autres nos consciences lasses d'Européens déshabitués de la violence et gonflés d'une prétention à connaître, dire et faire le Bien. Soit.
Mais agir contre qui? Qui faut-il punir? Le régime de «l'animal Assad», comme l'a appelé Trump? L'Iran? La Russie? Vraiment? Et si ce trio noir que l'on désigne exclusivement depuis des mois à la vindicte populaire internationale n'était qu'un leurre, proposé à notre indignation sélective pour ne pas réfléchir à nos propres incohérences?
Personne ne se demande pourquoi cette nouvelle attaque chimique arrive maintenant, au moment même où la Ghouta orientale repasse sous contrôle gouvernemental syrien et parachève sa reconquête territoriale, face à des groupuscules rebelles rivaux globalement en déroute et plus que jamais prêts à se vendre au plus offrant pour survivre et espérer compter? Personne ne s'autorise à douter un instant, quand le ministre russe des affaires étrangères rapporte que les observateurs du Croissant rouge syrien envoyés sur place n'ont rien vu ressemblant à une attaque? Serguei Lavrov ment-il carrément au Conseil de Sécurité des Nations unies ou bien faut-il penser que Moscou ne contrôle pas tout ce qui se fait au plan militaire sur le théâtre? Ou que des éléments de l'armée syrienne elle-même agiraient en électrons libres ou auraient été «retournés»? À qui profite le crime? C'est cette vieille question, mais toujours pertinente, qui paraît désormais indécente.
Quel serait pourtant l'intérêt de la Russie de laisser perpétrer une telle attaque, alors que, ne nous en déplaise, bien davantage que notre «Coalition internationale», elle cherche la paix, l'organise pragmatiquement, et est la seule depuis sept ans à engranger quelques résultats qui évidemment contreviennent à nos intérêts et à ceux de nos alliés régionaux?
On semble aussi avoir totalement oublié une donnée fondamentale du conflit: les malheureux civils de la Ghouta, comme ceux des ultimes portions du territoire syrien encore aux mains des «rebelles» djihadistes ou de Daech, sont des boucliers humains, peut-être même, en l'espèce, sacrifiés par ces mêmes apprentis démocrates suppôts d'al-Qaïda et consorts pour entraîner l'Occident dans une guerre ouverte avec Moscou et Téhéran.
Car si l'on quitte le microscope pour la longue-vue, il est permis de décrire à partir de cette dernière séquence syrienne un contexte stratégique global infiniment préoccupant pour l'Europe, et singulièrement pour la France, qui risque de prendre les avant-postes d'une guerre qui n'est pas la sienne, dont elle fera les frais et qui neutralisera durablement l'ambition présidentielle affirmée de prendre le leadership politique et moral de l'Union européenne. Nos amis allemands ou italiens sont d'ailleurs moins cynico-idéalistes, mais plus prosaïques que nous. Ils avancent prudemment, vont et viennent entre Beyrouth et Damas pour pousser leurs pions en cette phase douloureuse et recueilleront les fruits de notre marginalisation radicale quand la reconstruction syrienne arrivera.
La ficelle est si grosse et la pelote si bien déroulée depuis des mois qu'on ne la voit plus en effet. On punit la Russie. On la punit d'être la Russie, déjà, et d'avoir réussi son retour sur la scène mondiale. On la punit de vouloir la paix en Syrie et de chercher à la mettre en musique politiquement à Astana ou à Sotchi. On la punit d'avoir sauvé Damas et son régime diabolisé du dépècement qu'on leur promettait et qui s'est fracassé sur la résilience populaire et gouvernementale syrienne et a déjoué partiellement au moins la confessionnalisation des affrontements politiques et sociaux que l'Occident encourage, sans en comprendre le danger insigne pour ses propres sociétés, et notamment en Europe.
La guerre en Syrie a été gagnée militairement par l'armée gouvernementale. Militairement, mais pas politiquement. Cette victoire sur le terrain au prix d'une guerre brutale (comme toutes les guerres, même celles menées depuis les airs et qui n'ont de chirurgicales que le nom), nous est proprement insupportable car cela nous force à faire la paix, ce que nul ne veut mis à part… Moscou. Ah, Moscou! L'impudent Vladimir Poutine trop bien réélu qui nous nargue avec sa coupe du monde, où des millions de gens vont découvrir un visage de la Russie qui ne les terrifiera pas.
Et puis derrière Moscou, on vise évidemment Téhéran, dont Israël, en pleine idylle officielle avec le centre mondial du salafisme - l'Arabie saoudite - qui a toutefois opportunément décidé de faire peau neuve, ne peut tolérer l'émergence régionale, tant le niveau sociétal, culturel, technologique et commercial de ce pays lui fait de l'ombre bien au-delà de la seule crainte d'un (dés)équilibre stratégique modifié par sa nucléarisation ultime.
Bref, nous sommes en train de tomber dans un vaste piège qui se joue sur plusieurs fronts, et de nous ruer, en croyant ainsi exister, sur le premier os qu'on nous jette. De ce point de vue, l'affaire Skripal pourrait bien n'avoir été que le hors-d'œuvre de la séquence actuelle. Elle a posé le premier étage d'une repolarisation politique et sécuritaire de l'Europe autour de Londres, et surtout sous la bannière de l'OTAN. Car c'est là l'ultime manœuvre: remettre au garde-à-vous les Européens qui, depuis l'arrivée de Donald Trump et le Brexit, s'étaient pris à rêver d'une autonomie européenne en matière de politique et de défense… Péril suprême pour le leadership américain sur le Vieux Continent, heureusement contrebalancé par les rodomontades de quelques nouveaux européens qui refusent leur arasement identitaire et mettent à mal tout projet d'affranchissement sécuritaire collectif. Le Secrétaire américain à la défense, le général Mattis, a d'ailleurs été très clair: les Européens doivent en effet consacrer 2 % de leur PIB à la défense, mais pour acheter des armes américaines et demeurer dans l'orbite otanienne évidemment, l'Alliance constituant le cadre naturel et nécessaire de la défense de l'Europe. Fermez le ban!
Nous sommes donc en train d'être clairement repris en main par l'OTAN, mais on ne s'en rend pas compte car on nous vend la nécessité d'une solidarité sans failles, donc manichéenne, face à une «offensive russe» pour diviser l'Europe (comme si nous n'étions pas assez grands pour nous diviser nous-mêmes) et dominer le Levant. C'était probablement l'objet de l'affaire Skripal comme de la présente montée au front sur la Syrie. La volte-face aujourd'hui même d'Angela Merkel sur le projet Northstream-2 ne fait qu'amplifier cette polarisation. Moscou est poussé à se crisper donc à s'isoler par tous les moyens. Par les sanctions, par les vrais faux empoisonnements d'espions en plein Londres et jusqu'à cette décision allemande qui ne peut que durcir la position russe en Syrie et assurer la montée des tensions, le Kremlin n'ayant plus d'autre alternative que de jouer le tracé Qatari qui passe par la Syrie… Redoutable manœuvre anglo-américaine donc, à laquelle Paris et Berlin semblent ne voir que du feu.
Il faut donc s'y résoudre: l'Amérique d'Obama a vécu. Celle de Trump et de ceux - néoconservateurs de toutes obédiences - qui l'environnent très fermement désormais, a radicalement changé de posture. Certes le président américain annonce son souhait de quitter la Syrie, mais il avoue pouvoir changer d'avis si l'Arabie saoudite payait le coût de cette présence! On ne peut être plus clair et c'était aussi tout le sens de son premier voyage à Riyad au printemps dernier: réassurer l'allié du Quincy (dont le Pacte éponyme était rendu caduc par la nouvelle indépendance énergétique américaine) contre 400 milliards de dollars de contrats pour l'économie américaine. Et puis, tandis qu'il déclare au grand dam de ses généraux et pour tromper son monde qu'il veut partir, il se consolide une vaste zone d'influence américaine à l'est de l'Euphrate avec les FDS arabo-kurdes.
Washington, dans le vaste mouvement de repolarisation du monde, entend en tout état de cause demeurer le môle principal d'arrimage d'un Occident qui doute face à une Chine qui structure à son rythme et via un affrontement de basse intensité mais tous azimuts, un véritable «contre-monde». L'Amérique, fébrile, joue son va-tout pour renverser la vapeur d'un ordre international qu'elle ne contrôle plus mais qu'elle veut encore dominer coûte que coûte. Elle veut l'affrontement pour réinstaller sa préséance face à Moscou, Téhéran et Pékin, cible ultime de l'intimidation. C'est là pourtant un combat profondément à contresens de l'évolution du monde. Affligés du syndrome postmoderne de la vue basse et celui de l'hybris technologique, nous oublions que la vie est longue.
Au-delà, cette affaire, comme d'innombrables autres, met en évidence une évolution dangereuse: la substitution à la réalité non d'une image déformée, mais carrément d'une autre réalité et le retour de la tentation de la guerre préventive préemptive, qui évite d'enquêter. La question est vraiment très grave pour l'essence même de la politique internationale. Préfère-t-on l'image au réel, les fake news à l'analyse, le sensationnalisme à la rigueur?
Alors que voulons-nous? Ce sera bientôt clair: si nous voulons sauver la Syrie, il nous faut surtout ne pas nous joindre à une coalition qui agira hors de tout mandat de l'ONU et qui portera le poids d'une guerre dont le peuple syrien est la dernière roue du carrosse et sera la victime immédiate. La grande question est donc: mais que vient faire Paris dans cette galère? On se trompe comme souvent d'ennemi, d'allié, de posture, de tout en somme. Et si l'on essayait l'audace, le courage et la singularité? Notre siège au Conseil de Sécurité, que guigne l'Allemagne de plus en plus ouvertement, en serait relégitimé. Nous posons-nous seulement la question de notre intérêt national (qui ne se réduit pas à des contrats d'armement) et des raisons pour lesquelles on nous sert ainsi l'injonction d'un alignement sur le thème du Bien contre le Mal et de la guerre préventive?
La France est désormais, en Syrie comme ailleurs, au pied du mur. Elle a l'occasion inespérée de faire valoir une approche prudente et rigoureuse, une voix pour la paix, une singularité. Nous avons déjà une influence au plus bas dans la région. Si nous voulons compter de nouveau, nous devons regarder la réalité dans les yeux et admettre que «nous avons eu tout faux» depuis 2011. Il n'est jamais trop tard et notre président peut encore choisir de compter véritablement au regard de l'Histoire et dans le cœur des peuples
Une guerre contre l'Iran et la Russie n'est pas la nôtre. Elle ne correspond nullement aux intérêts stratégiques français, ni à ceux de l'Europe. Nous avons déjà si naïvement collé aux Britanniques qui veulent quitter l'Union, sans preuve et par principe, dans l'affaire Skripal. Pourquoi cette fuite en avant?
Dans ce nouveau grand jeu, la France a encore l'opportunité inespérée de compter plus que son poids démographique ou même économique ne le lui permet, en affirmant une singularité et une cohérence. Plus que jamais le réalisme, aux antipodes du cynisme, doit être le bouclier et la lance de notre nouvelle posture internationale. Il nous rapproche non d'une justice abstraite mais de l'équité et de la clairvoyance. La France n'a pas le droit et aucun intérêt à être malhonnête dans son interprétation des faits. Elle a tout à gagner à la lucidité et elle doit d'urgence montrer au monde comme aux peuples et pouvoirs du Moyen-Orient qu'on ne l'égare ni ne la soumet si facilement.
Caroline Galactéros (Figaro Vox, 11 avril 2018)