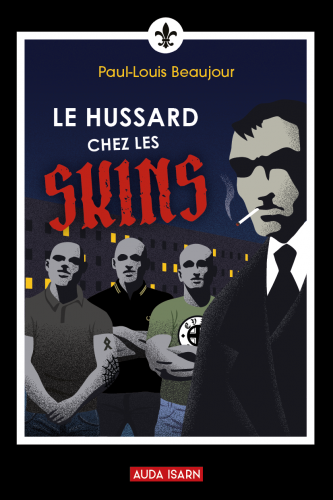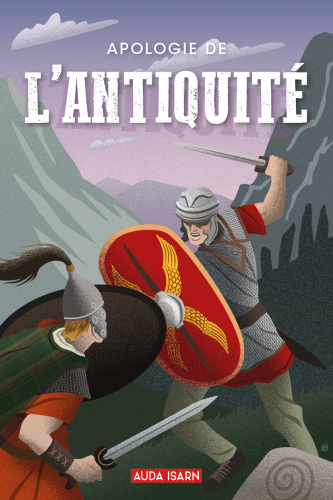La Bretagne, nouvelle colonie de la criminalité importée ? Basta !
Il faut avoir le courage de dire ce que tout le monde voit mais que personne n’ose énoncer publiquement — parce que la vérité, aujourd’hui, est parfois devenue un délit. De Nantes à Brest, de Rennes à Saint-Brieuc, les tirs résonnent, les fusillades se répètent, le deal prospère comme jamais, et les médias nous parlent encore de « jeunes », de « Parisiens », de « tensions entre quartiers ». La liturgie anesthésiante du déni.
Mais nous n’avons plus le temps. La Bretagne étouffe. La Bretagne saigne. La jeunesse bretonne va mourir.
Les balles sifflent désormais dans nos rues, et l’on nous intime encore de sourire, d’applaudir, de célébrer le « vivre-ensemble ». Vivre-ensemble ? Non. Survivre sous contrôle narco-ethnique, voilà le programme qu’on nous impose.
Car il faut cesser de tourner autour du pot : les réseaux qui inondent nos villes ne viennent pas de la lande ni des monts d’Arrée. Ils ne sont pas celtes. Ils ne sont pas bretons. Ils sont le produit direct de la politique migratoire massive, incontrôlée, délirante menée depuis vingt ans avec la bénédiction des élus régionaux, de l’État, des technocrates du ministère, et des éditorialistes qui vivent en centre-ville sécurisé.
Afriques francophones, Maghreb, Europe sud-balkanique qui arrivent en Bretagne via les métropoles françaises, via les politiques de la ville… on sait. Tout le monde sait. Mais personne, dans les grands journaux subventionnés, n’a les tripes de le dire (à moins que ce ne soit volontaire ?).
On parle de « jeunes d’origine parisienne ». Ou de « jeunes locaux » pour rappeler aux lecteurs que, parce que vivants en Bretagne, ils seraient des Bretons comme « vous et moi ».
Traduction pour ceux qui ne sont pas idiots : bandes afro-maghrébines et réseaux importés des banlieues françaises. Toutes les sources le démontrent. Il n y a pas de gangs de Suèdois, ni de gangs d’Argentins, en Bretagne. Pas non plus de vrais gangs dirigés par des autochtones même si certains d’entre eux servent de petites mains dans des réseaux qui essaiment aussi en ruralité. On qualifie de « conflits de territoire » des règlements de compte à l’arme de guerre.
On nomme « incivilité » un kidnapping en rase campagne. On maquille le réel comme un cadavre qu’on pompe pour lui donner bonne mine.
Ce n’est pas un fait divers. C’est une conquête territoriale.
À Rennes, Villejean devient un far-west métissé où l’on tire pour un point de coke. À Nantes, on voit tomber des corps dans la Loire. À Brest, des quartiers entiers vivent sous économie parallèle. À Vannes, Lorient, Quimper, les réseaux avancent, infiltrent, recrutent.
Les caïds dictent leur loi et les élus posent des fresques « contre la discrimination ».
Les politiques regardent ailleurs, pleurent sur « les quartiers oubliés », financent des associations-passerelles qui servent de couverture et libèrent des subventions pour acheter la paix sociale — une paix achetée comme on paye un racket.
Ils ne protègent pas les Bretons. Ils négocient avec ceux qui les menacent.
Et ils veulent que nous trouvions ça normal.
Soit nous continuons à nous coucher, en acceptant la transformation accélérée de la Bretagne en zone métastable, mosaïque ethnique sous contrôle de trafiquants. Soit le peuple breton — ce qu’il en reste encore de debout, d’insoumis, de lucide — ouvrira enfin les yeux et dira : STOP.
Déjà, la lassitude monte. Déjà, le murmure devient grondement. Les Bretons, peuple long à s’échauffer mais impossible à soumettre, savent ce qu’est la reconquête. Nos ancêtres ont repris leur terre à la pointe de l’épée ; aujourd’hui, on nous demande d’abandonner nos rues, nos villes, notre identité pour ne pas heurter quelques élus trouillards, et la presse subventionnée.
Eh bien non. Pas ici. Pas chez nous.
Nous ne voulons plus mourir dans le silence. Nous ne voulons plus être spectateurs. Nous ne voulons plus être complices par résignation.
Dehors les trafics, et les narco trafiquants, dehors ceux qui les organisent, dehors ceux qui les couvrent. Au tribunal tous ceux qui ont permis la destruction d’une société qui vivait parfaitement ensemble sans ces individus. Les Bretons méritent autre chose que la soumission polie et la peur nocturne. Nos villes ne doivent pas devenir les laboratoires d’un modèle multiculturel déjà effondré ailleurs.
La Bretagne n’est pas à vendre. Et encore moins à piller Basta. Stop. Harz !
Julien Dir (Breizh-Info, 9 décembre 2025)