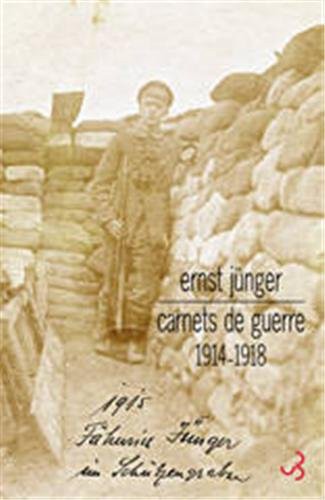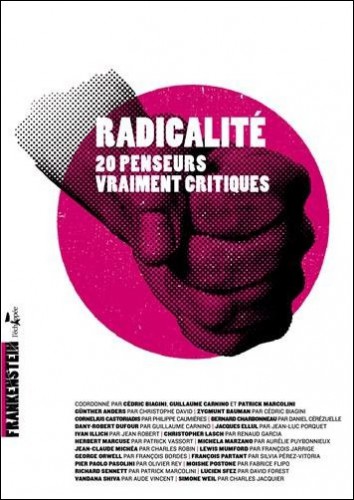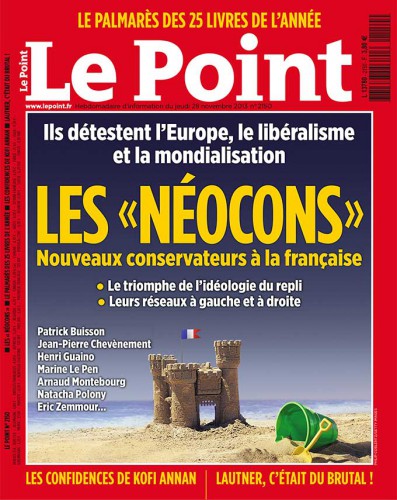Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré à l'omniprésence de la technique dans nos vie...

Facebook ? Le simulacre des « amis » sans amitié...
Naguère, les polémiques politiques venaient d’émissions fracassantes à la télévision ou de dépêches de l’AFP. Aujourd’hui, c’est Twitter ; soit le règne de l’immédiateté. Comme si le temps de la réflexion avait tendance à se raccourcir…
Toutes les dimensions constitutives de la temporalité sont aujourd’hui rabattues sur le moment présent. Ce « présentisme » fait partie de la détresse spirituelle de notre époque. Twitter n’en est qu’un exemple parmi d’autres. L’importance qu’on donne aujourd’hui aux tweets est une sorte d’assomption métaphysique de la brève de comptoir. Elle mesure une déchéance. C’est la raison pour laquelle je ne « tweete » jamais. Je n’ai pas non plus de compte Facebook. Je n’utilise ni « smartphone », ni « Blackberry », ni tablette tactile, ni iPad, ni iPod, ni aucun autre gadget pour petits-bourgeois numérisés et connectés. D’ailleurs, je me refuse même à avoir un téléphone portable ; car l’idée de pouvoir être joint en permanence m’est insupportable. La disponibilité totale relève d’un idéal de « transparence » totalitaire. Il faut lui opposer des opacités bienfaisantes.
Vous êtes technophobe ?
Je ne suis pas technophobe, mais je suis profondément préoccupé par ce technomorphisme qui transforme nos contemporains en prolongement de leur télécommande ou en terminal de leur ordinateur. Je crois que la technique n’a rien de neutre, et qu’elle cherche à nous soumettre à sa logique propre. De même que ce n’est pas nous qui regardons la télévision, mais la télévision qui nous regarde, ce n’est pas nous qui faisons usage de la technique, mais la technique qui se sert de nous. On le réalisera mieux encore quand nous aurons des codes-barres et des puces RFID insérés sous la peau – ou lorsqu’on aura réalisé la fusion de l’électronique et du vivant. On ne peut, dans le monde actuel, faire l’économie d’une réflexion sur la technique, dont la loi première est que tout ce qui devient techniquement possible sera effectivement réalisé. Comme l’écrit Heidegger, « Nous pouvons utiliser les choses techniques, nous en servir normalement, mais en même temps nous en libérer, de sorte qu’à tout moment nous conservions nos distances à leur égard. Nous pouvons dire “oui” à l’emploi inévitable des objets techniques et nous pouvons en même temps lui dire “non”, en ce sens que nous les empêchions de nous accaparer et ainsi de fausser, brouiller et finalement vider notre être. » Dans le rapport à la technique, c’est l’humanité de l’homme qui est en jeu.
On peut certes gloser sur ce « bougisme » que nous impose Internet. Mais au moins a-t-il l’avantage de permettre aux citoyens de base que nous sommes de prendre part au débat. Vous qui n’aviez rien contre la « démocratie participative » prônée par Ségolène Royal lors de l’élection présidentielle de 2007, quelles éventuelles réflexions ce changement de donne peut-il vous inspirer ?
Comme toute forme de démocratie, la démocratie participative exige un espace public où puisse s’exercer la citoyenneté, c’est-à-dire d’un espace radicalement distinct de l’espace privé où se meut la « société civile ». Internet fournit des sources d’information alternatives, mais il est avant tout un outil de surveillance totale. Rapporté aux exigences démocratiques, il n’est qu’un simulacre. Jean Baudrillard l’avait déjà dit il y a vingt ans : nous vivons au temps des simulacres. Les touristes qui visitent la grotte de Lascaux n’en visitent aujourd’hui qu’une copie. En ce moment, un théâtre parisien propose un opéra « virtuel » où la cantatrice vedette n’est qu’une image de synthèse, un hologramme. Les imprimantes en trois dimensions peuvent désormais produire des répliques d’œuvres d’art qui ne se distinguent plus de l’original, relief compris. Elles produiront demain des organes humains. Walter Benjamin avait écrit en 1935 un beau texte méditatif sur « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique ». Nous n’en sommes déjà plus là, car la réplique va très au-delà de la copie. Elle abolit même la notion de copie. Le virtuel est cette catégorie immatérielle dans laquelle nous fait vivre le monde des écrans. Il ne relève ni du réel, ni de l’irréel, ni même du surréel. Il relève de cet hyperréel qui prend peu à peu la place de la réalité sans que nous nous en rendions compte. À terme, c’est l’univers de Matrix qui se dessine à l’horizon.
Dans votre revue Eléments, dont vous fêtez cette année le quarantième anniversaire, vous évoquez souvent la perte du lien social. Si on vous objecte que les « réseaux sociaux » peuvent être une façon de le retisser, cela vous fait-il sauter au plafond ?
Cela me fait plutôt sourire. Ces « réseaux sociaux » n’ont de « sociaux » que le nom. Ils ne proposent eux aussi qu’un simulacre de socialité. Avec Facebook, on noue des liens avec des « amis » qu’on ne verra jamais, on visite des pays où l’on ne mettra jamais les pieds. On bavarde, on se défoule, on se raconte, on inonde la terre entière de propos insignifiants, c’est-à-dire qu’on met la technique au service du narcissisme immature. La dé-liaison sociale est le fruit de la solitude, de l’anonymat de masse, de la disparition des rapports sociaux organiques. Elle résulte du fait que l’on se rencontre de moins en moins. La socialité véritable exige l’expérience directe que le monde des écrans tend à abolir. La seule utilité de Facebook est de mettre à la disposition de la police plus d’informations sur nous-mêmes qu’aucun régime totalitaire ne pouvait hier espérer en rassembler. Libre aux naïfs de contribuer eux-mêmes à renforcer les procédures de contrôle dont il leur arrive par ailleurs de se plaindre !
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 1er décembre 2013)