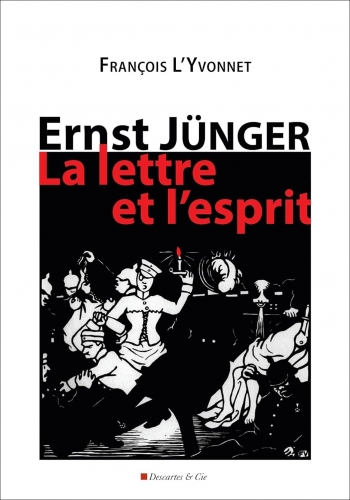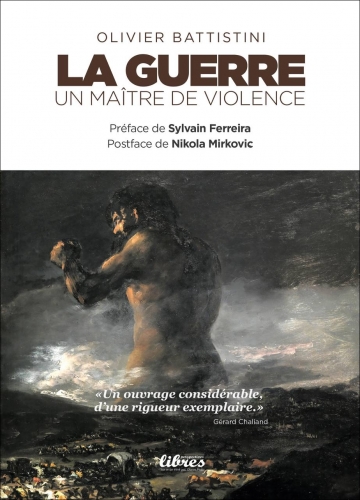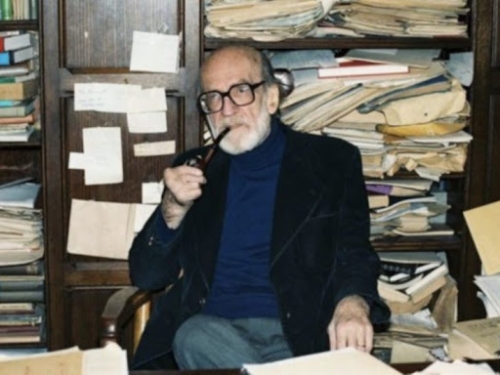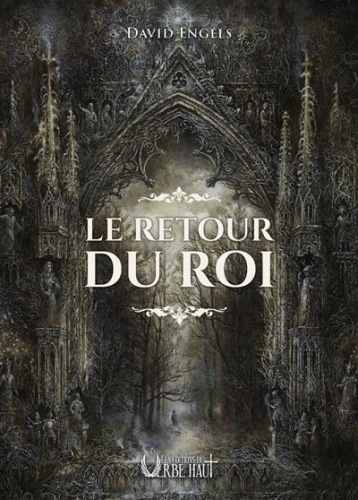Pierre Le Vigan: Entretien sur Mircea Eliade
1. Comment Mircea Eliade articule-t-il la notion de « sacré » dans ses travaux, et en quoi cette conception se distingue-t-elle des approches purement sociologiques ou phénoménologiques du religieux?
En tant qu’historien des religions, Eliade utilise la notion de sacré comme fil conducteur de son enquête. Pour lui, le sacré consiste en un lien permanent, au-delà de la mort, entre l’homme et le collectif. Le sacré suppose le « nous ». C’est pourquoi il n’y a que les sociétés individualistes qui peuvent prétendre se passer de sacré. Le lien du sacré consiste à être relié par quelque chose qui dépasse le domaine de l’immédiat. Cet au-delà de l’immédiat n’est pas pour autant le contraire du sensible. C’est un sensible qui passe par des archétypes. C’est un sensible au-delà du naturel – surnaturel – qui dévoile quelque chose. C’est pourquoi le sacré se manifeste par une épiphanie. La conception d’Eliade est avant tout mythologique. « Le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des ‘’commencements’’. » (Aspects du mythe, 1962). Images et mythes donnent sens à l’espace, au temps, et rendent compte de ce qui est originel dans le monde. C’est ce qui est à l’origine qui a le plus de force.
2. Dans quelle mesure la théorie de l’ « éternel retour » chez Eliade peut-elle être interprétée comme une réponse à la désacralisation du temps historique et plus généralement à la crise de la Modernité?
Dans sa recherche pour faire apparaître la morphologie du sacré, Eliade rencontre partout le thème de l’éternel retour. Le sacré consiste dans la célébration de l’éternel retour des commencements. Un retour qui se fait par la réactivation d’archétypes, c’est-à-dire par la répétition des mythes d’origine, non sans métamorphoses et variantes. « Un objet ou acte ne devient réel que dans la mesure où il imite ou répète un archétype. L’homme des cultures traditionnelles ne se reconnaît comme réel que dans la mesure où il cesse d’être lui-même et se contente d’imiter et de répéter le geste d’un autre. » (Le mythe de l’éternel retour, 1949). Il s’agit ainsi de redevenir périodiquement le contemporain des dieux, en partageant avec eux l’accès à l’Etre qui nous est commun, aux hommes et aux dieux.
L’éternel retour suppose ainsi une conception cyclique du temps. Dans cette conception, il peut y avoir coïncidence des contraires, un thème qui a passionné le jeune Eliade lors de ses études, en 1928, sur Marcile Ficin, Giordano Bruno et la Renaissance italienne. Il y a néanmoins des exceptions à la conception cyclique du temps. Ce sont les monothéismes (judaïsme, christianisme, islam). Ces derniers adoptent une conception linéaire du temps. Toutefois, le caractère cyclique des rites corrige cet aspect. Si le mouvement du temps, cyclique ou linéaire, est ce qui laisse apparaitre le sacré (hiérophanie), c’est dans le registre de l’éternel, du permanent, de ’’ce qui ne passe pas’’, que se situe le sacré. Celui-ci est verticalité, axe du monde et arbre du monde. Ce sens de la verticalité est universel. On retrouve partout les prières au Père céleste. Le ciel tient toujours une place éminente dans le sacré. Le mythe serait que Dieu, après avoir créé la terre et les hommes, aurait, dans tous les sens du terme, pris de la hauteur et serait monté au ciel.
En tout état de cause, le recours au sens de la verticalité (et du Père) est l’antidote à l’horizontalisation qui est le propre du monde moderne. A une condition toutefois : ne pas nier l’importance du sensible, de l’immédiat, du terrestre, du quotidien. Car si le quotidien n’est pas le sacré, c’est le terreau du sacré. Aussi, l’opposition entre le sacré et le profane est-elle, en fait, plutôt une complémentarité. « Lorsque quelque chose de "sacré" se manifeste (hiérophanie), en même temps, quelque chose "s'occulte", devient cryptique. Là est la vraie dialectique du sacré : par le seul fait de se montrer, le sacré se cache ». (Fragments d’un journal, 1973). Sachant que, en outre, dans certaines conditions, le profane peut devenir le sacré (avant-propos à Le sacré et la profane, 1965). Sacré et profane sont ainsi deux modes d’être au monde. « En dernière instance, les modes d'être sacré et profane dépendent des différentes positions que l'homme a conquises dans le Cosmos ; ils intéressent aussi bien le philosophe que tout chercheur désireux de connaître les dimensions possibles de l'existence humaine. »
3. Comment Eliade justifie-t-il sa méthode comparatiste dans l'étude des mythes et des symboles ? Cette méthode ne suppose-t-elle pas de postuler l'existence de structures fondamentales du religieux?
Comparer suppose une échelle de comparaison, donc un étalon universel. Pour Eliade, c’est l’universalité de l’aspiration au sacré. Dans son enquête comparative sur les différentes manifestations du fait religieux, Eliade ne se contente pas de montrer l’influence de l’histoire et la culture. Bien entendu, le fait religieux est historico-culturel. (Exemple : le culte de la Terre-Mère a un lien, souligne Eliade, avec la découverte de l’agriculture). Mais il n’est pas que cela. Il est anthropologique. Il relève d’une exigence universelle de produire des mythes, des symboles, des images. De faire vivre un imaginaire. Si l’idée du divin est universelle, elle se manifeste sous des formes spécifiques selon les peuples. « Les formes historico-religieuses ne sont que les expressions infiniment variées de quelques expériences religieuses fondamentales. » (Fragments d’un journal). Le sacré est le passage entre l’Idée et la forme, pour le dire avec les mots de Platon. Mais selon Eliade, l’homme moderne post-religieux s’est débarrassé de l’idée du divin. L’homme moderne ne donne plus sens au monde à partir du divin, c’est à partir de l’idée d’une harmonie cosmique qui englobe les hommes, la nature et transcende le temps historique. Le temps : image mobile de l’immobile éternité. Au contraire, l’homme moderne donne un sens au monde uniquement à partir de sa liberté inconditionnée. L’homme se désacralise lui-même et « ne sera véritablement libre qu’après qu’il aura tué le dernier Dieu » (Le sacré et le profane). Il y a ici une proximité entre ce que dit Eliade et les propos de Nietzsche et d’Heidegger. Or, même le plus acharné des positivistes n’échappe pas à la quête de l’origine et au souci d’élucider la généalogie de l’homme, souci à la fois scientifique et métaphysique. « La science du côté du jour, la poésie du côté de la nuit », dit Eliade (L’épreuve du labyrinthe, 1978). Même les scientismes sont des mythologies laïcisées. Même les idéologies messianiques se voulant laïques sont des formes de théologie politique. Eliade suit ici Carl Schmitt plutôt que Hans Blumenberg ou Erik Peterson.
Toutefois, ces théologies politiques modernes sont strictement adossées à l’histoire (le Reich pour 1000 ans, la succession inéluctable des modes de production jusqu’à l’étape finale du communisme), ou, pire, à une vision de l’homme post-politique, donc revenant sur les acquis d’Aristote, comme l’eschatologie libérale d’un homme totalement déconditionné de ses invariants historiques, culturels et même anthropologiques. Avec le transhumanisme comme point d’aboutissement de l’aventure humaine. Ultime grand récit progressiste. Un homme transhistorique et transgenre. Or, ces théologies politiques modernes (même quand elles se veulent post-politiques, ce qui revient à transférer le politique dans l’économique) ne sont pas de nature à chasser l’angoisse de l’homme, nous dit Eliade. Elles sont trop fragiles. C’est pourquoi l’homme moderne n’échappe pas au sentiment de l’absurde (Albert Camus) et à l’angoisse, voire à la terreur existentielle qui l’accompagne. C’est la rançon, dit Sartre, de la plus totale liberté. Totale liberté ou liberté illusoire ? C’est là la question.
Dans son constat de ce que l’éloignement de la religion provoque une augmentation de l’angoisse de l’homme face à une histoire qui perd son sens et apparait, dès lors, chaotique, Eliade postule l’existence de structures fondamentales du religieux. Elles permettent d’opposer le monde traditionnel, même si les formes religieuses qui l’innervent sont très variées, au monde moderne, qui a laissé dépérir ces formes. On ne s’étonnera donc pas du fait qu’Eliade admirait René Guénon. Toutefois, dans ces structures du religieux, nous savons que les monothéismes occupent une place à part par la conception linéaire du temps. Le christianisme est lui-même très singulier au sein des monothéismes. Il accepte que le sacré entre dans l’histoire. ’’Dieu s’est fait homme’’ est un événement à la fois historique et ontologique. Cela doit permettre à l’homme de sortir de l’angoisse de l’histoire. Mais dans le même temps, Eliade montre que le christianisme est la religion de l’homme qui ne croit plus à l’éternel retour ni aux archétypes primordiaux. C’est en ce sens, dit Eliade, la religion de l’ « homme déchu » (le thème du péché originel y est bien sûr pour quelque chose).
4. Quelle est la place de l’expérience personnelle et autobiographique dans la construction de la pensée religieuse d’Eliade ?
On ne peut dissocier les analyses d’Eliade des questions qui le hantent. Celles-ci tournent autour de l’histoire et du cortège de malheurs qu’elle véhicule. D’où son rejet de l’historicisme. Sa conception de l’histoire comme source d’angoisse est proche de celle de Walter Benjamin. Le sacré est re-création du monde. Contre les malheurs de l’histoire. Contre l’histoire comme malheur. Eliade écrit : « Que peut signifier ’’incipit vita nova’’ ? La reprise de la Création. Le combat de l’homme contre l’ ’’histoire’’, contre le passé irréversible. » (Journal, 5 septembre 1943). Eliade est un esprit inquiet. Très marqué par son enfance, il publie tôt un roman autobiographique, « Le roman de l’adolescent myope ». La question de l’identité, personnelle et collective, est très vite son thème principal. Il n’hésite pas à l’explorer en « se quittant lui-même », par des voyages, par le yoga, et aussi par des amours passionnés. Ses divers écrits littéraires témoignent de son intérêt pour une alchimie de l’érotisme. C’est bien entendu en fonction de cet éclairage – la fascination pour ce qui est initial – qu’il faut comprendre ses sympathies pour la Garde de Fer, aussi appelé le « mouvement légionnaire » de Codreanu (Ce dernier sera assassiné en 1938), des sympathies du reste partagées par nombre de grands intellectuels roumains comme le philosophe Nae Ionescu et le jeune Cioran. Il s’agit pour Eliade de viser à une résurrection de la Roumanie. Ses sympathies, non inconditionnelles, pour ce mouvement nationaliste profondément mystique, sont une manifestation de son rejet de la modernité. Il n’oppose toutefois pas la spiritualité au corporel. C’est le dualisme corps–âme qu’il rejette.
5. Finalement, peut-on considérer l’œuvre d’Eliade comme une tentative de réenchantement du monde ?
Max Weber a parlé du désenchantement du monde (Entzauberung der Welt) comme conséquence du rationalisme et de la technique. Eliade aspirait à un réenchantement du monde. Mais il pensait qu’il n’y a religion que quand Dieu n’est plus là. « (...) les mythes et les ’’religions’’, dans toute leur variété, sont le résultat du vide laissé dans le monde par la retraite de Dieu, sa transformation en deus otiosus [un Dieu qui crée le monde mais ne s’occupe pas de son destin, d’où son nom de ‘’dieu oisif’’] et sa disparition de l'actualité religieuse. (...) A-t-on compris que la ’’vraie’’ religion ne commence qu'après que Dieu s'est retiré du monde ? Que sa ’’transcendance’’ se confond et coïncide avec son éclipse ? » (Fragments d’un journal). Eliade espérait moins le renouveau des religions qu’il ne visait le retour du sacré.
Pierre Le Vigan (Euro-Synergies, 16 janvier 2026)