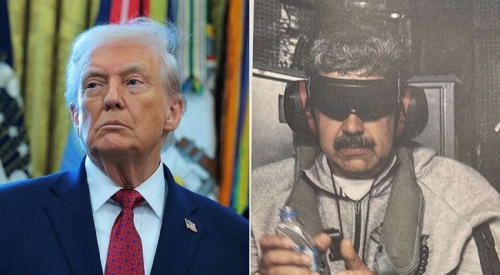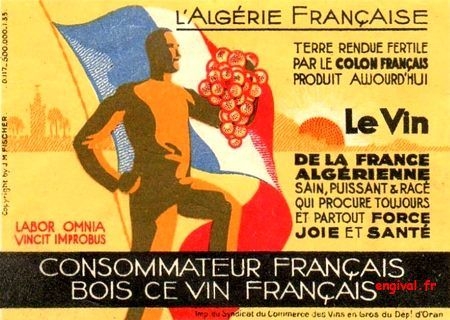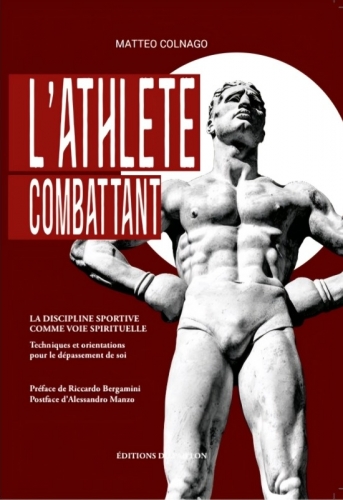USA/ Venezuela : géopolitique et retour aux réalités oubliées
« J’avais l’impression de regarder une série télévisée », aurait affirmé Donald Trump en regardant, en direct, l’équipée américaine au Venezuela. Passé l’effet de sidération médiatique, un état des lieux s’impose.
Le moins qu’on puisse prétendre est, qu’en France comme en Europe, les réactions demeurent de convenance, à l’exception de La France insoumise, résolument contre, et de Giorgia Meloni, présidente italienne du Conseil des ministres, résolument pour. Si les autres autorités, de l’Élysée au Rassemblement national, en passant par Les Républicains et le Parti socialiste, condamnent cette violation manifeste du droit international, le moins qu’on puisse dire est qu’elles ne s’indignent guère plus que ça. À quoi bon, d’ailleurs ? Certes, le discours de Dominique de Villepin à la tribune de l’ONU, en 2003, s’il avait sauvé l’honneur du Vieux continent, n’avait en rien empêché les USA de partir en guerre contre l’Irak avec le succès qu’on sait. Comme quoi le pouvoir de la parole ne compte que si sous-tendu par le pouvoir véritable, celui des armes. Si Villepin fut entendu ; Trump, lui, est écouté. La nuance est de taille.
Ne pas confondre Maduro et Chávez…
Autre nuance ayant manifestement échappée à nombre de nos confrères : Nicolás Maduro n’est pas Hugo Chávez. Le second fut un leader charismatique, populiste et nationaliste, doublé d’un bâtisseur, ayant été le premier chef d’État vénézuélien à vouloir sortir son pays du piège d’une rente pétrolière confisquée par les oligarchies locales en tentant de diversifier l’économie locale et en mettant tout en œuvre pour extirper le peuple d’une pauvreté structurelle. Une lutte qui s’inscrivait dans celle de son compatriote Simón Bolívar, l’homme qui, après avoir rompu avec la couronne espagnole, refusait la tutelle yankee sur l’Amérique latine. Une sorte de troisième voie d’alors, en quelque sorte.
Le parcours du premier est tout autre. Issu de la petite bourgeoisie de Caracas, il adhère tôt à La Ligue socialiste, un groupuscule marxiste, où il officie comme garde du corps avant d’être envoyé à Cuba, à l’école des cadres communistes. Un apparatchik sans réelle envergure donc, coupé des réalités d’un peuple qu’il ne connait finalement pas tant que ça. D’où cette dérive de plus en plus autoritaire qui répugnait à son auguste prédécesseur. Pour s’en convaincre, il suffit de relire Que la bête meure, l’un des meilleurs SAS consacrés au sujet, à l’occasion duquel Gérard de Villiers explique comment la CIA a protégé Hugo Chávez contre des tentatives d’assassinat ourdies par la haute société vénézuélienne, blanche il va de soi, contre celui qu’elle tenait pour un communiste à moitié Indien. La Maison-Blanche semblait alors tenir cet autocrate pour une personnalité respectable avec laquelle il fallait, bon an mal an, compter. Manifestement, cette époque n’est plus depuis longtemps.
La prégnance de la doctrine Monroe…
Après, comment dire, on s’étonne que nos confrères puissent faire mine de s’étonner devant un tel coup de force. Les plus érudits évoquent le retour de cette doctrine Monroe, développée dès 1823 par le président James Monroe qui annonçait que le Sud du continent américain avait vocation à être la chasse gardée de Washington. Depuis, les gouvernements ont pu changer d’étiquette, mais Démocrates et Républicains ont toujours appliqué la doctrine en question ; avec des gants, parfois, le plus souvent sans. Dès 1901, Cuba est occupé par les USA, alors que l’île vient tout juste de s’émanciper de Madrid, passant, de fait, d’une tutelle à une autre. Inutile de rappeler l’épisode tragicomique de la Baie des cochons, en 1961, quand la CIA tente de débarquer Fidel Castro, qui avait préalablement lui-même débarqué Fulgencio Batista, son prédécesseur installé au pouvoir par la Maison-Blanche. Hormis les putschs à répétition organisés en Amérique latine par les services secrets américains, on se souviendra de deux autres expéditions préfigurant celle qui vient d’avoir lieu au Venezuela.
En 1983, sous le premier mandat de Ronald Reagan, les forces spéciales américaines sont parachutées sur l’île de la Grenade, dont le gouvernement, mené par un Conseil militaire révolutionnaire, tend à se rapprocher du régime castriste. Si l’heure n’est pas encore aux séries télévisées, la dimension hollywoodienne de l’événement pousse Clint Eastwood à réaliser l’un de ses films les plus crétins, Le Maître de guerre (1986). En 1989, c’est au tour de George Bush d’envahir le Panama et d’y kidnapper son président, Manuel Noriega, pourtant agent quasi-officiel de la CIA, mais narcotrafiquant officieux. En 1992, il est condamné à quarante ans de prison par le tribunal de Miami.
Bref, et tel que plus haut rappelé, rien de bien neuf sous le soleil. Les nations fortes imposent leur loi aux pays faibles. D’ailleurs, que fut la Françafrique ? Des coups d’état à l’occasion desquels l’Élysée se débarrassait de potentats devenus encombrants pour les remplacer par d’autres, plus accommodants. Mais, autrefois, on y mettait les formes, de façon plus ou moins hypocrite. Le véritable changement, c’est que Donald Trump n’a que faire de ces bonnes manières. Il dit ce qu’il va faire et fait ce qu’il a dit. Au contraire d’un Woodrow Wilson par exemple qui, président américain de 1913 à 1921, fut à l’origine de la Société des Nations, cette instance internationale censée mettre fin à toutes les guerres, sans parvenir à empêcher aucune. Un humanisme qui ne l’encombre pas, en 1914, quand il s’agit d’envahir le Mexique et de s’y installer trois ans. Dans le même temps, il intervient militairement à Haïti et en République dominicaine, au motif que les intérêts américains y étaient menacés. Pas mal pour un pacifiste ; même si par ailleurs il était grand admirateur du Ku-Klux-Klan et à l’origine de la Prohibition. À ta santé, Woodrow…
L’effacement diplomatique de la France…
Il y a deux sortes de satrapes. Ceux qui se comportent comme tels et qui l’assument. Et ceux qui font de même tout en administrant des leçons de morale à la terre entière. À tout prendre, il n’est pas interdit d’opter pour les premiers. Donald Trump correspond assez bien à cette définition. Tout comme ses homologues russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Après, on est en droit de préférer Bernard Kouchner : tous les mauvais goûts sont dans la nature. Fortuitement, ce sont ceux des instances européennes, encore persuadées qu’une loi contre la guerre suffit à mettre la guerre hors la loi, alors la guerre a ses propres lois depuis que l’homme est homme ; celle du plus fort prévalant, généralement. En revanche, le génie de la diplomatie a longtemps consisté à les éviter, non point au nom d’un manichéisme infantile (défendre les gentils contre les méchants), mais en raison d’intérêts réciproques bien compris. Ainsi, la guerre d’Ukraine aurait pu être évitée si le Quai d’Orsay était devenu autre chose qu’une officine néoconservatrice sous influence américaine. Car ce sont bien les USA qui ont acculé la Russie à la guerre, tout comme ils l’avaient autrefois fait, en 1990, avec l’Irak, poussant Saddam Hussein à envahir le Koweït.
En ce sens, l’équipée américaine au Venezuela participe d’une toute autre logique, puisque, franchise trumpesque oblige, il affirme que ses armées sont là pour s’enrichir avec le pétrole local. Une telle honnêteté est proprement désarmante, si l’on peut dire en la circonstance. Idem pour ce Groenland qui pourrait bientôt connaître le même sort. Car malgré ses allures de brute inculte, Donald Trump semble avoir quelques lettres en matière historique. À ce titre, faut-il savoir qu’en 1867, les États-Unis proposaient déjà au Danemark de leur acheter ce fichu Groenland, offre renouvelée en 1946 par le président Harry Truman et, en 2019 par… Donald Trump, lors de son premier mandat. À croire que notre homme a de la suite dans les idées et que ce qui pourrait passer pour l’une de ses énièmes lubies, est de longue date ancrée dans la politique de la Maison-Blanche.
Après, objectent les derniers tenants de l’ordre international, ce qu’a fait Trump au Venezuela dédouane en quelques sorte ce que Poutine fait en Ukraine ou que Jinping pourrait faire à Taïwan. Ce n’est pas faux. Mais l’un ne ressent plus guère le besoin de se justifier, pas plus que l’autre n’aura éventuellement envie de faire de même, sachant qu’il estime que cette île fait partie intégrante de la Chine. Ce qui est d’ailleurs conforme au fameux “droit international”.
Mais, après la politique étrangère, quid de la politique intérieure ? Donald Trump a précisément été réélu pour pleinement s’y consacrer. D’où la colère d’une partie de son électorat MAGA à tendance isolationniste, qui voit mal l’intérêt qu’il y a à bombarder l’Iran pour le compte d’Israël et à maintenant envahir le Venezuela, en attendant que vienne le tour de Cuba ou de la Colombie. Ce d’autant plus que si ce raid éclair a été couronné de succès, avec sûrement des complicités intérieures au plus haut niveau, quid de la suite ? Il n’y a pas que les Arabes à savoir mener des guérillas, les Sud-Américains s’y connaissant plus qu’un peu. Soit un problème qui risque de bientôt se poser en termes électoraux, sachant que l’électorat hispanique, de plus en plus incontournable aux USA, a en partie fait sa victoire en 2025, pourrait le défaire à l’occasion des élections de mi-mandat qui s’annoncent. À force d’avoir trop de fers on feu, il peut arriver qu’on puisse se brûler. Une préoccupation qui, manifestement, n’encombre pas plus que ça les cervelles de nos technocrates bruxellois, incapable de comprendre que leur nouvel ordre international, ce chaos organisé, ne fut qu’une parenthèse hypocrite et que le réel reprend aujourd’hui ses droits. En admettant toutefois qu’il les ait un jour oubliés. Le passé a encore de l’avenir, dit-on.
Nicolas Gauthier (Site de la revue Éléments, 6 janvier 2026)