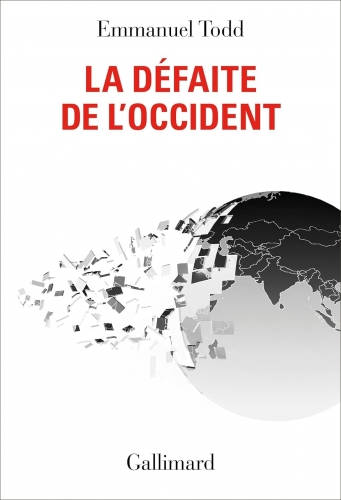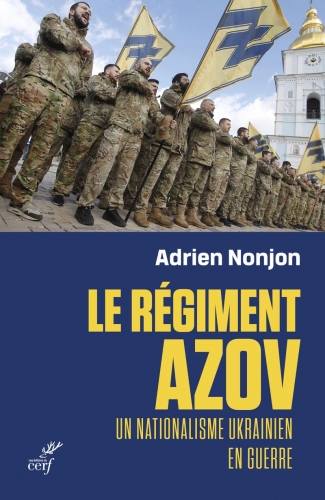Loin d’avoir été la marque d’une « fin de l’histoire », la dissolution de l’URSS en décembre 1991, négociée par trois partenaires (les dirigeants de la Fédération de Russie, de la Biélorussie et de l’Ukraine) pressés d’être les chefs d’Etats nouvellement indépendants, ouvrit la voie à des tensions tournant à la belligérance. Déjà, l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’étaient opposés (1988) avant même la fin de l’État créé par le pouvoir communiste. En 2008, l’armée russe envahit la Géorgie. En Asie centrale des négociations plus ou moins difficiles sur les frontières furent menées entre les anciennes républiques socialistes soviétiques de la région. Il n’y eut pas d’issue favorable entre le Tadjikistan et le Kirghizistan par rapport à une frontière difficile à délimiter dans la vallée de la Ferghana et des affrontements entre les deux pays débutèrent en mai 2021.
Le heurt majeur est intervenu en Ukraine, considérée par les Russes comme la source de leur histoire. En s’appliquant par des actions subreptices à détacher définitivement Kiev de Moscou, l’Amérique y a vu le moyen d’affaiblir définitivement la puissance russe.
Les Russes, après l’effondrement subi dans les années 1990, élirent à leur tête un dirigeant soucieux de rétablir la position d’un pays au passé prestigieux dont les frontières avaient été réduites à celles qui prévalaient avant l’accession au trône de Catherine II, voire même de Pierre le Grand. Vladimir Poutine avait, notamment, pour ligne que la Russie conserve une emprise sur son « étranger proche », constitué par l’essentiel des anciennes républiques socialistes soviétiques. Tout ceci dans une reconfiguration de la géopolitique mondiale où ont émergé de nouveaux pôles de puissance et où les Etats-Unis ont pour objectif d’assurer leur primauté.
La guerre engagée par l’armée russe
Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine, son armée attaquant sur quatre axes, au nord, à l’est et au sud. L’action principale au nord, marquée par la tentative de prise de l’aéroport d’Hostomel et destinée à la prise de Kiev échoua rapidement. Si aucun objectif assigné à son armée par le président de la Fédération de Russie ne fut annoncé, à l’évidence, au vu de la tournure des combats, ce premier engagement fut un échec. Il est possible que les concepteurs du plan se référèrent pour son élaboration à l’occupation de la Tchécoslovaquie en août 1968 et à la prise de Kaboul en décembre 1979 : maîtrise rapide de la capitale du pays et de ses différents centres de direction et neutralisation des dirigeants politiques.
Comme dans toutes les guerres, les informations fournies par les belligérants sont soumises au préalable à la censure et elles relèvent pour beaucoup d’entre elles de la propagande. Néanmoins, des experts reconnus ont offert, au fil des semaines, des études qui, au vu de leurs précisions et de leur maîtrise du domaine de la guerre paraissent correspondre à la réalité des combats en cours. Insuffisante en effectifs face à un adversaire nettement mieux préparé que prévu, l’armée russe a montré des failles au moins en termes d’organisation (déficience du commandement, graves défauts de l’encadrement…) et de logistique, difficultés déjà rencontrées durant la première guerre mondiale et lors de l’offensive allemande de 1941. Par ailleurs, elle n’a pas réussi à obtenir la suprématie aérienne, indispensable à la conduite d’une action en profondeur.
Face à cette armée russe, l’armée ukrainienne qui, à l’origine, n’était qu’un démembrement de l’Armée rouge de l’ancienne URSS, a bénéficié, au moins depuis 2014, sinon antérieurement, d’une assistance conséquente des puissances anglo-saxonnes, les États-Unis et le Royaume-Uni.
Malgré les revers des premières heures, l’armée russe a avancé en territoire ukrainien, s’emparant au sud de la rive occidentale de la mer d’Azov avec la prise de Marioupol puis franchissant le Dniepr pour prendre Kkerson. A l’est cette armée progressait dans la région du Donbass et au nord, elle s’implantait autour de Kharkiv.
L’armée ukrainienne qui a bénéficié dès le début d’importantes livraisons d’armes, en premier lieu des États-Unis mais aussi du Royaume-Uni, a été considérablement renforcée en matériels tout au long du printemps de l’année 2022, ce qui lui a permis d’éviter toute rupture du front et de préparer une contre-offensive pour le début de l’automne. En termes de planification, elle aurait bénéficié pour celle-ci des conseils d’experts américains hors d’Ukraine. Cette armée a ainsi pu reprendre au nord la région de Kharkiv, à l’est des portions de territoires du Donbass, occupées après le 24 février et, au sud, rejeter les troupes russes sur la rive orientale du Dniepr.
Face à cette situation, le commandement russe fut réorganisé. Une ligne de défense en profondeur dite « ligne Suvorikine » du nom du général qui commandait alors en Ukraine fut aménagée. Pour reprendre le territoire initialement perdu et franchir les défenses adverses, l’armée ukrainienne a bénéficié de la part des pays occidentaux et, en premier lieu, des États-Unis d’importantes quantités de munitions et de matériels, chars, artillerie, blindés de transports de troupes… Il s’agissait de préparer une contre-offensive déterminante. Engagée au début du mois de juin 2023, celle-ci n’a permis à l’automne suivant aucune avancée significative. Dans les semaines précédentes de violents combats avaient débuté autour de la ville de Bakhmount. Les forces russes, principalement composées, en ce lieu, par la milice Wagner, ont fini par s’emparer de cette ville. Comme dans le reste des opérations, les taux de perte, de part et d’autre, ont été fort élevés.
Il faut souligner, du côté de l’Ukraine, certaines faiblesses militaires inhérentes à sa situation :
- le matériel livré, d’une technique avancée, nécessite un temps de formation qui ne peut être accompli dans sa totalité, vu les circonstances et sa disparité complique la chaîne logistique ;
- outre l’emploi direct du matériel, les unités sont insuffisamment formées à la manœuvre d’ensemble ;
- le rapport démographique est défavorable à l’Ukraine.
Ce premier constat militaire ainsi fait, il importe d’analyser les origines de ce conflit avant de pouvoir en mesurer les conséquences et en entrevoir les solutions. Il est un aboutissement d’un processus qui a débuté après la chute de l’URSS, fruit, d’une part, d’une volonté américaine de reconfigurer la géopolitique mondiale aux bénéfices des États-Unis et, d’autre part, du président de la Fédération de Russie, élu en mars 2000, de maintenir une zone d’influence exclusive à l’intérieur des frontières qui constituaient l’URSS, héritière de l’empire des tsars, patiemment construit au fil des siècles, bordant la mer Baltique, la mer Noire et l’océan Pacifique.
La « fin de l’histoire » et l’exercice du « hard power » américain
A la dissolution de l’URSS, le 26 décembre 1991, l’Amérique apparue comme le vainqueur de « la guerre froide » sans avoir eu à combattre son adversaire. Celui-ci s’effondra de son seul fait, incapable de répondre aux défis des temps et aux aspirations d’une population frustrée de ne pouvoir jouir des mêmes libertés et des mêmes richesses qu’en Occident qu’elle percevait à travers un monde de communication de plus en plus ouvert.
Vainqueur sans le sacrifice du sang, l’Amérique dans les décennies mille neuf cent quatre-vingt-dix, sous la présidence de Bill Clinton, s’imagina que ses valeurs faites de démocratie et d’un libéralisme économique parfois effréné (pourvu qu’il soit à l’avantage de l’Amérique, protectionniste pour sa part lorsqu’elle considère qu’un quelconque de ses intérêts est menacé) devaient être diffusées à travers la planète sous son égide bienveillante. Ce fut le mythe de la fin de l’histoire. A côté de cet envol idyllique qui forgea pour partie la doctrine des néo-conservateurs, il y eut l’approche plus géopolitique incarnée par Zbigniew Brzeziński, exprimant sa vision dans son livre Le grand échiquier, paru en 1997. Là, au-delà des observations du moment, se trouve toute la filiation de la géopolitique anglo-saxonne, héritière d’Halford Mackinder. Thalassocratie plus encore que la Grande-Bretagne car séparés de l’immense ensemble eurasiatique et son prolongement africain par deux vastes océans, l’Atlantique et le Pacifique, les États-Unis ne pouvaient admettre qu’un quelconque équilibre puisse s’y former à leur détriment mettant alors en péril la primauté de leur puissance. Autre pilier qui allait guider l’action des néo-conservateurs.
Si Joseph Nye a théorisé, là aussi, dans les années mille neuf cent quatre-vingt-dix le concept de soft power comme facteur de diffusion de la puissance, les États-Unis, première puissance militaire du monde, ont largement usé de leur hard power dans les vingt années qui suivirent.
Alors que les États européens tentaient par des interventions sous l’égide de l’ONU de rétablir une paix dans une Yougoslavie à l’agonie où se déchiraient les entités qui l’avaient constituée autour d’une Serbie dominante, les États-Unis entrèrent dans la partie, d’abord diplomatiquement (accords de Dayton du 14 décembre 1995) puis militairement. En 1999, sans l’accord de l’ONU, les États-Unis et leurs alliés, engagèrent, au titre de l’OTAN, des opérations contre la Serbie pour l’obliger à évacuer sa province du Kosovo où la population d’origine albanaise devenue majoritaire à la suite des migrations du XXe siècle s’était insurgée pour exiger une séparation. Le Kosovo était le berceau de l’identité serbe. Les Serbes, peuple slave orthodoxe, avaient depuis longtemps une relation privilégiée avec les Russes ce qui fut l’une des causes de la première guerre mondiale. Mais cette fois le frère russe trop affaibli ne pouvait être d’aucune aide, il n’en fut pas pour autant indifférent. La Serbie après une vague de bombardement se soumit à la volonté américaine.
Puis survinrent les attentats du 11 septembre 2001. Coup d’éclat, opération de terreur sans stratégie de support, ayant pour objectif l’humiliation de l’Amérique, l’effondrement spectaculaire des deux tours du World Trade Center offrit l’occasion aux néo-conservateurs d’imposer leurs vues dans cette Amérique qui n’avait jamais été attaquée sur son sol depuis 1812.
Alors débuta un enchaînement guerrier. Par sa résolution 1368 du 12 septembre 2001 qui se référait à l’article 51 de la charte des Nations Unies sur le droit à la légitime défense des États, le Conseil de sécurité reconnut aux États-Unis le droit de répondre par une action militaire à l’acte terroriste dont ils avaient été la victime. Fort de cette résolution votée à l’unanimité du Conseil, les États-Unis entamèrent, dans la nuit du 7 au 8 octobre 2001, une campagne de bombardements à l’encontre d’Al Qaida et de ses hôtes talibans au pouvoir à Kaboul. Le 13 novembre suivant, les troupes de l’Alliance du Nord, appuyées par les Américains entrèrent dans la capitale afghane. Le 20 décembre 2001, le Conseil de sécurité adopta la résolution 1386 autorisant dans son premier article « la constitution pour six mois d’une force internationale d’assistance à la sécurité pour aider l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses environs, de telle sorte que l’Autorité intérimaire afghane et le personnel des Nations Unies puissent travailler dans un environnement sûr ». Le commandement de la force internationale fut confié à l’OTAN. La présence des forces occidentales dura près de vingt jusqu’à l’évacuation calamiteuse de Kaboul, le 15 août 2021, après la reprise de la capitale afghane par les Talibans.
S’inscrivant dans un projet de reconfiguration du « Grand Moyen-Orient », l’armée américaine envahit l’Irak le 20 mars 2003, violant la charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité avait refusé de donner son aval à cette opération militaire, l’intervention du ministre français des Affaires Étrangères, Dominique de Villepin, le 14 février 2003, restant l’évènement marquant des débats. Là aussi ce fut l’échec (voir Le Monde « Liberté en Irak », retour sur le fiasco de l’invasion américaine – 14 juin 2014). Les troupes américaines se retirèrent d’Irak, le 15 décembre 2011, sur la décision du président Obama.
Autre revers, l’intervention en Libye, cette fois menée par la France et le Royaume-Uni avec l’appui des États-Unis. Outrepassant les autorisations accordées par la résolution 1973 du Conseil de sécurité du 17 mars 2011, notamment dans ses articles 4 et 6, Français et Britanniques permirent l’élimination physique du chef d’État libyen. A ce jour, cet État n’existe plus, le pays est divisé, livré aux milices avec un gouvernement à Tripoli et un parlement à Tobrouk. La France a payé lourdement au Sahel le prix des erreurs commises.
Loin d’apporter une quelconque justification à l’invasion de l’Ukraine par l’armée de la Fédération de Russie, le rappel des principales interventions militaires occidentales depuis la chute de l’URSS est un facteur indispensable pour comprendre et juger des positions des États du « reste du monde », ou du « Sud global » selon l’expression, face à cette invasion. Lors des votes à l’Assemblée générale des Nations-Unies, la condamnation de cette invasion fut certes majoritaire, en nombre d’États (vu sous l’angle démographique, le rapport est différent, la Chine, l’Inde, le Pakistan s’abstenant notamment), en revanche l’application de sanctions (ce qui pèse dans la réalité) est pratiquement limitée aux pays occidentaux. Hors de cette aire, non seulement les sanctions ne sont pas appliquées mais certains pays permettent de les détourner (voir ELUCID Guerre en Ukraine : comment la Russie parvient à détourner les sanctions – Marco Cesario 22 mars 2023 ; Le Monde Les Émirats dans le camp russe face à l’Ukraine – Jean-Pierre Filiu 2 avril 2023).
Les États-Unis vis-à-vis de la Fédération de Russie
Après avoir situé l’action internationale des États-Unis et de leurs alliés occidentaux dans leurs différentes interventions militaires menées depuis trois décennies, bien évidemment, il faut se pencher sur la relation entretenue avec la Fédération de Russie.
Dès les années qui suivirent le démembrement de l’URSS et l’indépendance des quinze républiques qui la constituaient, Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la Sécurité du président Carter a défini une forme de cadre conceptuel dans son livre Le grand échiquier – L’Amérique et le reste du monde, publié en 1997. Il y écrit : « Pour l’Amérique, l’enjeu géopolitique principal est l’Eurasie. Depuis cinq siècles, les puissances et les peuples du continent qui rivalisent pour la domination régionale et la suprématie globale ont dominé les relations internationales. Aujourd’hui, c’est une puissance extérieure qui prévaut en Eurasie. Et sa primauté globale dépend étroitement de sa capacité à conserver cette position. » Il ajoute : « L’Eurasie demeure, en conséquence, l’échiquier sur lequel se déroule le combat pour la primauté globale… Le « jeu » se déroule sur cet échiquier déformé et immense qui s’étend de Lisbonne à Vladivostok. » La vision de Brzezinski se place ainsi dans l’héritage de MacKinder.
Dans cette Eurasie de la fin du XXe siècle, Brzezinski distingue, d’une part, cinq acteurs qu’il nomme géostratégique : la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine et l’Inde [1] ; et cinq « pivots géopolitiques » : l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, la Corée, la Turquie et l’Iran. S’agissant de l’Ukraine, il écrit : « L’indépendance de l’Ukraine modifie la nature même de l’État russe. De ce seul fait, cette nouvelle case importante sur l’échiquier eurasien devient un pivot géopolitique. Sans l’Ukraine, la Russie cesse d’être un empire en Eurasie. »
Bien sûr, à l’époque où il a publié son livre, Brzezinski n’occupait plus de fonction officielle ce qui a conduit certains à limiter la portée de son essai, n’y voyant que le fruit d’un commentateur d’une nouvelle configuration géopolitique. Il n’empêche qu’il conservait une forte influence dans le milieu des décideurs américains. Il était membre du Council on Foreign Relations et Barack Obama le désigna durant sa campagne électorale comme son conseiller aux Affaire étrangères.
Ainsi, après la politique d’endiguement (« containment ») de l’URSS conceptualisée par George Kennan [2] dans son télégramme de février 1946 et exprimée par Harry Truman dans son discours du 12 mars 1947 devant le Congrès, la pensée de Zbigniew Brzezinski, celle d’une politique de refoulement (« Roll back »), devint l’axe de la politique étrangère américaine face à la Fédération de Russie.
Tout commence lors de l’entretien à Moscou entre Mikhaïl Gorbatchev, président de l’URSS, et le secrétaire d’État américain James Baker, le 9 février 1990, sur la réunification allemande. Selon les témoignages et les procès-verbaux respectifs, il apparait bien qu’il y eut un engagement américain verbal par rapport à ce que devait être la position de l’OTAN. Cet engagement était propre à la réunification allemande (venu à Moscou, le lendemain, 10 février 1990, Helmut Kohl déclarait « que l’OTAN ne devrait pas élargir sa portée [3] »). Il s’agissait pour les États-Unis de renoncer à toute présence de forces de l’OTAN au-delà de la ligne qui séparait les deux Allemagnes. En 1990, si l’URSS avait perdu le glacis que Staline avait obtenu à Yalta, elle demeurait, au moins dans les apparences, l’une des deux grandes puissances dont la dislocation prochaine était encore difficilement prévisible.
L’URSS disparue après la décision de son démembrement prise le 8 décembre 1991 à Minsk par les dirigeants des trois Républiques socialistes soviétiques de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine alors que certaines des quinze républiques de l’Union dont l’Ukraine avait déjà proclamé leur indépendance, la nouvelle Fédération de Russie se présentait en héritière de celle-ci. Juridiquement, elle reprenait le siège permanent de l’URSS au Conseil de sécurité (il faut noter que du temps de l’URSS, la Biélorussie, nouvellement appelée Bélarus et l’Ukraine étaient déjà membres de l’Organisation des Nations Unies) et sa place dans d’autres organisations internationales. Héritière de l’URSS mais aussi de l’empire tsariste auquel la première s’était substituée, la Fédération de Russie conservait un immense territoire, le plus grand de tous les États de la planète, mais sensiblement réduit puisque ses frontières étaient en deçà de celles laissées par Catherine II et Pierre le Grand. Pour autant, à travers la création de la Communauté des États Indépendants, elle aspirait à conserver une prépondérance dans l’ancien espace territorial de Nicolas II et Staline.
La Fédération de Russie de Boris Eltsine
Près d’une décennie allait s’écouler avant que la situation ne se stabilise dans la nouvelle Fédération de Russie avec l’arrivée de Vladimir Poutine d’abord comme Premier ministre puis comme Président. S’il y eut un chaos économique et social interne, la position internationale du pays n’a pas été sans évolution du fait de celle des États-Unis à son égard. Deux ministres des Affaires étrangères successifs incarnent cette évolution : Andreï Kozyrev (titulaire du portefeuille du 11 octobre 1990 au 5 janvier 1996) puis Ievgueni Primakov (10 janvier 1996 – 11 septembre 1998). Ce dernier fut Premier ministre du 11 septembre 1998 au 12 mai 1999. Libérée de soixante-dix ans de collectivisme, soucieuse d’un développement économique, la Fédération de Russie au temps de Kozyrev fut marquée par une volonté de proximité avec l’Occident et les États-Unis, recueillant un avis favorable dans la société. La réponse de l’Occident ne fut pas à la hauteur de l’attente ni dans l’aide accordée ni dans la position internationale reconnue. Si bien que lors des élections législatives de 1995, le Parti communiste remporta 157 sièges sur les 450 que comptait la Douma, permettant avec les partis alliés de faire élire un député communiste à la présidence de cette Douma. Cependant, Boris Eltsine fut réélu le 3 juillet 1996 pour un second mandat de quatre ans. Suivant les élections législatives, Ievgueni Primakov fut donc nommé ministre des Affaires étrangères le 10 janvier 1996. Ayant occupé de haute fonction au sein du KGB, ce spécialiste du monde arabe dont il parlait couramment la langue, eut pour ligne de conduite la défense de l’intérêt national. Or, pour la Russie, durant la période où Primakov exerça sa fonction ministérielle puis celle de Premier ministre, cet intérêt national fut mis à mal par les décisions et les actions entreprises par l’OTAN. Ce fut, d’une part, un premier élargissement, en 1999, à d’anciens membres du Pacte de Varsovie, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque et les bombardements contre la Serbie au printemps 1999. Avant même ces évènements et comprenant ce qu’était la vision des États-Unis d’un ordre mondial et leur volonté de dominer celui-ci sans partage, Primakov avait une conception de ce que devait être la politique étrangère de son pays et les bases d’un équilibre des relations internationales sans que celles-ci ne furent jamais formalisées. Ce qui fut appelée la « doctrine Primakov » reposait sur un ordre international multipolaire au sein duquel la Russie opérerait sur plusieurs axes en s’intégrant économiquement dans la mondialisation en cours [4].
Après un intermède de trois mois où Sergueï Stepachine remplaça Ievgueni Primakov comme chef du gouvernement russe (12 mai – 9 août 1999), Vladimir Poutine fut nommé Premier ministre le 9 août 1999. Désigné, en vertu de la Constitution Président de la Fédération de Russie, le 31 décembre 1999, après la démission de Boris Eltsine, il fut élu officiellement président le 26 mars 2000. Il s’agissait d’abord de rétablir l’ordre intérieur miné par un effondrement économique, la corruption et la sécession tchéchène. A l’extérieur, cet ancien officier du KGB, chef de l’antenne de Dresde au moment de la chute du mur de Berlin, avait pour ambition de restaurer une puissance russe. Elle impliquait plusieurs regards : celui porté sur les liens entre la Fédération de Russie et les anciennes républiques qui constituaient l’URSS, devenues indépendantes ; la relation avec l’Occident et, avant tout, avec les États-Unis ; puissance eurasiatique, la Russie ne pouvait que développer ses rapports avec la Chine en pleine ascension économique ; enfin, membre permanent du Conseil de sécurité, soucieuse de son statut international, elle se devait d’être un acteur de la scène mondiale.
La Fédération de Russie et son « étranger proche »
Dans la foulée de la dissolution de l’URSS programmée par l’accord signé le 8 décembre 1991 dans une résidence située dans la forêt de Belovej, proche de Minsk, les trois signataires décidèrent la création de la Communauté des États Indépendants, la CEI. Elle regroupait, à l’origine, douze des quinze anciennes républiques socialistes soviétiques. Les trois États baltes, annexés par l’URSS, en juin 1940 refusèrent de s’y joindre. La Géorgie, le Turkménistan et l’Ukraine quittèrent par la suite l’organisation.
Dans cet « étranger proche » selon l’expression de la diplomatie russe, outre les pays baltes, à l’histoire particulière, qui avait conquis une première indépendance en 1918, trois ensembles géographiques doivent être distingués. A l’ouest, la Biélorussie et l’Ukraine, au sud, les républiques du Caucase avec la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan et les Républiques d’Asie centrale (le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan). Situées au centre de l’Eurasie, disposant pour certaines d’entre elles d’importantes ressources en hydrocarbures, principalement le Kazakhstan, la création des Nouvelles routes de la soie, traversant cet espace eurasiatique en fait un enjeu de la géopolitique régionale sinon mondiale. Le sud du Caucase ou Transcaucasie, carrefour de civilisations et lieu d’affrontement entre celles-ci est un espace permanent d’instabilité où la Fédération de Russie maintient une présence en Arménie qui subit la conquête territoriale progressive de l’Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie en quête de pénétration dans l’espace turcophone de l’Asie centrale. A l’ouest de la région, bordant la mer Noire, se situe la Géorgie, pour partie tournée vers l’Occident qu’illustre sa relation avec l’OTAN sans pour autant être détachée de son ancien maître russe. En témoigne l’ambivalence au sommet de l’État entre une présidente de la République pro-occidentale, Salomé Zourabichvili (ancienne ambassadrice de France) et un gouvernement, appuyé sur une majorité parlementaire, qui tient un discours favorable à l’OTAN et à l’Union européenne mais qui n’a pas condamné l’invasion de l’Ukraine. Si les États-Unis aspirent à s’y implanter au moins par une alliance dûment scellée et peut-être par des bases, l’avenir est encore incertain.
Les États-Unis, la Russie et l’Ukraine
Tout en observant que l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, le 24 février 2022, est un acte d’agression en violation du droit international, l’analyse oblige aussi à en examiner les ferments qui tiennent à l’évolution de la relation avec les Etats-Unis et le jeu de ceux-ci par rapport à cette « petite Russie ». Il ne s’agit nullement de justifications par rapport à ce qui apparaît comme une erreur politique de la part de la Russie présidée par Vladimir Poutine mais de montrer que l’Amérique ne peut se prévaloir d’une quelconque incarnation de la vertu et du bien. Depuis les années quatre-vingt-dix, elle a eu pour objectif d’assurer une domination planétaire et une prééminence économique nécessaire à son confort matériel. Empreinte aussi d’un sentiment messianique, elle a pensé pouvoir modeler le monde à des valeurs qui lui sont propres, indifférente à la réalité des diverses aires de civilisation et des cultures et des mœurs qui les sous-tendent.
Face à une situation intérieure désastreuse et certainement décidé à rétablir une puissance russe qui avait atteint son apogée au temps de l’URSS, Vladimir Poutine s’est montré, dans les premières années, plutôt bien disposé à l’égard des Etats-Unis. Il leur apporta son appui après les attentats du 11 septembre 2001. Les appareils de l’US Air Force purent ainsi survoler l’Asie centrale pour le ravitaillement de leurs troupes présentes en Afghanistan et disposer d’une base à Manas au Kirghizistan. Néanmoins, en 2003, elle s’opposa au Conseil de sécurité des Nations Unies à l’invasion de l’Irak. En cela, elle se joignit à la France, premier rôle en la circonstance, et à l’Allemagne par rapport à une opération qui visait, sous des prétextes fallacieux, à assujettir à l’Amérique le Proche et le Moyen-Orient.
C’est en novembre 2004 avec la « révolution orange » à Kiev qu’il apparut qu’à l’évidence les Russes et les Américains ne pouvaient que s’opposer dans leurs intérêts. Les premiers voulant maintenir une influence prépondérante sur un pays qu’ils considèrent comme le berceau historique de la Russie, les seconds appliquant en fait la vision formulée par Zbigniew Brzezinski. L’objet de cette « révolution » était la contestation de la victoire à l’élection présidentielle ukrainienne de Viktor Ianoukovytch, russophile, contre Viktor Iouchtchenko, réputé plus proche de l’Occident avec une assise électorale à l’ouest du pays. Cette opposition politique reflète la réalité ukrainienne et son histoire. L’Ukraine est un Etat sans frontières naturelles à l’est comme à l’ouest. Russophone dans sa partie orientale, l’opposition à la Russie est croissante au fur et à mesure qu’approche la frontière occidentale. Au long de l’histoire du fait des avancées et des reculs des uns et des autres les frontières ont été déplacées. Entre le XVIIè et le XVIIIè siècles, l’empire russe l’annexa par ses conquêtes contre la Pologne (traité d’Androussovo de 1667 et partages de la Pologne en 1772 et 1793) et contre l’empire ottoman (traité de Kucuk Kaynarca du 21 juillet 1774). Durant la seconde guerre mondiale et à l’issue de celle-ci, Staline annexa à l’Ukraine les provinces de Galicie, de Bucovine du nord et de Ruthénie, intégrées dans l’empire d’Autriche-Hongrie jusqu’en 1918.
Sous la pression des manifestations de rue, une nouvelle élection présidentielle fut organisée qui vit la victoire de Viktor Iouchtchenko. Ce duel par candidats interposés pour une mainmise géopolitique sur l’Ukraine s’inscrit dans le cadre plus large de l’extension de l’OTAN aux anciens pays membres du Pacte de Varsovie et aux républiques baltes, extension réalisée en deux fois, en mars 1999 et en mars 2004. Certes, il y eut la création d’un Conseil OTAN Russie mais il s’avéra sans résultats significatifs.
Le retour à une opposition explicitement affichée entre la Russie et les États-Unis date du 10 février 2007 avec le discours prononcé par Vladimir Poutine lors de la 45ème conférence sur la politique de sécurité tenue à Munich. Il y dénonça l’unilatéralisme américain et l’élargissement de l’OTAN. A partir de ce moment, la dégradation des relations n’alla qu’en s’amplifiant avec le temps. En août 2008, le président géorgien Mikheil Saakachvilli engagea imprudemment une action militaire contre l’Ossétie du sud après une multiplication d’incidents de frontière. La riposte russe fut immédiate. Après cinq jours de combats et l’avancée de l’armée russe qui menaçait la capitale géorgienne, Tbilissi, un cessez-le-feu intervint sous l’égide de Nicolas Sarkozy. Les États-Unis alors enlisés en Irak ne pouvait que se satisfaire de la médiation de la France, présidée par un fidèle allié, ayant la double autorité de membre permanent du Conseil de sécurité et de la présidence pour six mois du Conseil de l’Union européenne.
La révolution de Maidan et le début d’un processus qui conduit à la guerre
En Ukraine, entre l’est et l’ouest, la ligne internationale du pays était encore loin d’être tranchée. Viktor Ianoukovytch avait à nouveau été élu président en 2010. Un accord d’association avec l’Union européenne était en cours de négociation depuis 2007. Conclu en 2012, l’accord devait être officiellement signé à Vilnius le 29 novembre 2013 mais, une semaine auparavant, Ianoukovytch refusa de signer. Alors débutèrent des manifestations dont l’aboutissement fut les émeutes insurrectionnelles de la place Maidan à Kiev en février 2014, durement réprimées par les forces de l’ordre qui ouvrirent le feu (82 morts et plus de 600 blessés). Devant la tournure révolutionnaire des évènements, les ministres des Affaires étrangères, français, allemand et polonais (les trois pays avaient constitué en août 1991 une organisation informelle, le triangle de Weimar, peu active depuis plusieurs années) se rendirent à Kiev le 20 février pour engager une négociation afin de rétablir la paix civile. Si un accord fut conclu entre le président ukrainien et l’opposition, sitôt les ministres des Affaires étrangères partis, les évènements se précipitèrent. Ianoukovytch quitta la capitale pour se réfugier à Kharkiv avant de franchir la frontière russe. La Rada, le parlement ukrainien, destitua le président en exercice, nomma un président par intérim, annonça une nouvelle élection présidentielle et démit plusieurs membres du Conseil constitutionnel.
En riposte à ce qui lui apparaissait comme un coup d’État, Vladimir Poutine ordonna une opération militaire en Crimée suivie par une annexion après un référendum où le rattachement à la Russie obtint une large majorité. La Crimée arrachée à l’Empire ottoman à la fin du XVIIIe siècle sous le règne de Catherine II était depuis lors une terre russe. En 1954, pour des motifs liés, d’une part, à l’histoire de la République socialiste soviétique d’Ukraine au sein de l’URSS et, d’autre part, à la recherche d’une cohérence économique régionale, Nikita Kroutchtchev, président du Conseil des ministres de l’URSS et premier secrétaire du Parti communiste décida de rattacher administrativement la Crimée à l’Ukraine. Dans l’État soviétique tel qu’il était, la décision n’avait aucune incidence quant à sa cohésion politique. Lors de la réunion du 8 décembre 1991 où les trois participants s’accordèrent sur la dissolution de l’URSS, Boris Eltsine ne posa pas la question de l’avenir de la Crimée qui demeura donc dans les frontières ukrainiennes. Un premier traité fut conclu en 1997 après le partage de la flotte de la mer Noire accordant un bail de vingt à la Russie (jusqu’en 2017) pour l’utilisation de la base Sébastopol. Un nouvel accord intervint en 2010, prolongeant le bail jusqu’en 2042.
Parallèlement, aux évènements de Crimée, à la suite de la révolution de Maidan, une partie des populations du Donbass, région russophone à l’est de l’Ukraine, s’insurgèrent, à partir d’avril 2014, contre l’autorité centrale, soutenue par la Fédération de Russie, frontalière. Deux territoires de la région avaient proclamé leur indépendance, les républiques de Donetsk et de Lougansk, ratifiée par deux référendums tenus le 11 mai 2014. La légalité comme la légitimité de ces référendums furent contestées non seulement par les autorités ukrainiennes mais par les puissances occidentales. Pour mettre fin aux combats un accord fut conclu à Minsk, le 5 septembre 2014 entre la Russie et l’Ukraine sous l’égide de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe). L’accord fut sans effet. De manière plus solennelle, un second accord intervint le 12 février 2015, Minsk II, dont les signataires furent la Fédération de Russie, l’Ukraine, la France, l’Allemagne et les deux républiques de Donetsk et de Lougansk. Chacun ayant ses arrière-pensées, l’accord ne fut jamais appliqué. Les affrontements se poursuivirent de manière intermittente entre l’armée ukrainienne et les milices des deux républiques dissidentes, bénéficiant d’un soutien russe.
Une réalité russe à comprendre
Dans ce contexte de tensions persistantes, à aucun moment il n’est apparu une volonté réelle d’aboutir à un accord formel, au moins à une entente qui aurait tracé, au-delà de la question de l’Ukraine, les perspectives de la relation à établir entre l’Occident et la Fédération de Russie. Cette dernière, née de la dissolution de l’URSS, n’en a plus ni la puissance, ni l’aire de domination. Dans l’espace eurasiatique, elle n’occupe plus qu’un second rôle derrière la Chine devenue en quelque trois décennies une force économique majeure, « l’atelier du monde ». « La puissance pauvre » selon l’expression de Georges Sokoloff est d’abord un pays exportateur de matières premières, particulièrement riche en hydrocarbures. Pour autant, il ne faut pas négliger ses hautes capacités scientifiques et techniques mais elle n’a pas su en user pour basculer dans la compétition industrielle mondiale. Institutionnellement, si le président de la Fédération de Russie comme la Douma d’Etat sont élus au suffrage universel dans un régime de partis multiples, l’exécutif, dans sa pratique, s’avère autoritaire et d’un respect pour le moins limité du droit des opposants. Mais comme tout pays, la Russie a son histoire, en l’occurrence celle d’un pays qui s’est construit dans une adversité souvent cruelle, conquérant un immense espace fait de diversités. Staline, le tyran communiste, ne saurait peut-être pas être compris sans penser à Ivan le Terrible.
Aujourd’hui dans un monde géopolitiquement complexe, aux pôles multiples, la Russie de Vladimir Poutine a visé à restaurer une puissance perdue par une emprise plus ou moins ténue sur les républiques ayant constitué l’ancienne URSS. L’Ukraine au temps de celle-ci comme sous celle des tsars après sa conquête en était le fleuron. Nostalgique de l’empire russe, Vladimir Poutine ne pouvait pas accepter son basculement dans la sphère américaine. Dans une Fédération de Russie qu’il considérait comme subissant la pression américaine, substantiellement aggravée depuis l’annexion de la Crimée, Vladimir Poutine choisit l’option militaire, le but étant d’ordre géopolitique : interdire à l’Ukraine d’intégrer l’aire occidentale. Nul ne sait, à ce jour, s’il fut mal renseigné sur le potentiel réel de son armée, s’il décida par certitude personnelle ou si ces facteurs se sont combinés.
La politique américaine modelée par l’impératif de suprématie
S’il est incontestable que, dans cette guerre, la Fédération de Russie est l’agresseur, il faut néanmoins s’interroger sur le bien-fondé de la politique des États-Unis à son égard. C’est là toute la question posée par ce que doit être une vision dans la conduite d’une politique étrangère et son excellence. Quel était l’objectif de l’Amérique dans cette volonté de rabaisser encore une puissance déjà fortement affaiblie par rapport à ce qu’elle avait été au temps de la guerre froide ? Si tant est que l’URSS fut déjà à l’époque à la hauteur de la puissance qui lui était reconnue. Les États-Unis permirent l’adhésion de la Chine à l’OMC en décembre 2001. Par ce geste, les dirigeants américains s’imaginaient probablement que l’Empire du milieu, saisi par le développement économique, s’intégrerait dans cet ensemble mondial auquel aspirait une élite dirigeante occidentale. Axé sur le commerce et la multiplicité des échanges, dans une division internationale du travail et le partage de normes communes, la mondialisation ou « globalisation » serait chapeautée par l’Amérique. La Chine par la voie économique ne manquerait pas d’épouser progressivement, au fil du temps, ces valeurs communes, considérées comme indissociables de cette voie, sous l’égide des États-Unis. Néanmoins, dans cette prétention mondiale, là où le « soft power » serait déficient pour emporter la décision, le « hard power » s’y substituerait.
Cette guerre menée par la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine est le fruit d’un affrontement géopolitique opposant la première aux États-Unis, ceux-ci agrégeant leurs alliés de l’OTAN. L’Amérique a voulu parachever la dislocation de l’URSS par l’entrave à toute formation d’un bloc russe reposant sur la maîtrise d’un étranger proche. La Russie a riposté par l’action violente, moyen déjà adopté contre la Géorgie en 2008.
Les erreurs respectives des États-Unis et de la Russie
Au risque de heurter les uns ou les autres, force est de constater que chacun des deux protagonistes a commis une erreur. D’abord les États-Unis, dans leur dessein : ils ont engagé un processus éloigné d’une réelle compréhension des bouleversements en cours dans l’ordre du monde. Sa mise en œuvre ne pouvait qu’engendrer maladresses et dissensions. Secondement la Fédération de Russie, dans sa réaction : l’option militaire telle qu’elle a été retenue était incongrue dans son principe puisqu’il s’agissait d’envahir un État indépendant dans un environnement en rupture avec ce qu’avait été la politique des blocs en Europe au temps de la guerre froide. De plus, l’invasion mal préparée en proportion des moyens, l’erreur de principe ne pouvait été compensée, en partie du moins, par la rapidité d’action.
Les États-Unis et l’Occident isolés
S’il est compréhensible, dans une approche objective des réalités géopolitiques, affranchie des appréciations partisanes, que les États-Unis veuillent assurer la pérennité de leur puissance, encore faut-il que la politique étrangère soit conçue à partir d’une vision appropriée et que la diplomatie afférente soit menée avec discernement. Cela exige des dirigeants à la hauteur des enjeux. Ces dernières décennies, l’ombre d’un Théodore Roosevelt, d’un Truman ou d’un Nixon avec son conseiller Kissinger apparait bien lointaine. Faute d’avoir recherché un équilibre par des coopérations voire des partenariats fondés sur des intérêts réciproques et en dissociant des forces contraires, les États-Unis, entourés par leurs alliés européens ont finalement été confrontés à l’attaque militaire russe contre l’Ukraine à laquelle ils étaient obligés de réagir. Il est probable que depuis 2014 et la prise de la Crimée par les Russes, l’invasion de l’Ukraine était une hypothèse retenue, en témoigne l’aide militaire déjà développée. Cependant, il faut constater que si cette invasion a été condamnée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 2 mars 2022, votée à une très large majorité (141 voix pour, 35 abstentions et 5 votes contre), en revanche, hors Occident la politique des sanctions adoptée par celui-ci n’a pas été suivie par le reste du monde. Dans ce qui est dénommé maintenant le « Sud global », chacun a agi selon ce qu’il estimait être ses intérêts ne se joignant pas aux sanctions ou les détournant. La Turquie, elle-même, membre de l’OTAN, ne les a pas appliquées. Les États-Unis et leurs alliés ont ainsi été isolés dans ce domaine.
Des études montrent qu’après une récession limitée en 2022, la croissance du PIB russe sera positive en 2023 (voir articles de Jacques Sapir publiés sur le site Les Crises.fr – PIB russe : Pourquoi les prévisionnistes se sont-ils trompés sur leurs estimations pour 2022, 6 juin 2023 ; La croissance de l’économie russe au 2ème semestre 2023, 17 août 2023 ; Comprendre la croissance russe de 2023, 5 décembre 2023). Par ailleurs, les mesures de gel des avoirs prises par les États-Unis constituent un facteur incitatif à la « dédollarisation » des échanges commerciaux, politique conduite notamment par les BRICS (composés du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, l’organisation a été élargie lors de son XVe sommet d’août 2023 à six autres pays : l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Éthiopie, l’Égypte, l’Argentine et les Émirats Arabes Unis).
Une réticence au sein même des États-Unis au soutien militaire et financier à l’Ukraine
Outre ces oppositions extérieures, il faut noter les réticences observées aux États-Unis pour une aide à l’Ukraine puisque le plan de soutien de 106 milliards de dollars (qui comprenait aussi l’aide à Israël – l’aide à l’Ukraine ayant été fixée à 61 milliards de dollars) proposé par le gouvernement a été rejeté le 6 décembre 2023 par le Sénat. Certes, il s’agit d’une négociation interne avec l’opposition républicaine (contreparties demandées sur la politique migratoire vis-à-vis du Mexique) mais il est probable que cette aide à l’Ukraine sera plus discutée que celle pour Israël.
La position internationale de la Fédération de Russie affaiblie mais des gains possibles au plan économique
De son côté, si la Fédération de Russie n’est pas frappée par les sanctions comme elle aurait pu l’être, sa position internationale est néanmoins affaiblie. Notamment, dans sa relation avec la Chine, elle se trouve dans une situation seconde. Les républiques d’Asie centrale ont pris quelques distances, en partie au bénéfice de la Chine. Cependant, il faudra observer dans les années qui viennent les effets, pour le développement économique du pays, des mesures de substitution aux sanctions prises par les pays occidentaux.
Les bases de négociations et d’un accord
A ce jour, toute prévision sur l’évolution de la guerre en cours s’avère hypothétique. La contre-offensive de l’été 2023 a globalement échoué au regard des espérances ukrainiennes et occidentales. Les ressources ukrainiennes sont loin d’être illimitées par rapport à l’adversaire russe. De plus, le nouveau conflit qui a éclaté aura Proche-Orient aura inévitablement une incidence en détournant pour partie l’attention américaine. Pour le crédit des Etats-Unis et de l’Occident après les revers subis dans différents engagements militaires, il est indispensable d’éviter toute défaite ou recul. Pour un ensemble de raisons, il n’est pas dans l’intérêt de la Fédération de Russie de prolonger un conflit coûteux en hommes et en matériels et qui limite ses capacités d’action sur le plan des relations internationales. A moins que l’un ou l’autre, ukrainiens ou russes, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, n’arrivent à bousculer les forces adverses, un cessez-le-feu devra intervenir sur les positions du moment. Les négociations attendues auront pour objet de résoudre un affrontement aux origines avant tout d’ordre géopolitique. Cela conduit à exclure l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Quant à celle à l’Union européenne, les conditions n’en sont pas réunies. Elle ne doit pas créer de nouvelles distorsions économiques entre les Etats membres. Sur l’aspect territorial, si la Crimée demeurera russe, la question se posera notamment pour la mer d’Azov si celle-ci doit devenir une mer intérieure de la Fédération de Russie, sa rive occidentale permettant une continuité territoriale entre cette dernière et la péninsule. L’accord, bien sûr, devra faire l’objet de garanties internationales associant les membres permanents du Conseil de sécurité, l’Allemagne et probablement la Pologne frontalière de l’Ukraine et en première ligne européenne dans le conflit.
Michel Leblay (Polémia, 13 décembre 2023)
Notes :
[1] Il précise que « la Grande-Bretagne, le Japon et l’Indonésie, pays sans doute très importants, ne relèvent pas de cette catégorie. »
[2] Selon Olivier Zajec (Nicholas John Spykman l’invention de la géopolitique américaine, publié à la Librairie PUPS) George Kennan n’aurait pas été inspiré dans ce concept de « containment » par la théorie de Spykman, il dériverait de sa lecture de MacKinder. Cependant, l’auteur précise : Selon Brian W. Blouet, « Spykman n’était pas l’auteur de la théorie du containment, qui est celle de George Kennan, mais le livre de Spykman, fondé sur la thèse du Heartland, aida à préparer le public américain à un monde de l’après-guerre dans lequel l’Union soviétique serait contenue sur ses flancs ».
[3] Le Monde diplomatique – Quand la Russie rêvait d’Europe « L’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est » Philippe Descamps septembre 2018.
[4] Voir La Russie et l’Occident : des illusions au désenchantement – Vyacheslav Nikonov – Critique internationale 2003/1 Presses de Sciences Po.