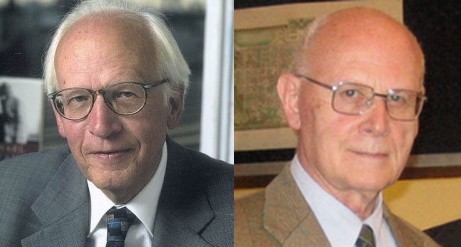D.V. : De votre part, il s'agissait d'une interprétation nouvelle par rapport à vos précédents travaux...
E.N. : Pas vraiment. Dans Le fascisme dans son époque, je considérais déjà le fascisme comme un antimarxisme fondamental, quelles que soient les distinctions que l'on peut faire ensuite entre fascisme-mouvement et fascisme-régime, fascisme normal et fascisme radical. Plus précisément, je définissais le fascisme comme un antimarxisme qui vise à anéantir son ennemi en développant une idéologie radicalement opposée à la sienne (encore qu'elle en soit proche) et en appliquant des méthodes presque identiques aux siennes, non sans les avoir transformées à sa manière, et cela dans le cadre inébranlable de l'auto-affirmation et de l'autonomie nationales.
D.V.: Sur ce point, l'utilisation indistincte du terme « fascisme » pour désigner les idéologies mussolinienne et hitlérienne risque d'introduire une certaine confusion. Le fascisme historique, authentique, né en Italie, présente des caractéristiques spécifiques très éloignées du nazisme. A mon sens, l'une des grandes différences avec le national-socialisme, et surtout avec la vision hitlérienne du monde, réside dans le fait que cette dernière se réclame d'une interprétation scientifique - ou prétendue telle - de l'histoire. Le darwinisme et le racisme biologique sont absents du fascisme italien. En revanche, dans Mein Kampf et dans les Libres propos, Hitler prétend à une justification scientifique de ses idées. Or, ce désir de scientificité du national-socialisme est aussi un trait de l'idéologie marxiste, qui se présente comme une « science », une compréhension rationnelle des lois déterminant la structure des sociétés et les mouvements de l'histoire. Je serai donc tenté de fonder sur ce point précis une parenté du national-socialisme et du bolchevisme, parenté qui exclut le fascisme italien.
E.N.: Vous avez raison. Mais en plus du biologisme darwinien rôle de l'antisémitisme. Celui-ci permet à la doctrine hitlérienne de développer une philosophie de l'histoire proche quoiqu'opposée au marxisme. L'annihilation d'un peuple mondial voulue par Hitler est une réponse à la destruction d'une classe mondiale froidement envisagée par les bolcheviks. L'antisémitisme donnait à l'idéologie nationale-socialiste une dimension globale, universelle et, à sa manière, « rédemptrice ». A ce titre, l'antisémitisme est une nécessité intérieure du nazisme, que Mussolini et les doctrinaires du fascisme n'ont jamais développée.
D.V.: On peut se demander si la prétention scientifique commune au national-socialisme et au bolchevisme n'est pas un des ressorts essentiels de ce que l'on a appelé le « totalitarisme ». Ce siècle a certes connu des abominations qui ne relevèrent ni du communisme ni du nazisme. Mais, en dehors des marxistes et des nationaux-socialistes, personne ne cherchait à justifier ses crimes par des arguments scientifiques. On invoquait plutôt les nécessités inhérentes à certaines situations. Or, voici deux mouvements idéologiques qui n'entendent pas se soumettre à la contingence historique, mais veulent la conformer à la vision rationnelle-scientifique qu'ils s'en font, qui justifie à leurs yeux tous les moyens. Ne tient-on pas là une clef fondamentale du totalitarisme?
E.N.: Dans Mein Kampf, Hitler ne souhaite pas seulement opposer à l'idéologie de l'ennemi une idéologie « de même force », mais « de plus grande vérité ». Sur ce point, et au-delà du caractère scientifique dont nous parIons, il convient à mon sens de reconnaître que la philosophie de l'histoire du marxisme est authentique, alors que celle du national-socialisme est artificielle. Par authentique, je veux dire que le marxisme se fonde sur une idée très ancienne, sur un fond réel des aspirations humaines - la société sans classes, l'égalité entre tous, l'histoire sans conflit, la réconciliation de l'humanité, etc. Or, chez Hitler, on ne trouve pas une telle assise universelle. En ce sens, j'ai parlé de « copie pervertie »: le communisme est antérieur en tant que construction idéologique, mais aussi plus originel en tant que fond philosophique. Hitler ne peut être comparé ni à Marx ni à Staline, mais bien à Lénine.
D.V.: Dans votre livre, vous soulignez combien la Première Guerre mondiale introduit une nouvelle barbarie dans la conduite des opérations militaires. Celle-ci n'est une invention ni du marxisme, ni du national-socialisme. Vous citez très justement la stratégie anglo-saxonne du blocus, qui était destinée à affamer le peuple allemand. jusqu'alors, la guerre ne concernait peu ou prou que les soldats: désormais, la population civile devenait une cible légitime. je pense, pour ma part, que dans leur extrémisme, le bolchevisme et le nazisme sont les produits de la Première Guerre mondiale et de son déchaînement illimité de violence.
E.N.: Il me semble que ces barbaries, accomplies par des nations qui étaient considérées comme des « États de haute culture », auraient pu être « digérées » par ces mêmes États s'ils étaient parvenus à établir une paix juste et à s'intégrer dans la Société des nations. Mais la révolution de 1917 et l'instauration du communisme en Russie, qui s'inscrivaient à leur manière dans ces tendances à la déshumanisation manifestées par la cruauté des combats entre 1914 et 1918, ont entièrement changé la donne dans l'entre-deux guerres. D'où la responsabilité que j'attribue au bolchevisme dans le déclenchement de la guerre civile européenne.
D.V.: Le noyau initial du bolchevisme et surtout du national-socialisme était composé d'hommes qui avaient combattu sur le front en 14-18. Leur vision des choses avait été transformée par l'expérience de la guerre et, pour certains d'entre eux, de la défaite. Vous le soulignez dans votre livre: Hitler plus que d'autres a vécu comme une douleur et une humiliation terribles l'effondrement de l'armée impériale. On peut se demander si sa vision hyperconflictuelle de la vie politique ne doit pas beaucoup au sentiment de répulsion éprouvé face à cet effondrement. jusqu'à la fin, il aura la volonté d'être plus dur encore que tous ses adversaires, pour que l'Allemagne ne connaisse jamais une honte comparable à celle de 1918.
E.N.: Les anciens officiers étaient en effet nombreux dans les rangs de la NSDAP - ce que Trotski, ayant lui-même contribué au massacre ou à l'enrôlement forcé des officiers russes, avait oublié lorsqu'il prévoyait l'écrasement probable des « petits-bourgeois » nationaux-socialistes par les communistes. Toutefois, si Hitler n'avait été, comme Rühm, qu'un ancien soldat perdu dans la vie civile, il n'aurait pas connu son destin. Au-delà de l'amertume propre aux sentiments nationalistes de l'époque, Hitler entendait devenir le soldat d'une idéologie et il dut pour cela prendre des leçons auprès de l'idéologie adverse. Certains soldats revenus du front ne peuvent s'accoutumer à la paix. Dans le cas du bolchevisme et du national-socialisme, la vraie question ne résidait pas dans une distinction entre temps de paix et temps de guerre: ces deux doctrines voulaient avant tout purifier le monde. Cette tension vers l'anéantissement de l'adversaire, constitutive de la guerre civile, existait dans un camp comme dans l'autre. J'en cite de nombreux exemples dans mon livre. Ainsi l'intellectuel de gauche Kurt Tucholsky écrit-il l'été 1927 dans ses Oanische Felder: « Que le gaz s'infiltre dans les pièces où jouent vos enfants! Qu' i Is s'affaissent lentement, les poupons. A la femme du conseiller ecclésiastique et du rédacteur en chef, à la mère du sculpteur et à la sœur du banquier, à toutes je souhaite une mort cruelle et pleine de tourments ». Même replacé dans le contexte des exactions brutales des corps-francs, ce genre d'exercices imaginatifs donne une idée de la violence de l'époque.
D.V.: Votre thèse est que l'histoire européenne, entre 1917 et 1945, est dominée par une guerre civile entre bolchevisme et antibolchevisme. Or, le monde anglo-saxon est lui aussi porteur d'une certaine vision du monde, une vision très différente de celles qui se développent sur le continent européen. Vous montrez bien dans votre essai que Roosevelt voulait la guerre. Mais du point de vue qui était le sien, il ne s'agissait pas seulement d'écraser le national-socialisme, mais également d'éliminer une puissance capable d'unifier l'Europe sous sa direction. Cette intervention d'un troisième acteur dans la guerre civile européenne a modifié, non seulement les rapports de force, mais aussi les perspectives idéologiques. je pense ici à la manière dont Oswald Spengler, dès 1920, opposait le monde anglais et le monde prussien, en montrant qu'ils correspondaient à deux modes d'existence collective et à deux visions de l'avenir radicalement contraires. Spengler parle très peu du bolchevisme: à ses yeux, le grand antagonisme oppose le monde organique européen (symboliquement, la Prusse) et le monde mercantile anglo-saxon (symboliquement, l'Angleterre). Ne peut-on dire que 1945, de ce point de vue là, fut aussi une victoire contre l'Europe?
E.N.: Mais aussi, d'un autre point de vue, une victoire pour l'Europe, si l'on considère le système « libéral » comme un système originairement européen. Par système libéral, j'entends le régime politique fondé sur la séparation et la balance des pouvoirs, et au-delà, sur la pluralité d'expression des réalités sociales. Un tel système, très imparfaitement maintenu aux États-Unis, n'existait plus en Europe sous la férule nationale-socialiste ou bolchevique. En ce sens, la victoire des États-Unis a permis la survie d'une forme d'organisation de la vie politique que je crois européenne dans son essence. Au fur et à mesure de son évolution, Hitler se pensait de plus en plus comme un ennemi de l'Europe existante - l'Europe des classes dirigeantes, l'Europe chrétienne, etc. Comme les bolcheviks, Hitler voulait faire table rase sur le Vieux Continent, mais dans le sens d'un mode de vie archaïque, fondée sur la vertu militaire. Bolcheviks et nationaux-socialistes combattaient chacun à leur manière contre l'histoire, l'un vers une post-histoire « radieuse », l'autre vers un retour aux commencements, avant cette décadence que les nazis voyaient partout à l' œuvre dans les siècles récents de l'Europe.
D.V.: De la « querelle des historiens » à l' « affaire Sioterdijk », en passant par les prises de position très discutées d'auteurs comme Günter Maschke, Botho Strauss, Heimo Schwilk, Rainer Zitelmann, Martin Walser, on a le sentiment d'un réveil du débat outre-Rhin. Ce qui ne va pas sans inquiéter certains esprits, à commencer par celui que l'on a présenté comme le philosophe officiel de l'ancienne République de Bonn, Jürgen Habermas. Qu'en est-il?
E.N.: Voici quelques jours, j'ai tenu une conférence à Turin sur l'éthique de la discussion, concept forgé par Habermas. A mon sens, si l'on considère cette éthique de la discussion dans la totalité de ses conséquences, elle aboutit au spectre terrifiant d'une huma- nité clonée. Car ce que Habermas recherche comme finalité de la discussion rationnelle, c'est le consensus général. Or, celui-ci n'est possible qu'au prix de l'éradication des différences entre les hommes. Dans sa polémique avec le philosophe de Francfort, Sioterdijk l'a qualifié de « jacobin » dans la mesure où il se veut une sorte de pape séculaire régentant tous les termes le débat.
Je ne sais si tous les exemples que vous citez sont réellement représentatifs d'un renouveau du débat proprement dit. Il s'agit plus de « scandales » lancés par des médias qui recherchent des événements susceptibles de capter sur une courte durée l'attention du grand public. La querelle des historiens, par exemple, n'a pas été continuée et la publication de ma correspondance avec François Furet ne l'a pas réveillée. De même, la traduction récente du Livre noir du communisme s'est surtout soldée par des polémiques lancées par d'anciens gauchistes contre Stéphane Courtois.
D.V.: Les querelles idéologiques sont la version froide de la guerre civile. Elles ne prêtent pas au débat, sauf en de brèves occasions, entre dissidents rendus à la liberté par leur dissidence. Mais, d'une façon générale, cela se fait en dehors des grands moyens d'expression qui sont sous contrôle de la pensée unique.
E.N.: Depuis la fin de la guerre froide, le libéralisme - à ne pas confondre avec le système libéral d'équilibre des pouvoirs dont nous parlions - tend en effet à devenir la pensée unique de l'Occident. Ce n'est pas un totalitarisme au sens classique du terme, car cette notion est liée à la violence physique à l'encontre des personnes. Mais il s'agit bien d'une espèce de totalitarisme doux ou mou, d'une forme inconnue jusqu'à ce jour. Le « politiquement correct » se traduit ainsi par un spectre très restreint d'opinions acceptables dans le débat public.
D.V.: Ce blocage du débat est patent en ce qui concerne la mémoire du national-socialisme et celle du communisme: la comparaison dépassionnée des deux totalitarismes n'est toujours pas à l'ordre du jour ...
E.N.: Oui, et il y a beaucoup de causes à cela. En France, par exemple, j'ai le sentiment que les communistes dans leur immense majorité ont été des hommes de gauche avant tout préoccupés de questions sociales françaises: la Russie paraît donc lointaine, et la réalité du communisme russe plus lointaine encore. Par ailleurs, la France ne pourrait pas se quaifier de « victorieuse » sans reconnaître son alliance avec Staline: elle a donc une obligation de gratitude envers la Russie communiste - ce dont témoigne encore votre station de métro Stalingrad!
Au-delà de ces raisons, qui relèvent du passé singulier de chaque nation, la différence de traitement entre national-socialisme et bolchevisme tient aussi à la profonde affinité des doctrines universalistes. Le national-socialisme fut un particularisme, un racisme au sens réel du terme - et non au sens impropre des polémiques médiatiques qui, à travers un supposé « racisme », condamnent toutes les formes de l'instinct de conservation. Les nationaux-socialistes furent, pour beaucoup, des racistes authentiques: ils croyaient à la hiérarchie des races, ils possédaient une vision supranationale d'un destin racial commun, etc. Cette vision particulariste de l'histoire reste étrangère aux autres doctrines de la modernité, qui peuvent au moins se trouver un fond commun sur la question de l'universalisme.
D.V.: Curieux universalisme que celui du communisme, qui impliquait la liquidation de la moitié non prolétarienne de l'humanité! Quant au racisme hitlérien, on peut se demander s'il ne comportait pas beaucoup plus d'universalisme qu'on ne l'a dit. On ne saurait oublier son opposition doctrinale et politique au différentialisme culturel, ethnique ou national. Mais pour conclure provisoirement ce débat, je voudrais attirer de nouveau l'attention sur une conséquence majeure de la Deuxième Guerre mondiale. Celle-ci ne s'est pas seulement terminée par la défaite du nazisme, ce dont on se réjouirait, mais aussi par la victoire écrasante de l'Union soviétique et des États-Unis, deux puissances hostiles à l'Europe et à ses valeurs de civilisation. Avec le recul du temps, on voit bien que, malgré les efforts ultérieurs du général de Gaulle, cette guerre fut une catastrophe pour l'Europe et les Européens.
Propos recueillis par Charles Champetier (Eléments n°98, mai 2000)