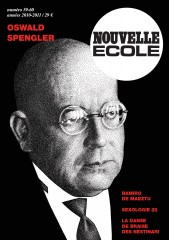Nous reproduisons ici un texte de Bernard Conte, professeur d'économie politique à l'université Montesquieu de Bordeaux.

Néolibéralisme et euthanasie des classes moyennes
Pendant que le néolibéralisme fait son travail de sape, nos élites complices, grassement rémunérées, tentent de détourner l’attention des populations. À l’instar des prestidigitateurs, elles pointent des faits, des « évidences », des idées, des théories… pour mieux dissimuler la réalité et manipuler les opinions.(1)
Après avoir longtemps nié le phénomène du laminage des classes moyennes en Occident, les néolibéraux – de « gauche », comme de « droite » (2) – l’admettent, au moins implicitement, aujourd’hui. Mais pour eux, ce phénomène serait tout à fait « naturel », car il se doublerait de l’apparition et de l’essor de classes moyennes au Sud et plus particulièrement dans les pays émergents.
Quoi de plus équitable ? Les pays du Sud n’ont-ils pas un « droit » inaliénable au développement et leurs populations ne peuvent-elles prétendre à « s’embourgeoiser » à leur tour ? La mondialisation néolibérale, tant décriée, aurait des effets positifs sur les classes moyennes au Sud. Face à la dynamique inéluctable de délocalisation des classes moyennes au Sud, les réactions égoïstes des « petits » bourgeois du Nord visant à protéger leur niveau de vie – en s’attachant à leurs privilèges, en revendiquant, en manifestant dans les rues, par exemple – seraient aussi vaines qu’inutiles, voire, à la limite, racistes.
Ce discours est totalement biaisé car la dynamique des classes moyennes suit un cycle au cours duquel elle passe par une phase de croissance, suivie d’une période de décroissement. Ces périodes sont déterminées par la nature des liens entre les classes moyennes et le capital. Pendant la phase ascendante, la classe moyenne prospère parce qu’elle est « l’alliée » du capital. Lorsqu’elle devient son « ennemie », la classe moyenne périclite. Dans les deux cas, c’est l’État, entre les mains de la classe politique, qui gère la production ou la destruction de la classe moyenne.
La dynamique cyclique des classes moyennes : entre densification et éclaircissement
Au cours des Trente glorieuses au Nord et pendant la période du développement introverti (3) au Sud, la classe moyenne s’est densifiée, avec plus ou moins d’intensité, dans de nombreuses zones de la planète. L’adoption de politiques néolibérales, de désinflation compétitive au Nord et d’ajustement structurel au Sud, a inversé la tendance en éclaircissant les rangs des classes moyennes. Cette évolution donne à penser que la dynamique des classes moyennes suit une trajectoire cyclique.
L’évolution de la classe moyenne en Afrique : l’exemple de la Côte d’Ivoire
L’expérience de la Côte d’Ivoire, pendant et après le « miracle » économique, illustre bien cette dynamique. Sous l’égide de son Président, Félix Houphouët-Boigny, la Côte d’Ivoire a mis en œuvre un modèle de développement « au caractère libéral et ouvert officiellement affirmé, devait présenter trois étapes successives : le capitalisme privé étranger, le capitalisme d’État, avant la relève par le capitalisme privé national, encouragé par un processus de rétrocession. La stratégie industrielle retenue était la substitution des importations. La politique industrielle s’est appuyée sur l’État et les intérêts français dont les profits étaient garantis par le code des investissements promulgué en 1959 et par la protection du marché interne (4) ».
Il s’agissait, pour l’État, de susciter l’apparition d’une classe « motrice », moyenne et supérieure, qui puisse prendre en main le développement national. À cette fin, l’État a mis en œuvre une stratégie multiforme notamment fondée sur : l’éducation – formation : « en 1960, l’État consacrait 22% de son budget à la formation ; cette proportion passait à 33% en 1973, pour atteindre 54,9% en 1983 (5) ». l’ivoirisation du capital et de l’emploi (et particulièrement des cadres) par la relève des étrangers dans la fonction publique, dans le secteur de l’immobilier et des PME et dans les grandes entreprises (le plus souvent filiales de sociétés transnationales) ainsi que par l’extension de l’appareil d’État et du secteur public (6). « L’appareil d’État sert de précurseur, de trait d’union et de tremplin à l’intégration des nationaux aux postes économiques. L’État joue le rôle d’agent moteur, créant les conditions de l’accès aux participations économiques, ne se substituant jamais à l’initiative privée là où elle existe, et toujours de manière à ce que ces initiatives soient compatibles avec les orientations du passé. La promotion des nouvelles initiatives tend à se faire dans des secteurs réservés (7) ».
Ainsi, grâce à l’action publique, les classes moyennes émergent. Par exemple, « avec un effectif de 78 000 emplois en janvier 1978, l’Administration est le premier employeur du pays. Comme le secteur parapublic représente pour sa part 61 000 emplois (y compris les sociétés d’économie mixte) c’est près de 40 % de l’emploi moderne qui est, directement ou indirectement, contrôlé par l’État (8) ». De même, dans son étude sur l’emploi en Côte d’Ivoire, Françoise Binet dénombre, en 1978, 4 832 patrons d’entreprises à Abidjan dont 41,2 % sont ivoiriens (9). Ces chiffres traduisent l’émergence et la densification progressive de classes moyennes salariées et entrepreneuriales au cours des Vingt glorieuses (ou du miracle ivoirien), aussi marquées par un taux de croissance du PIB réel d’environ 7 % par an en moyenne, une performance qui a engendré l’entrée de la Côte d’Ivoire dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire selon la classification de la Banque mondiale. Dans les années 1970, la Côte d’Ivoire bénéficie du niveau de vie le plus élevé d’Afrique de l’Ouest.
Le tournant se situe au début des années 1980 avec la chute des cours internationaux du cacao et du café, principales exportations de la Côte d’Ivoire. A partir de 1981, s’ouvre la période de l’ajustement. En raison de l’intangibilité revendiquée de la parité du franc CFA vis-à-vis du franc français, l’ajustement sera tout d’abord désinflationniste (en termes réels ), puis en 1994, il comportera la dévaluation de 50 % du CFA. Les mesures d’abaissement de la dépense publique, de réduction des effectifs de la fonction publique, la privatisation, la disparition pure et simple d’entreprises publiques ou d’entreprises liées à l’industrialisation par substitution des importations… vont se traduire par un appauvrissement de la majorité de la population avec un creusement des inégalités. En considérant l’indice du PIB réel par habitant égal à 100 en 1980, sa valeur n’était plus que de 79,7 en 1988 (10). La réduction des emplois publics grossit les rangs du secteur informel et inverse le flux de l’exode rural : « en ce début des années 1990, nombre d’autochtones, montés dans les villes car ayant bénéficié du programme gouvernemental de 1978, dit d’ivoirisation de la fonction publique, sont forcés de revenir dans leurs villages d’origine suite à la suppression de nombreux emplois administratifs (11) ». Ces populations, appartenant à la classe moyenne « ajustée », « compressée », sont victimes d’un déclassement. On assiste à « l’extension de la pauvreté et à l’accroissement des inégalités (12) ». L’augmentation de la pauvreté, qui en « 2008 a atteint un seuil critique de 48,9 % contre seulement 10 % en 1985 (13) », traduit le fait que la classe moyenne se paupérise.
En Côte d’Ivoire, de l’indépendance à la fin des années 1970, la classe moyenne s’est constituée dans le cadre du modèle de développement mis en œuvre par Félix Houhpouët-Boigny. Cette classe a vu ses rangs s’éclaircir progressivement avec les programmes d’ajustement structurel néolibéraux. On observe cette même dynamique sous d’autres cieux.
Argentine : « la classe moyenne est détruite (14) »
En Amérique Latine, l’exemple de l’Argentine révèle que la période des ajustements a délité la classe moyenne nombreuse qui s’était constituée auparavant. En effet, jusqu’à la fin des années 1970, « l’Argentine était une société relativement bien intégrée – tout au moins si on la compare aux autres pays d’Amérique Latine – caractérisée par une vaste classe moyenne, résultat d’un processus de mobilité sociale ascendante dont la continuité n’avait jamais été remise en cause (15) ». A partir des années 1980, la classe moyenne se délite. « On observe notamment l’entrée dans le monde de la pauvreté d’individus issus de la classe moyenne : il s’agit des « nouveaux pauvres » dont le nombre a cru de 338 % entre 1980 et 1990 (16) ». Cette tendance s’est poursuivie, si bien qu’en janvier 2002, le Président argentin nouvellement élu, Eduardo Duhalde, révélait « qu’en 2001, la classe moyenne [avait] perdu 730 000 argentins, venus grossir les rangs des 15 millions de pauvres, soit 40 % de la population du pays (17) ». A cette occasion, le Chef de l’État déclarait : « la classe moyenne est détruite (18) ».
La fin du « miracle » asiatique et le laminage des classes moyennes
En Asie du Sud-Est, de 1970 à 1995, les pays émergents ont enregistré une forte croissance économique, si bien que l’on a parlé de « miracle ». Au cours de cette période, une classe moyenne essentiellement urbaine a progressivement émergé. La grave dépression de 1997-1998 a fortement impacté « la classe moyenne des pays du Sud-Est asiatique [qui] a payé le prix fort de cette crise : de nombreuses personnes ont perdu simultanément leur emploi et les économies de plusieurs années (19) ». Le phénomène tend à se poursuivre avec la crise actuelle. En Corée du Sud par exemple, la crise actuelle (2008) « évoque celle de 1998. Du coup, les jeunes se ruent vers les sociétés d’État, où les emplois sont plus stables. En une décennie, la classe moyenne coréenne a diminué de 10 %. Beaucoup forment aujourd’hui une nouvelle classe de pauvres (20) ».
Au Nord : l’euthanasie progressive des classes moyennes
Au Nord, depuis le début des années 1980, on assiste à « l’euthanasie » de la classe moyenne constituée pendant les Trente glorieuses (21). Aux États-Unis, « s’il existe un point sur lequel les années 1980 ont réussi à créer un accord (de toute façon a posteriori) entre des économistes de différentes tendances, c’est précisément sur la diminution quantitative de la classe moyenne : « the big squeeze » de l’économie domestique située au niveau des revenus intermédiaires, la mobilité vers le bas des « cols blancs », les dumpies (downwardly mobile professionals selon la définition de Business Week) ont remplacé les yuppies plus connus du début des années 1980 (22) ». La tendance au délitement a été masquée, jusqu’à la crise des « sous-primes », grâce à « un accès au crédit excessivement laxiste » qui « a permis à une grande partie des ménages moins nantis de maintenir un niveau de vie aisé » et qui « a généré ce qu’on pourrait appeler une ‘fausse classe moyenne’ aux États-Unis (23) ». En Allemagne, selon une étude scientifique récente de l’institut DIW, au cours des dix dernières années, « les classes moyennes se sont « rétrécies (24) » car elles sont « les perdantes des transformations qu’a subi la répartition des revenus au cours de la dernière décennie (25) ». En France, la dynamique d’atrophie des classes moyennes est moins perceptible, en raison de l’existence initiale d’un État-providence renforcé et de sa plus lente destruction. Louis Chauvel montre que, pendant les Trente glorieuses, l’ascenseur social a permis à un grand nombre de jeunes, issus du milieu agricole ou ouvrier, d’accéder à la classe moyenne qui s’est développée rapidement au cours de cette période (26). C’était l’âge d’or de la classe moyenne en France. Mais, à partir du début des années 1980, la situation se détériore progressivement. « Sans nier l’importance des difficultés des classes populaires et de ceux qui font face à la marginalisation sociale, c’est au tour des catégories centrales de la société d’expérimenter une forme de précarité civilisationnelle (27) ».
Il apparaît que les classes moyennes se sont développées dans des lieux et à des moments différents, pendant des périodes de durée variable, mais caractérisées par une croissance économique relativement élevée. Lorsque l’environnement s’est révélé moins favorable, ces classes moyennes sont entrées en crise. La dynamique des classes moyennes semble suivre une chronologie caractérisée par une période de croissance, prolongée par une phase de décroissement.
Dans cette hypothèse, il est utile de s’interroger sur les facteurs explicatifs de la dynamique cyclique des classes moyennes.
Quelques pistes de réflexion sur les déterminants de la dynamique cyclique des classes moyennes
Notre hypothèse suggère que l’on assiste, dans le temps, à une montée des classes moyennes suivie de leur décrue. Une raison de cette trajectoire pourrait se situer dans le rôle ambigu des classes moyennes dans le processus de développement. En effet, les classes moyennes apparaissent à la fois comme un facteur de développement économique et comme un frein à la croissance des profits. Le cheminement cyclique pourrait s’expliquer par un échelonnement différencié dans le temps des effets précités. Dans tous les cas, il apparaît que l’évolution de la classe moyenne est intimement liée à l’intervention de l’État. C’est l’État (ou plutôt les élites politiques au pouvoir) qui décide de (dé)règlementer et de légiférer pour promouvoir ou enrayer le développement de la classe moyenne. La loi est (presque) toujours instrumentalisée pour servir les intérêts du capital qui peuvent coïncider avec ceux de la classe moyenne à un moment donné et en diverger à une autre période. En cas de convergence d’intérêts, la loi favorise la densification de la classe moyenne, en cas de divergence, la loi organise l’euthanasie de la classe moyenne jugée inutile, hostile et coûteuse pour le capital.
La classe moyenne « alliée » du capitalisme industriel
Dans certaines circonstances, la classe moyenne apparaît comme un facteur de développement de par son impact sur l’offre et sur la demande. Par exemple, au cours de la période des Trente glorieuses, la classe moyenne (intégrant une bonne partie de la classe ouvrière) a largement participé au bon fonctionnement du système fordiste, caractérisé par la production de masse et la consommation de masse. Pour son développement, le capitalisme industriel avait besoin d’un grand marché ainsi que de capacités productives résidentes pour l’approvisionner.
La classe moyenne a tenu un rôle important dans la création et le soutien de la demande tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Grâce à un pouvoir d’achat en progression régulière, elle a consommé des quantités croissantes de biens et de services standardisés, mais elle a aussi accepté de payer un prix plus élevé pour la « qualité », ce qui a stimulé l’investissement pour l’innovation, la différenciation et la commercialisation de nouveaux biens et services (28).
Du côté de l’offre, certains considèrent la classe moyenne comme un vecteur important de l’entrepreneuriat et de l’innovation des petites entreprises. La classe moyenne s’est aussi constituée à partir de la main-d’œuvre qualifiée dont les entreprises et l’État (l’État providence) avaient besoin pour leur développement. Grâce à l’effort d’éducation – formation, ladite classe a fourni le capital humain nécessaire tout en permettant à une masse d’individus issus de milieux modestes de rejoindre ses rangs. Au total, « la classe moyenne apparaît comme la source de tous les intrants requis pour assurer la croissance en termes d’économie néoclassique – idées nouvelles, accumulation du capital physique et accumulation du capital humain (29) ».
Ainsi, les Trente glorieuses ont scellé un compromis (une « alliance ») temporaire entre la classe moyenne, essentiellement salariée, et le capital industriel. La superposition géographique des aires de production et de consommation était un élément décisif du compromis. Grosso modo, ce qui était essentiellement produit au Nord était consommé au Nord. Ce faisant, la fraction de la valeur ajoutée à laquelle les capitalistes renonçaient dans le processus productif, pour la verser sous forme de salaire direct et indirect, revenait dans leur escarcelle lors de l’achat des biens et services par les salariés. En d’autres termes, le salaire était à la fois un coût et un vecteur de profit pour l’entreprise. La coïncidence géographique de la production et de la consommation engendrait un cercle vertueux conduisant au développement autocentré.
Dans une certaine mesure, on a constaté la mise en place de compromis similaires dans les pays du Sud, au cours de la période du nationalisme – clientéliste, notamment caractérisé par l’industrialisation par substitution des importations. En Côte d’Ivoire, par exemple, le compromis initiateur de la classe moyenne était fondé sur la redistribution de la rente agricole issue des filières cacao-café, sur le développement du secteur industriel ainsi que sur les apports d’aide extérieure (30). Le capital international récupérait la rente par le biais des importations et de la production nationale qu’il assurait majoritairement.
Lorsque le contexte évolue, les intérêts des protagonistes peuvent se mettre à diverger et le compromis peut être remis en cause. Dans ce cas, la classe moyenne et le capital deviennent ennemis.
La classe moyenne « ennemie » du capitalisme financier
La survenance d’une série d’évènements va graduellement modifier le contexte de l’économie mondiale : la fin du système de taux de change fixes en 1971, les chocs pétrolier de 1973 et de 1979, la stagflation, la crise de la dette des pays du Sud en 1982, la chute du mur de Berlin et l’implosion du bloc soviétique. L’évolution va permettre l’accélération et l’approfondissement de la mondialisation néolibérale, financière et économique.
Le capitalisme se financiarise et la production industrielle est relocalisée principalement sur le continent asiatique qui dispose d’une main d’œuvre à très bas salaires. La désindustrialisation frappe les pays du Nord (31), mais également les pays du Sud (32) qui avaient, dans le cadre du nationalisme – clientéliste, adopté des stratégies d’industrialisation par substitution des importations.
Le libre-échange permet d’inonder les marchés de produits à bas prix qui concurrencent (de façon déloyale ?) les productions nationales, révélant leur défaut de « compétitivité ». (Re)devenir compétitif (33) implique l’abaissement des coûts de production directs et indirects. Cette démarche passe par la réduction des salaires réels, des avantages sociaux… et, plus généralement, des dépenses « clientélistes » (assimilées à de la corruption) et des dépenses liées à l’État providence (présentées comme inéquitables, car essentiellement corporatistes).
Sous prétexte de concurrence, il s’agit de rehausser les profits. Pour ce faire, il convient d’ajuster les structures économiques et sociales nationales aux règles du « laisser-faire » – « laisser-passer », étendu à l’ensemble de la planète. « Parmi la population, comme les pauvres le sont trop et que les riches sont exemptés (34), c’est sur la classe moyenne que reposera l’essentiel de la charge de l’ajustement (35) ».
Ainsi, la classe moyenne devient « l’ennemie » du capitalisme financiarisé car son existence injustifiée – puisque sous d’autres cieux, des populations assurent les mêmes tâches productives à moindre coût – réduit les profits. Le capitalisme dénonce le compromis conclu précédemment et fait procéder à l’euthanasie de la classe moyenne parasite. Pour ce faire, l’intervention de l’État, guidée par les élites politiques complices, apparaît indispensable.
La classe moyenne produite ou détruite par l’État
L’intervention de l’État est impérative pour assurer le développement de la classe moyenne ou son euthanasie, car c’est lui qui légifère, règlemente, incite, réprime… contrôlant ainsi, plus ou moins directement, une large part de la production et de la redistribution des richesses. L’État prend et donne, fait et défait, tricote et détricote… Par le biais de la loi, du secteur public, de la fiscalité – redistribution…, l’État façonne, corrige et adapte la structure sociale nationale. Les élites politiques (issues du suffrage universel en démocratie) assurent la direction de l’État, proposent et votent les lois. Ce sont donc lesdites élites politiques nationales qui portent la responsabilité de la densification ou de l’éclaircissement de la classe moyenne.
Durant la phase ascendante du cycle, le compromis entre le capital et la classe moyenne autorise les élites politiques à œuvrer en sa faveur. L’État intervient pour assurer un bien-être accru par la loi et la réglementation, pour créer des emplois, pour mettre en place des services publics de qualité…, ce qui a pour effet de densifier la classe moyenne36 tout en permettant au capital de se valoriser pleinement. On assiste à la construction de l’État providence et de l’État nationaliste – clientéliste. Au cours de cette phase, dans les pays du Sud, une bonne partie du surplus dégagé sur le territoire national, principalement sous forme de rente (agricole, minière, énergétique…), est mobilisé par l’État et distribué sur place. C’est la période des « Pères de la nation » (Houphouet-Boigny, N’Krumah, Nyerere…). Au Nord, le fordisme permet la croissance autocentrée, génératrice de surplus largement redistribué. Sur le plan politique, le climat est assez serein. En effet, en démocratie, les élites politiques émanent, pour une large part, de la classe moyenne. Elles fondent leur discours sur les concessions, obtenues ou à négocier avec les capitalistes (37), au profit de la classe moyenne essentiellement. De ce fait, la classe politique se trouve relativement en phase avec l’électorat (38).
Au cours de la période descendante du cycle, qui coïncide avec la divergence des intérêts du capital et de la classe moyenne, l’État œuvre à la destruction de cette dernière. Cela signifie la défaisance (39) des dispositifs mis en place au cours de la période précédente : l’État providence au Nord et l’État nationaliste – clientéliste au Sud. En régime démocratique, cette démarche présente un risque majeur pour les élites dirigeantes qui doivent mettre en œuvre des politiques contraires aux intérêts de leur électorat traditionnel (40). Le contournement de cet obstacle politique implique l’atomisation du pouvoir de l’Etat central (41), l’organisation de la démocratie virtuelle (42), la promotion de l’idéologie du marché, la manipulation de l’opinion publique, le changement des élites par leur internationalisation (43)… Les élites, au pouvoir ou susceptible d’y accéder, réunies autour du projet néolibéral (monétariste ou ordolibéral) qu’elles déclinent avec le vocabulaire propre à leur position « officielle » sur l’échiquier politique, produisent un discours étriqué et peu différencié, qui tente de cacher la réalité de la dynamique de paupérisation du plus grand nombre, imposée par le capitalisme financiarisé. Le fossé se creuse entre la classe politique et les électeurs qui expriment leur désintérêt par une abstention massive aux scrutins électoraux. Malgré cela, les élites s’impliquent de plus en plus au service du capital contre les populations et particulièrement contre la classe moyenne. Pour elles, les règles du marché qui sont censées récompenser les prudents (44) et sanctionner les téméraires ne s’appliquent pas aux capitalistes financiers. La crise de 2008, montre que les élites ont fait en sorte que « les téméraires semblent être les bénéficiaires de la crise qu’ils ont provoquée, tandis que le reste de la société [et particulièrement la classe moyenne] porte le fardeau de leur insouciance (45) ». L’instrumentalisation de l’État et des institutions supranationales au service du capitalisme financiarisé engendre une crise globale de légitimité des élites, qu’elles soient nationales ou internationales.
Au total, selon que la classe moyenne sert ou dessert le capital, les élites utilisent l’État pour en densifier ou pour en éclaircir les rangs.
Conclusion
De nombreux scientifiques et commentateurs ont souligné l’importance des classes moyennes dans le processus de développement. Les performances des pays du G7 qui, de 1965 à 2004 ont représenté une part quasi stable de 65 % du PIB mondial peuvent être, en grande partie, attribuées à une classe moyenne nombreuse46. « Ce sont les classes moyennes qui ont bâti l’économie française du XXème siècle ; elles en ont été les plus grandes bénéficiaires (47) ». Plus généralement, « sur le long terme (200 ans), l’économie de marché occidentale a resserré les inégalités entre les classes sociales [et] ce sont les classes moyennes qui ont le plus bénéficié de ce resserrement des inégalités (48) ». La tendance s’inverse à partir de la fin des années 1970 avec la mondialisation néolibérale qui lamine progressivement les classes moyennes. Face à ce constat, d’aucuns (49) avancent que la « réduction » des classes moyennes dans certaines zones géographiques serait surcompensée par la densification de ces mêmes classes dans d’autres zones du globe.
On s’interroge sur l’apparition et la densification des classes moyennes dans les pays émergents (Chine, Inde…). Selon notre analyse, dans un contexte de mondialisation néolibérale, de libre-échange, de déréglementation, de libre mouvement des capitaux… et de non-intervention incitatrice et protectrice de l’État, les classes moyennes ne seront qu’un phénomène éphémère. En effet, le marché mondial mettant en concurrence tous les peuples, les revenus sont forcément plafonnés par la nécessité de rester compétitifs par rapport aux nouveaux entrants sur ledit marché (par exemple : la Chine par rapport au VietNam…, etc). Dans ces conditions, une classe moyenne ne peut se développer durablement. Dès que, dans un pays, les revenus atteignent un certain seuil, les coûts de production deviennent trop élevés pour affronter la concurrence tant sur le marché national que mondial. Les productions concernées sont alors délocalisées vers des pays ou des régions plus compétitives, où se créent des embryons de classe moyenne au « détriment » de celle du pays d’origine. Il s’agit d’une sorte de jeu à somme nulle où l’un gagne ce que l’autre perd (50).
Pour se densifier durablement, la classe moyenne a besoin de l’intervention incitatrice et protectrice de l’État qui ne peut intervenir dans un contexte de mondialisation néolibérale. Il faut donc réhabiliter l’État. De plus, les élites politiques à la tête de l’État (ou susceptibles de l’être) doivent privilégier les intérêts de la classe moyenne par rapport à ceux du capital.
Depuis de nombreuses années, l’expérience nous montre qu’au niveau mondial – à quelques rares exceptions près (51) – les élites au pouvoir, au capital social internationalisé, semblent plutôt être à la solde du capital financier. Cela signifie que l’avenir radieux des classes moyennes implique le changement des élites qui ne se fera certainement pas sans violence (52).
Bernard Conte (2010)
Notes :
1 Cet article est une version épurée d’une communication présentée au Congrès des études africaines en France, CEAN – IEP de Bordeaux, septembre 2010.
2 En France, on les nomme : droite « bling bling » et gauche « caviar », sur le plan des idées politiques, une épaisseur de moins d’un cheveu les sépare.
3 Au Sud pendant cette période, « de nombreux pays optent pour un développement introverti en mettant en œuvre des stratégies d’industrialisation par substitution des importations (ISI), aptes à lutter contre la détérioration des termes de l’échange (DTE). Il s’agit de remplacer progressivement les importations de produits manufacturés par la production nationale dans une stratégie de remontée de filière. Pour ce faire, le marché domestique doit être protégé (au moins temporairement) et l’État joue un rôle majeur dans la mise en œuvre de ladite stratégie (state-led-development) », Bernard Conte, Clientélisme, ajustement et conflit, Bordeaux, CED, DT n° 101, 2004, p. 1.
4 Bernard Conte, Clientélisme, ajustement et conflit, op. cit. p. 5.
5 Bernard Conte, La division internationale du travail et le développement interne : le cas de la Côte d’Ivoire, op. cit. p. 359.
6 Ibidem, p. 321-376.
7 Bonnie Campbell, « Quand l’ivoirisation secrète une couche dominante », Le Monde diplomatique, novembre 1981.
8 République de Côte d’Ivoire, Ministère du plan, Plan de développement économique social et culturel, 1981-1985, Abidjan, 1982, p. 744.
9 Bilan national de l’emploi en Côte d’Ivoire, Ministère des relations extérieures, Etudes et documents, n° 47, Paris, mai 1982, p. 132.
10 Jean-Paul Azam, La faisabilité politique de l’ajustement en Côte d’Ivoire (1981 – 1990), (version révisée n°3) études du Centre de développement, OCDE, Paris, 1994, p. 71.
11 « Cote d’Ivoire, compétition capitaliste aigüe autour de la répartition de la rente issue de l’exploitation des ressources naturelles », La lettre de mouvement communiste, n° 15 ; janvier 2005, http://www.mouvement-communiste.com... consulté le 19 août 2010.
12 Denis Cogneau et Sandrine Mesplé-Somps, L’économie ivoirienne, la fin du mirage ? Dial, Paris, Document de travail DT/2002/18, Décembre 2002, p. 88.
13Afrik.com, « Côte d’Ivoire : la pauvreté atteint le seuil critique de 48,9 % », 6 janvier 2009,
http://www.afrik.com/breve15294.html consulté le 19 août 2010.
14 Gabriel Kessler, « L’expérience de paupérisation de la classe moyenne argentine », Cultures & Conflits, 35, 1999, http://www.conflits.org/index173.html Consulté le 17 juillet 2010. Le délitement de la classe moyenne s’observe aussi au Brésil, cf. par exemple : Larissa Morais, « La classe moyenne brésilienne », Jornal do Brasil, 12 mai 2004, traduction Elizabeth Borghino pour Autres Brésils, http://www.autresbresils.net/spip.p... consulté le 8 août 2010.
15 Gabriel Kessler, « L’expérience de paupérisation de la classe moyenne argentine », art.cit.
16 Idem.
17 Latinreporters.com, « Argentine : le péroniste Eduardo Duhalde, 5e président en deux semaines », http://www.latinreporters.com/argen... , consulté le 1er août 2010.
18 Idem. Le délitement de la classe moyenne s’observe aussi au Brésil, cf. par exemple : Larissa Morais, « La classe moyenne brésilienne », Jornal do Brasil, 12 mai 2004, traduction Elizabeth Borghino pour Autres Brésils, http://www.autresbresils.net/spip.p... consulté le 8 août 2010.
19 Geneviève Brunet, « Crise des pays émergents. De bons élèves lourdement punis », L’Hebdo, http://www.hebdo.ch/crise_des_pays_... consulté le 1er août 2010. Voir aussi : John Evans, « Impact social de la crise asiatique. » Le Monde diplomatique, mai 1998, pp. 3.
20 Alain Wang, « Asie : la crise frappe les classes moyennes », », Courriercadres.com http://www.courriercadres.com/conte... 19 mars 2009, consulté le 2 août 2010.
21 Cf. Bernard Conte, La Tiers-Mondialisation de la planète, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2009.
22 Christian Marazzi, « Middle-class confusion de terme, confusion de concept », Collectif d’analyse politique, http://cap.qc.ca.edu/a-la-redecouve... Première publication en juillet 1994, Mise en ligne le lundi 7 juillet 2003, consulté le 2 août 2010.
23 Marc-André Gagnon, « La ‘fausse classe moyenne’ piégée », Le journal des alternatives, http://www.alternatives.ca/fra/jour... 30 avril 2009, consulté le 2 août 2010.
24 « Elles constituent désormais moins des deux tiers de la société », Cf. note suivante.
25 Cidal, « L’érosion des classes moyennes se poursuit en Allemagne », Centre d’information et de documentation sur l’Allemagne, Paris, http://www.cidal.diplo.de/Vertretun... , publié le 17/06/2010, consulté le 4 août 2010. L’étude est disponible à cette adresse : http://www.diw-berlin.de/documents/...
26 Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, Paris, Seuil, 2006.
27 Louis Chauvel, « Classes moyennes, le grand retournement », Le Monde, 3 mai 2006. p. 24.
28 Kevin Murphy, Andrei Shleifer et Robert Vishny, “Income Distribution, Market Size and Industrialization,” Quarterly Journal of Economics, (août 1989), p. 537-564.
29 Homi Kharas, The emerging middle class in developing countries, Working Paper n° 285, Paris, OCDE, Development Centre, janvier 2010, p. 7. Traduction de l’auteur.
30 Cf. Bernard Conte, « Côte d’Ivoire : du clientélisme ‘éclairé’ au clientélisme ‘appauvri’ », Strategic-Road.com, 19/04/2003, http://www.strategic-road.com/pays/... consulté le 27 août 2010.
31 « [En France], de 1997 à 2007, la part de l’industrie dans le PIB est passée de 18,4% à 12,1% et les emplois industriels ont diminué de 2 millions en trente ans », Pascal Salin, « Faut-il craindre la désindustrialisation ? », La Tribune, 10/03/2010.
32 « L’ajustement structurel a contribué, contrairement à ce que laisse entendre le FMI, à la désindustrialisation de l’Afrique », Joseph Stiglitz, « L’Afrique doit compter davantage sur elle-même », Les Afriques, 08/02/2010, http://www.lesafriques.com/actualit... consulté le 26/08/2010.
33 La compétitivité devient obsessionnelle. Cf. par exemple : T. Biggs, M. Miller, M. Otto, C. et G. Tyler, « Africa Can Compete ! Export Opportunities and Challenges for Garments and Home Products in the European Market, » World Bank – Discussion Papers 300, World Bank. 1996.
34 Les riches sont les seuls censés produire de la croissance, il faut les protéger, par exemple grâce à un « bouclier » fiscal.
35 Bernard Conte, « Le oui irlandais débloque l’Europe ordolibérale », Contre Info.info, 10/10/2009, http://contreinfo.info/article.php3... consulté le 27/08/2010.
36 Au Chili, « les couches moyennes ont joui d’une redistribution favorable – à l’intérieur de l’ensemble des salariés – des dépenses publiques dans les domaines de la santé, de l’éducation et surtout du logement, sous les différents gouvernements démocratiques qui ont précédé la dictature », Rosa Jimenez et René Urbina, « Les avatars des couches moyennes dans le Chili d’aujourd’hui », in. Tiers-Monde, 1985, tome 26, n° 101. Classe moyenne : la montée et la crise, p. 154-174. citation p. 161.
37 Il semble que les capitalistes soient prêts à accorder la majorité des concessions, car elles vont dans le sens de la marche du fordisme et du nationalisme – clientéliste.
38 Les promesses électorales peuvent être globalement tenues.
39 C’est à dessein que j’emploie le terme du vocabulaire financier « défaisance », car il s’agit d’une exigence du capitalisme financier.
40 En régime « moins » démocratique, la démarche peut conduire au conflit, éventuellement armé. Cf. Bernard Conte, « Afrique de l’Ouest : clientélisme, mondialisation et instabilité », Paris, Encyclopaedia Universalis, 2004, p. Du même auteur : « La responsabilité du FMI et de la Banque mondiale dans le conflit en Côte d’Ivoire », Etudes internationales, vol. XXXVI, n° 2, juin 2005. p. 219-228.
41 Cf. Bernard Conte, La Tiers-Mondialisation de la planète, op. cit. p. 194-199.
42 Ibidem, p. 199-203.
43 Cf. Yves Dezalay et Bryant G. Garth. La mondialisation des guerres de palais. Paris, Le Seuil, 2002 ; Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages : America’s Role in the Technetronic Era, New York, Viking Press, 1970.
44 Ceux qui prennent des risques « calculés » par opposition à ceux qui prennent des risques « inconsidérés ».
45 George Friedman, “The Global Crisis of Legitimacy”, Stratfor, global intelligence, 4 mai 2010. http://www.stratfor.com/weekly/2010... consulté le 19 août 2010. Traduction libre.
46 “Underpinning the performance of the G7, and indeed driving the global economy, is a large middle class”, Homi Kharas, The emerging middle class in developing countries, op. cit.
47 Xavier Théry, « Comment les classes moyennes ont divorcé des élites », Marianne 2, 27/09/2009, http://www.marianne2.fr/Comment-les... consulté le 30/08/2010.
48 Ibidem.
49 Les néolibéraux évidemment.
50 Par contre, le capital est toujours gagnant.
51 On peut citer le Venezuela.
52 Les révolutions ont souvent eu pour origine la classe moyenne.