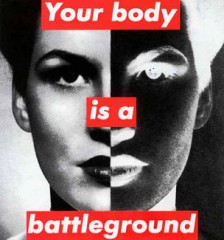"Le célèbre fragment d’Héraclite Polemos pantôn pater esti a souvent été traduit par « la guerre est mère de toute chose » (1). C’est trop en faire, ou trop peu. La guerre, conflit armé, est certes une expression du polemos, la plus tragique, ou la plus violente, mais elle n’en épuise pas la signification dans la mentalité grecque archaïque. Celle-ci appréhende en effet la différence conflictuelle comme un principe moteur de l’identité, et pas seulement dans les discordes entre personnes ou entre cités. Héraclite lui-même rassemble sous le même modèle, directeur et divin, des oppositions dichotomiques et fondatrices telles que : jour/nuit, hiver/été, guerre/paix, satiété/faim (2), etc. Une telle extension n’est pas propre au poète éphésien. Si l’on examine par exemple le début de la Théogonie d’Hésiode, on trouve un autre type de configuration qui rappelle le polemos héraclitéen : de Chaos naissent, tout à la fois, Ouranos et Gaïa, c’est-à-dire deux opposés apparaissant en même temps que le principe qui les met en relation, Eros (3). Dans cette trilogie initiale, induite de la béance nommée Chaos, l’Eros premier ne produit rien, mais permet à Ouranos et Gaïa de s’éprouver comme différents et d’engendrer. Eros est, en quelque façon, la source féconde dont s’exhaussent d’un même éclair la paternité et la maternité, la différence et l’union, lesquelles initient la production, la génération. Dans une autre théogonie, celle des Rhapsodes, Eros est le produit de l’œuf primitif et, dans le même mouvement, le masculin/féminin, origine du monde. Cette ambiguïté de l’Eros placé à la source des différences, qui les conjoint et les disjoint, exprime dans la mentalité antique une forme divine, une hypostase du polemos tel qu’il procède parmi les hommes, par élection, configuration ou confrontation des dissemblances, ce qui est source de mouvement, de génération. Ce que dit bien la suite, souvent omise, du fragment d’Héraclite cité en premier, indiquant que polemos est basileus pantôn, maître de toute chose : « Il indique leur place à ceux qui sont des dieux et à ceux qui sont des hommes ; il fait les uns esclaves et il fait les autres hommes libres. » Héraclite précise ailleurs que « Polemos est inhérent à tout. Dikè [le droit] n’est rien que dispute [eris], et toutes choses sont engendrées par dispute » (4). En d’autres termes le polemos, catégorie incluant l’eris, joute ou dispute, contient, indiscernables, le conflit sans lequel le droit n’aurait pas de signification (eris), et l’équilibre fécond de la puissance de chacun (eros) ; il en est le principe révélateur en même temps que générique ou, pour reprendre une expression de Cicéron, genus sua sponte fusum, la manifestation d’« une forme qui se développe d’elle-même ».
Pour comprendre Héraclite, il est ainsi nécessaire d’inclure dans l’intellection de polemos son exact opposé, eïrènè, la paix. Héraclite conteste ici Homère, lequel appelait de ses vœux, dans l’Iliade, la disparition de toute dispute entre les dieux et entre les hommes (5). Au témoignage d’Aristote, Héraclite aurait affirmé qu’une telle annulation des opposés était inimaginable, « car il n’y aurait pas d’harmonie sans l’aigu et le grave, ni d’animaux sans les contraires que sont mâle et femelle » (6). La reconnaissance des oppositions est ici présentée très explicitement comme l’un des éléments ou des objectifs majeurs de la prudence antique, cette vertu propre à la sagesse. L’ancienne médecine en avait tiré ses principes d’analyse des équilibres physiologiques entre le chaud et le froid, le sec et l’humide, l’aérien et le terrien, l’aquatique et le fugéen, toutes choses qui, dérangées de leur contexte, considérées hors du point de vue qui leur donne un sens, paraissent naïves ou fautives à un esprit moderne. Du point de vue antique, celui de la saisie équilibrée de l’ordre du monde et de la coprésence de ses contraires, il faut comprendre, prendre ensemble, les deux termes polemos et eïrènè, deux opposés appartenant à un seul et même processus générateur, universel, qui leste d’un peu de perspicacité ou de clairvoyance l’examen de ce qui se joue dans les relations entre les hommes et entre les cités.
Il faut tenir compte bien sûr dans cette observation de ce qui est propre à l’humain, et qui constitue au regard des Grecs une erreur fatale, à savoir l’hubris, la démesure. Il existe dans la conduite de la guerre une outrance, inconnue des animaux, et qui est propre aux hommes. Ceux qui mènent une guerre considérée comme sa propre fin, et cherchent à annihiler l’ennemi, font disparaître de l’horizon la paix sans laquelle la guerre n’a pas de signification. Or si la guerre est non pas inclusive mais exclusive de son opposé, elle conduit au désert, à une mort universelle dans laquelle « il ne se passerait plus rien et plus rien ne viendrait au jour » (7). Telle est bien l’erreur des bellicistes, à vouloir anéantir leur ennemi. Il existe une erreur symétrique, celle des pacifistes qui, à préférer la paix à tout prix, préparent leur propre anéantissement, c’est-à-dire leur esclavage chez les autres, comme si la guerre qu’ils condamnent au nom d’une morale individuelle était inessentielle et évitable, alors qu’elle fait partie constituante des relations empiriques, et est en ce sens inévitable, de cet ordre de nécessité à l’œuvre dans ‘il vente’, ‘il pleut’ ou ‘il fait chaud’. Le modèle qui subsume cette alternative est donné, chez les Grecs, par les jeux et la lutte. Non que la guerre entre cités soit un jeu comparable à ceux que pratiquent les enfants ou les athlètes, mais elle doit se soumettre aux mêmes règles de justice et d’équanimité que la joute agréée à Olympie. Le poète Ménage, dans cette lignée-là, à ce qu’en rapporte Littré (8) dérivait le terme français « joute » du latin justus : justa pugna, le combat régulier. C’est seulement « à la régulière » que, du combat, émerge une signification.
Certes, la transformation des techniques militaires a mené, comme le soulignait Ernst Jünger très tôt après la Grande Guerre, à la mise en œuvre de guerres totales dans lesquelles l’écrasement de l’ennemi, voire son anéantissement, est à l’ordre du jour. Ce développement tendanciel, comme l’ont noté Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux, vient déposséder la première fonction dumézilienne de ses prérogatives souveraines d’alliance, au profit d’une seconde fonction guerrière à tendance hégémonique, qui nie l’intérêt de l'accord, du contrat ou du pacte, et refuse de se soumettre au contrôle et aux fins du pouvoir souverain, en s’autonomisant dans ce que Deleuze nomme une « machine de guerre ». Du point de vue d’une telle machine, il est indispensable de détruire l’ennemi. Mais c’est négliger une réalité élémentaire, propre au conflit constitutif de la relation : que les deux adversaires n’existent, d’une certaine manière, que dans et par leur réciprocité, et que la disparition de l’un - même relative - affaiblit l’autre, ne serait-ce qu’en l’inclinant à baisser la garde sans proportion adaptée à la menace. On peut comprendre de cette manière l’absurdité du Traité de Versailles de 1919 qui, en humiliant l’Allemagne, affaiblissait la France, ce que la suite des événements n’a pas manqué de souligner en 1939. Ou, dans la même optique, l’échec des complexes militaro-indutriels américain (Vietnam) ou russe (Afghanistan) sur des terrains où leur supériorité technique était pourtant indiscutable.
Ici s’éclaire la double nature du polemos qui, parce qu’elle est empirique et non purement rationnelle ou procédurale, superpose plusieurs réalités, et donc plusieurs logiques. Il y a tout d’abord celle de la lutte, qui oppose deux contraires : victoire et reddition. En dehors de la mort qui peut être son destin, le soldat est confronté à cette dichotomie, soit vaincre, soit se rendre. Le point de vue est technique, et dépend des règles et des armes. Mais il y a aussi, associée à la précédente et la subsumant, la logique du conflit, qui met en présence deux autres contraires, polemos et eïrènè, guerre et paix, discorde et traité. En d’autres termes, la lutte en tant qu’expression de la seconde fonction dumézilienne n’exclut pas, mais induit, la guerre en tant que relevant d'une décision de la première fonction. L’histoire moderne a montré à de multiples reprises combien la guerre totale conduit à une impasse en évinçant - au moins temporairement - l’accord potentiel qui donne un sens à la guerre. Les deux derniers conflits français, au Vietnam et en Algérie, ou les derniers conflits américains, au Vietnam et en Irak, sans parler de celui en cours en Afghanistan, ont mené à ce type d’impasse, et ont conduit à des accords tardifs qui, loin de refléter les conditions de la lutte, souvent techniquement victorieuse, ont traduit les modalités de guerres politiquement mal conduites, dans lesquelles l’horizon de la paix avait par avance été négligé, méprisé, voire exclu, dans un processus tel que le motif de la guerre n’ayant pas été éclairci ou précisé, les moyens ont été confondus avec le prétexte, ou le prétexte avec les fins.
On notera ici combien la lutte, dans la durée, avec les efforts, les volontés, les courages et les énergies qu’elle oppose et engage, oblige au dépassement (alèthéïa) d’un tel oubli de la paix, et au dégagement progressif d’un horizon d’accords ou de contrats sans lequel les belligérants s’enlisent, non seulement sur le terrain, mais aussi dans des querelles politiques internes qui repolitisent immanquablement la guerre externe. Les dernières guerres coloniales anglaises, françaises ou américaines ont montré ce genre de contraintes, telles que c’est bien la menace d’une discorde interne devenue difficilement surmontable, voire le spectre d’une guerre civile (manifestations américaines contre l’intervention en Asie du sud-est, 1967), qui incite à des accords politiques externes concluant les conflits empiriques. Il y a dans ce processus, si l'on peut s'exprimer ainsi, une réinjection d'Héraclite dans Dumézil : le conflit entre deux armées est une apparence ; un autre affrontement se joue aussi dans les guerres, un conflit, dans chaque camp, entre la première et la troisième fonctions. Thucydide en donne un exemple clair, celui de la rencontre des ambassades des Méliens et des Athéniens. Aux premier venus plaider la cause de leur neutralité (tel était l'intérêt de leur faiblesse interne) les Athéniens répondent : « Non, votre hostilité nous fait moins de tort que votre neutralité ; celle-ci est aux yeux de nos sujets une preuve de notre faiblesse ; celle-là un témoignage de notre puissance... » (9) Les conflits internes sont ici clairement décrits comme présents dans les conflits externes ; ils seront donc présents dans leur résolution politique.
Autant dire que si ab initio le motif de la guerre masque ses fins, le déroulement de la guerre, quant à lui, ne manque pas de rappeler que cette fin est à construire (poïeïen) de manière politique, et non selon une logique militaire ou une technique de la lutte. L’un des rares dirigeants à appliquer cette prudence fut Henry Stimson, secrétaire d’Etat de Hoover de 1929 à 1933, puis dans les administrations Roosevelt et Truman. Il considérait, bien avant la guerre, qu’il serait impossible de nouer des relations diplomatiques avec un Etat conquis et détruit par la force. En 1945, il s’opposa avec fermeté, pour cette même raison, au bombardement atomique de Kyoto, capitale impériale et religieuse d'un Japon millénaire, et premier objectif inscrit sur la liste du général Groves, responsable militaire du projet Manhattan. Il dévia ainsi l’arme fatale vers Hiroshima et laissa relativement ouvert le devenir des relations nippo-américaines, ce que la destruction de Kyoto eût interdit, du fait de sa puissance symbolique.
Si l’adage clausewitzien selon lequel « la guerre est la simple continuation de la politique par d’autres moyens » a bien un champ d’application dans l’étude polémologique, force est de constater qu'il peut, de manière tout aussi éclairante pour l’analyse des faits, s’inverser en un autre adage selon lequel « la paix est la continuation de la guerre par d’autres moyens politiques », étant entendu que, dans ce cas, le traité n’élimine pas la réalité fondamentale du polemos mais la subsume, au moins durant le temps où les ennemis d’hier s’accordent à appliquer les clauses du traité. Raison pour laquelle tout contrat ou pacte humiliant l’ennemi, et rendant de ce fait ses clauses insupportables et inapplicables dans la durée, prépare certainement la guerre suivante. On peut relire à cette aune les péripéties des guerres du Péloponnèse telles que les transcrit Thucydide, lequel leur donne une typicité universelle « tant que la nature des hommes restera identique ». Il considère que la pensée de la guerre n’est pas pratique, empirique, ou démonstrative par elle-même, mais devient belligène sous l’empire d’une représentation, celle du danger qu’il y aurait, du point de vue d’Athènes, à laisser croître la puissance de Sparte, ou réciproquement. De la guerre en cours et de son horizon plus lointain, Périclès disait aux Athéniens : « Sachez prévoir un avenir noble en même temps qu’un présent sans honte, et qu’un zèle immédiat vous conduise à ce double but. » (10). Il visait les assauts actuels entre cités, en même temps que l’avenir de la Grèce. De sorte qu’il est légitime de reprendre, à propos du polemos, la qualification de diplopie utilisée par Merleau-Ponty à propos de l’ontologie : polemos incline à une double vision, binoculaire, de deux réalités à imager dans le même dispositif, celle du combat technique confié aux militaires, et celle du différend politique arbitré par la souveraineté. Cette diplopie est le signe de la nature même du polemos ; non pas une théorie dont le discours épuiserait les potentialités, mais une réalité sans cesse en devenir, jamais résolue parce que jamais révolue. Autant dire qu’il n’y a pas de plénitude primordiale ou essentielle du politique ; sa réalité polémique le renvoie, comme à son ombre, à ce qu’il doit surmonter sans cesse pour s’exercer pleinement : un polemos équivalant à la « nature des choses » de Lucrèce. En quoi il est bien ce qu’en traduisait Nietzsche : non pas une volonté de puissance, mais un Wille zu Macht, un vouloir vers la puissance.
Ainsi polemos est mieux compris, considéré comme un processus qui, en tant que tel, n’a ni but ni terme fixé par avance : c’est un horizon nécessaire où se recueille, dans la lutte, sa capacité à éclairer, pour le combattant, l’acte même de lutter et, pour le politique, la disposition de la Cité à assumer ce dont est gros le présent, c'est-à-dire un devenir, son propre devenir. La guerre n'abolit pas l'inimitié réelle, elle se présente plutôt comme l'occasion de son assomption dans l'élucidation d'une impasse politique actuelle. Ce qu'en disaient les Corinthiens venant chercher secours et alliance auprès de Sparte, et plaidant pour cela contre la violation tacite par Athènes des traités antérieurs : « Alliés, nous sommes maintenant face à une nécessité, et cette issue est la meilleure : votez la guerre en ne vous laissant pas effrayer par les difficultés immédiates, mais en aspirant à la paix plus durable qui en sortira. C'est après la guerre que la paix est plus assurée (…). Préparons-nous un avenir sans menace. » (11)
Le mobile de la guerre serait-il l'espérance (elpis), celle-là même qui gisait au fond de la jarre de Pandore ? Héraclite dit : « Qui n'espère pas l'inespérable ne le découvrira pas : il est introuvable et inaccessible. » (12). Il y a de l'inconnu, et seules les voies de l'expérience créent ce que l'expérience n'a pas encore vécu ni compris. Quand Héraclite dit polemos pantôn pater esti, il n'est pas belliciste. Il constate seulement que vivre est une suite ininterrompue d'apprentissages des relations d'opposition, et une succession de subsumations des contrariétés que l'expérience dévoile. Non que le conflit soit au principe théorique de la réalité, comme sa doctrine la plus sûre, mais plutôt au principe empirique de l'élaboration d'une pensée sage, qui surmonte sans fin les termes des querelles, des dissensions, des compétitions et des ruptures qu'elle découvre comme étant son monde, partagé avec autrui et engendré avec lui. Tout comme 'la guerre à tout prix', le slogan 'la paix à tout prix' n'est qu'un mot d'ordre oublieux de son contraire, et donc paradoxalement belligène. La guerre a un prix. La paix a un prix. Aussi vaut-il mieux laisser au polemos héraclitéen son sens froid de conflit, ce mode d'apprentissage et d'engendrement de toute réalité partagée, par des individus comme par des Cités. Il redevient alors, détaché de la dramaturgie de la guerre, un outil d'analyse efficient.
On trouvera une application très actuelle des clarifications auxquelles conduit l'analyse polémique, au sens héraclitéen du terme, dans une réflexion de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss à propos des pratiquants de l'Islam, décrits comme « incapables de supporter l’existence d’autrui comme autrui. Le seul moyen pour eux de se mettre à l’abri du doute et de l’humiliation consiste dans une 'néantisation' d’autrui, considéré comme témoin d’une autre foi et d’une autre conduite » (13). Si la destruction de gratte-ciels par des avions de ligne (New York, 11 septembre 2001) constitue bien un acte de guerre, elle n'explicite pas pour autant le polemos en cours, auquel répliquerait dans le même registre une invasion de l'Afghanistan. Le polemos, présent bien avant l'acte de guerre, est d'un autre ordre : il réside dans un conflit radical entre l'universel d'une théologie qui n'admet pas d'altérité, et l'universel d'un juridisme formel (droits de l'Homme) qui n'en admet pas non plus. Deux groupes de sociétés culturellement fermées se trouvent ainsi en expansion territoriale sur des terrains communs, et se condamnent réciproquement. L'enchevêtrement des intérêts commerciaux ou énergétiques qui doublent et cachent le polemos fondamental ajoute à la confusion, qu'obscurcissent encore les différences de moeurs ou d'habillements, considérées pour elles-mêmes, hors la souveraineté qui les légitime, contraintes ici par une théologie, libérées ailleurs par un droit. Si les analystes et les chancelleries se penchaient sur les tours et détours qu'emprunte réellement le polemos, ils découvriraient non seulement les ressorts de conflits entre nations, en cours ou à venir, mais encore ceux de bien des conflits internes, latents ou exprimés, entre groupes sociaux ou ethniques. Lesquels menacent le plus gravement, à terme, l'exercice des souverainetés politiques en place ? Les temps à venir apporteront des réponses. Il n'est pas certain qu'elles seront juchées sur des pattes de colombe."
Jean-François Gautier
Krisis n° 33 La Guerre
Notes :
(1) -Héraclite, Conche fr. 129 = Diels-Kranz fr. 53. « Le conflit est père de toute chose» est une translation évidemment préférable. On rappellera que La guerre, notre mère est le titrage fautif d'une traduction française du livre de Jünger Der Kampf als inneres Erlebnis (1922), mieux transcrit par Le Combat comme expérience intérieure, Bourgois, 1997.
(2) -Héraclite, C.109 = DK.67
(3) -C’est l’Eros primitif, à distinguer de l’Eros érotique. Ce second Eros (Hésiode, Théogonie, 201-202) apparaît en compagnie d’Himéros (nostalgie) et Pothos (attraction), et accompagne Aphrodite dès sa naissance.
(4) -Héraclite, C.128 = DK.80.
(5) -Iliade, XVIII, 107.
(6) -Ethique à Eudème, VII, 1, 1235 a 26.
(7) -Conche, Héraclite, PUF, 1987, p.439.
(8) -Littré, Dictionnaire de la langue française, s.v. « joute ».
(9) -Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, V, XCV.
(10) - Thucydide, G. Pelop., II, LXIV.
(11) - Thucydide, G. Pélop., I, CXXIV.
(12) - C.66 = D.K.18.
(13) - Tristes tropiques, Plon, 1955, p.467.
Il est possible de se procurer les numéros thématiques de la revue Krisis (plusieurs par an) à :
http://www.alaindebenoist.com/pdf/bulletin_de_commande_krisis.pdf