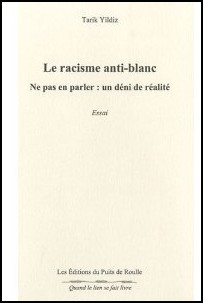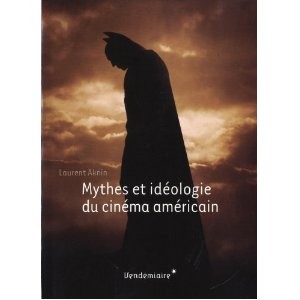Le retour de la gauche : le vol du bourdon
Aux législatives de juin, la gauche devrait obtenir, selon les sondages actuels, moins de voix que la droite mais elle gagnerait pourtant la majorité de l’Assemblée nationale : cela grâce à la désunion suicidaire de la droite.
La gauche va donc bientôt cumuler tous les pouvoirs, mais on voit bien que le cœur n’y est pas. Car nous ne sommes plus en 1981.
Pas d’état de grâce
Le sondage Harris Interactive du 16 au 18 mai 2012 (soit après l’annonce de la composition du nouveau gouvernement) montre que si F. Hollande jouit pour le moment d’une opinion favorable (54% déclarent lui faire confiance), il est loin d’atteindre les scores de ses prédécesseurs. Le sondage TNS Sofres/Sopra group/ Figaro Magazine des 25 et 26 mai 2012 (leFigaro.fr du 31 mai 2012) donne des résultats voisins (55% d’opinions favorables). Mais Mitterrand en 1981 atteignait 74% d’opinions favorables et Sarkozy 63% en 2007. En d’autres termes, F. Hollande ne bénéficie pas d’un véritable état de grâce. Ces sondages ne doivent pas surprendre : ils reflètent en effet une réalité politique simple : F. Hollande n’a pas été élu à la majorité des votants (seulement 48,6% des votants).
Certes, les sondages montrent aussi qu’une majorité de personnes interrogées ne veulent pas d’une nouvelle cohabitation, qui signifierait un nouvel immobilisme, ce qui laisse présager une majorité socialiste aux élections législatives. Mais cela ne signifie pas que le programme socialiste soit « majoritaire » pour autant.
Un mauvais goût de déjà vu
En 1981, la gauche avait la satisfaction de parvenir enfin seule au pouvoir, une première depuis la Libération. Elle était en outre bardée des certitudes du Programme commun et promettait la « rupture ». Aujourd’hui, la victoire de la gauche a un mauvais goût de déjà vu et dans les beaux quartiers on ne croit plus que les chars russes vont bientôt déferler sur les Champs-Elysées.
En 1981, des fonctionnaires avaient quitté leurs fonctions pour ne pas collaborer avec le nouveau pouvoir socialo-communiste. Aujourd’hui, personne ne l’a fait. La gauche a repris l’Etat comme si de rien n’était, car elle fait partie des meubles désormais.
Ce n’est pas la normalité qui triomphe, c’est la morosité
Ce n’est pas la « normalité » qui triomphe mais la morosité qui est générale. Il n’y a que les Français de papier pour agiter des drapeaux – étrangers – de la liesse « populaire ».
Car si la droite est une fois de plus dans les choux, la gauche aborde 2012 avec un logiciel idéologique dépassé. Mais elle donne le sentiment d’en avoir vaguement conscience, au surplus.Cela ajoute au malaise, et explique sans doute le visage crispé et triste du nouveau président, qui se demande sans doute comment il va « appliquer son programme » de changement après les élections. Mais pour changer quoi, au juste ?
Un logiciel économique dépassé
Par exemple F. Hollande a demandé à la Cour des comptes un audit des finances publiques… comme en 1981. Mais F. Hollande semble ignorer que depuis 2006 les comptes de l’Etat sont tenus en comptabilité générale et certifiés : on mesure exactement ses engagements. On connaît avec précision l’ampleur de la dette et des déficits publics. L’audit ne sert à rien, sauf à faire de la communication sur « l’héritage » de Sarkozy ; et aussi à semer l’inquiétude sur la situation de la France.
Car la gauche française, qui promet de maîtriser les déficits en retrouvant la croissance, ne sait pas – et n’a jamais su – réduire les dépenses publiques. Dans le meilleur des cas elle gagera laborieusement d’un côté le surplus de dépenses qu’elle a promis de faire de l’autre. Son truc c’est, au contraire, toujours d’augmenter les impôts, bien sûr au nom de la « justice sociale », en fait de l’égalitarisme. C’est bien plus facile à réaliser avec une majorité godillot qui vient d’être élue ; et c’est bien plus porteur que de mécontenter les différentes clientèles qui bénéficient des largesses publiques, en particulier dans les « banlieues » qui ont voté pour la gauche.
Bien sûr, la gauche prétend que les dépenses publiques vont stimuler la croissance tant attendue et réduire le chômage. Tous les socialistes européens le croient depuis 1848. Les Français espèrent aussi profiter d’un relâchement des disciplines budgétaires avec l’affaiblissement politique de Mme Merkel.
Nous ne sommes plus au temps de Blum, de Keynes ni de Mitterrand
Mais, à la différence de 1936 ou de 1981, nous vivons dans une économie désormais ouverte, sous la surveillance constante des opérateurs financiers. Tout relâchement des efforts budgétaires est interprété en temps réel et provoque la défiance des marchés et se répercute sur la valeur de la monnaie. A peine le gouvernement a-t-il annoncé un relèvement du SMIC que les avertissements de Bruxelles pleuvent sur lui. Un premier avertissement sans frais, avant celui des marchés. Et la croissance se développe en Asie, pas dans la vieille Europe vieillissante et désindustrialisée. Les dépenses publiques n’y changeront rien. Pour retrouver la croissance, il faudrait changer de système. Mais la gauche, ralliée au libre-échangisme, en est incapable.
Le salut par les partenaires sociaux ?
L’autre solution miracle de la gauche consiste à en appeler aux « partenaires sociaux » : Grenelle, le retour IV !
Mais c’est un mauvais remake car les syndicats sont aujourd’hui encore moins crédibles qu’hier. Et les apparatchiks syndicaux, qui arrivent à Matignon dans leurs belles voitures de fonction, déballent déjà leur cortège de revendications catégorielles, toutes moins finançables les unes que les autres.
Si M. Hollande s’en tient à son programme nous aurons donc plus d’impôts, plus de déficits et plus de chômage financé sur fonds publics. Cela ne sera pas vraiment le « changement » pour la classe moyenne ! S’il change de programme, il devra affronter la grogne des camarades syndiqués. Bonjour tristesse !
Jules Ferry le retour
Dépassé aussi le logiciel pédagogique de la gauche : on appelle encore les mânes de Marie Curie et Jules Ferry à la rescousse, comme au bon vieux temps de la communale !
Cela doit sans doute réjouir les vieux militants, mais manifestement d’aucuns n’ont pas vu le terrifiant film Entre les murs, de Laurent Cantet, ou La Journée de la jupe… Car aujourd’hui Marie Curie se ferait violer et Jules Ferry serait traité de céfran raciste par les « jeunes », en classe.
Mais on va recruter de nouveaux « enseignants », revoir l’autonomie des universités (pour leur donner plus de moyens, on suppose) et augmenter l’allocation de rentrée scolaire, comme si de rien n’était. Tout ira certainement pour le mieux dans le Tonneau des danaïdes pédagogiques…
Le retour des bisounours
Dépassé aussi le logiciel sécuritaire de la gauche : on va créer des zones de sécurité prioritaires (avec le succès des ZEP, sans doute…) et, bien sûr, revenir sur la justice des mineurs, jugée trop répressive. La première sortie officielle de Mme Taubira a malheureusement permis à un détenu de prendre la fuite (Le Monde du 23 mai 2012). Tout un programme.
Que dire aussi de la façon dont la gauche approche le défi de l’immigration ?
Le vol du bourdon
Comme un bourdon pris au piège, la gauche se cogne aux fenêtres de la réalité, avant même d’avoir commencé à agir. A peine installés, les jeunes ministres socialistes nous paraissent déjà prématurément vieillis. On a l’impression qu’ils sont là depuis dix ans. Mais c’est sans doute parce qu’ils y étaient sous un autre nom.
Bien sûr, la gauche saura se donner du mouvement, au début, pour faire croire au « changement » : un peu de droits des femmes par ci, un peu de réduction des rémunérations par là, un peu de taxe sur les « riches » aussi, et un zeste de droit de vote des immigrés pour pimenter la sauce médiatique. Mais, pour les vrais miracles, il va falloir attendre un peu plus longtemps !
A peine élu, F. Hollande s’est précipité à Berlin et à Washington. Tout un symbole : le bourdon triste au pays des abeilles. Car c’est là, et non à Paris, que se prennent les vraies décisions de nos jours. Mais en se rendant en Allemagne son avion a été foudroyé. Comment les anciens Grecs auraient-ils interprété ce signe des dieux ?
Michel Geoffroy (Polémia, 31 mai 2012)