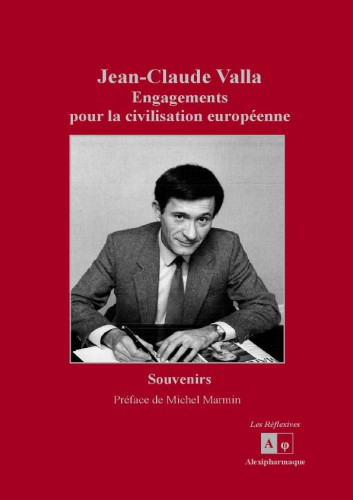Nous reproduisons ci-dessous une analyse de François Bernard Huyghe, cueilli sur son site huyghe.fr et consacré au dossier du magazine Le Point de cette semaine. Quand Franz-Olivier Giesbert (FOG) et ses petits camarades se livrent à une subtile opération de brouillage idéologique...

Le Point découvre un complot néocons
Curieuse stratégie sémantique du Point qui, cette semaine, dénonce sur sa couverture "Les néocons", gens dont on nous révèle qu'ils "détestent" l'Europe, le libéralisme et la mondialisation, qu'ils représentent "le triomphe de l'idéologie du repli" et qu'ils on des "réseaux à gauche et à droite". La photo de la même couverture montre un château de sable, dont la dérisoire fragilité, rassure ceux que le titre aurait affolés et qui songeraient déjà à émigrer avant qu'on n'ouvre des Guantanamo en France.
Des noms ? Outre les inévitables et médiatisés Zemmour ou Polony, sont convoqués au tribunal Chevénement, Marine Le Pen, Montebourg, Guaino, Debray, Buisson, Michéa, Dupont-Aignan, Cochet, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivent sur un arc allant de l'extrême-droite à l'extrême-gauche de l'éventail politique mais à qui le journal prête une triple phobie commune (libéralisme, mondialisation, Bruxelles). Cela les mettrait dangereusement en contradiction avec le sens de l'histoire : leur vrai ancêtre, révèle le Point, est Maginot, constructeur de la ligne du même nom et que symbolisait le château de sable (passons sur le fait que le très modéré général Maginot, ministre de Millerand ou de Tardieu puisse difficilement être considéré comme un ultra-réac en rupture avec les valeurs de son époque).
Par ailleurs, si l'on prend le critère du "contre", pourquoi ne pas intégrer Abdelhakim Dekhar qui a attaqué BFM, Libération et la Société Générale - symboles incontestables de la même trilogie libéralisme, EU, mondialisation - dans la liste ? Ou Besancenot ? Ou les bonnets rouges ?
Cela rappelle un peu l'affaire dite des "nouveaux réactionnaires", un pamphlet ("Le rappel à l'ordre") de D. Lindenberg publié il y a onze ans et qui, d’Alain Finkielkraut à Jacques Julliard, de Philippe Sollers à André Glucksmann, de Michel Houelbeck à Alain Minc, de Luc Ferry à Pascal Bruckner, d'Alain Badiou à P. A. Taguieff, dressait la liste des auteurs coupables du même crime contre l'esprit. Crime dont l'auteur semblait penser qu'il consisterait à trahir leur mission d'intellectuels en prenant fait et cause contre le voile islamique, en s'inquiétant des émeutes de banlieue ou en réclamant de la discipline à l'école.
Bien entendu, les critères de Lindenberg (ne dénonçant que des intellectuels et s'appuyant sur des critères plus "sociétaux" pour définir le crime) ne sont pas ceux du Point, plus droitiers. Les premiers conspirateurs (ceux du "rappel à l'Ordre") sont plutôt des anti bobos se réclamant de la République, les seconds, ceux du Point, sont décrits comme des nuls en économie, frileusement repliés sur la Nation. L'hebdomadaire se place surtout du point de vue d'un supposé réalisme économique, même s''il doit concéder qu'il se trouve aussi des économistes sérieux pour contester les bienfaits de l'euro et du lasser-passer.
Le Point a parfaitement le droit de chanter les bienfaits du libre-échange, de la commission européenne et de la mondialisation heureuse. Et de considérer tous ceux qui pensent autrement comment destinés aux poubelles de l'histoire (mais en ce cas, pourquoi nous peindre leurs rapprochements supposés comme redoutables ?). On peut moins apprécier la technique du "Machin à rencontré Truc qui a voté Chose qui, comme lui, est hostile à l'Otan..". Passons... Si l'hebdomadaire s'était borné à s'en prendre aux souverainistes ou au eurosceptiques, et à leur prêter des niaiseries et des connivences, en titrant "tous nuls en économie", il n'y aurait rien à redire, nous resterions dans le cadre du débat, primaire, mais du débat.
Notre embarras vient l'emploi du terme "néocons" qui a une connotation historique précise : la guerre d'Irak . À l'époque, tout le monde (y compris l'auteur de ses lignes) écrivait sur ces idéologues qui avaient poussé G.W. Bush à renverser le régime de Bagdad (en attendant, espéraient-ils de s'en prendre à la Syrie, à l'Iran). Passons sur le fait que probablement 100% de ceux qu'épingle le Point aient été opposés à cette guerre.
Le problème est que les néocons américains sont des partisans affirmés de la mondialisation et du libre-échange planétaire. Quant à l'U.E. c'est une institution dont ils ne cessent de faire l'éloge, le seul reproche qu'ils aient fait à lui faire étant que certains États européens (qui n'ont pas suivi en Irak) profitent de la protection militaire américaine mais refusent de s'engager dans des conflits qui intéresse le camp des démocraties.
L’essentiel du discours néo-conservateur est un mélange de scepticisme et d’idéalisme. Scepticisme à l'égard du multilatéralisme des concessions, des solutions diplomatiques. Les néocons sont persuadés de l’excellence des principes de liberté incarnés par l’Amérique et, en ce sens, ils ont bien davantage le culte des droits de l’homme que d’autres situées plus à leur gauche. Surtout, ce sont des wilsoniens musclés : ils pensent qu’ils ont le devoir de faire un usage moral du pouvoir militaire pour combattre ce qu'ils appellent les quatre fascismes : nationaliste, nazi, (brun), communiste (rouge) et islamiste (vert). Quand des néocons emploient des formules aussi niaise que «An end to Evil» (il faut mettre fin au mal, titre d’un best-seller de Richard Perle), ils sont moins utopistes qu’optimistes.
Ils croient que les dictatures ne demandent qu’à s’effondrer et les peuples qu’à adopter la démocratie, une fois débarrassés de leurs tyrans. Ils croient que l’adversaire n’est jamais fort que de votre propre faiblesse. Ils croient que l’Histoire leur a donné raison sous Reagan et sous G.W. Bush. Ils croient que l’audace paie toujours et le compromis jamais. Ils croient que leur modèle étant le meilleur tout homme doté de raison et à qui on donne la liberté de l’information et du choix, finira par l’adopter avec reconnaissance.Ils croient qu'il faut affirmer toujours des valeurs universelles démocratiques et lutter contre tous les relativismes.
Ajoutons que les néoconservateurs ont dit du bien de Sarkozy au moment de la Libye, de Hollande au moment du Mali et de Fabius au moment de la négociation avec l'Iran. Tandis que, pour la presse néoconservatrice Chevénement est un paléo-stalinien et Marine Le Pen, une dangereuse chauvine populiste.
À ce compte, en jouant sur le sens du mot "liberal" outre-Atlantique, où il est à peu près équivalent de "gauchiste" ou de "soixante-huitard" chez nous, pourquoi ne pas titre "les néo-libéraux attaquent", pour présenter un numéro sur Christine Taubira, Nicolas Demoran et Cécile Duflot ?François-Bernard Huyghe (huyghe.fr, 29 novembre 2013)