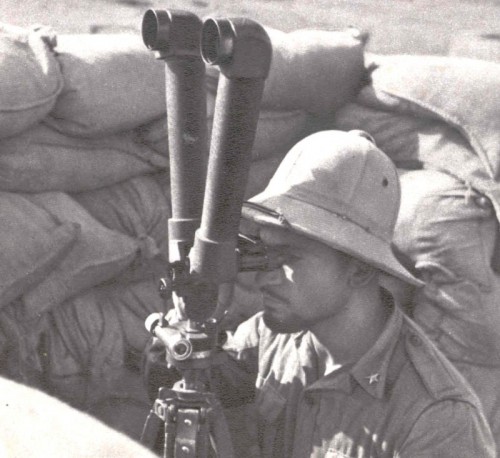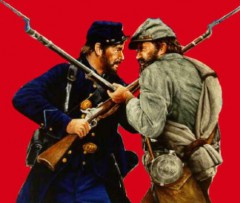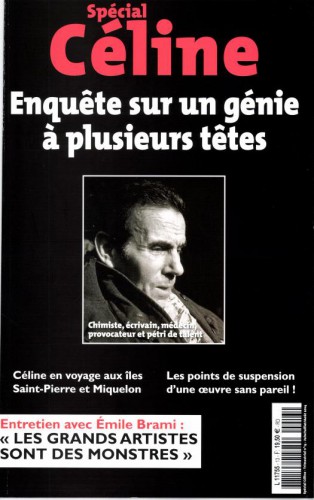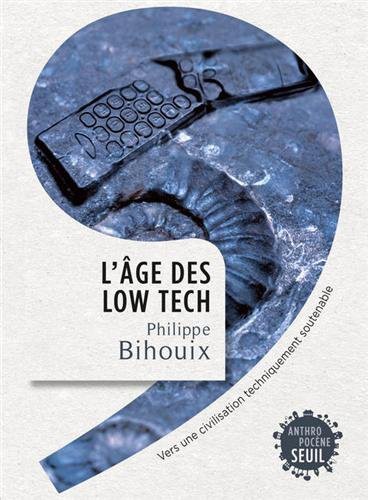Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Alain de Benoist, cueilli sur Boulevard Voltaire et consacré à la victoire de Marine Le Pen et du Front national aux élections européennes...

Marine Le Pen : une victoire qui va au-delà de la gauche et de la droite !
C’est peut-être votre paradoxe personnel. Vous êtes militant européen depuis belle lurette. Mais les mouvements dissidents qui vous lisent avec assiduité sont, eux, souvent enclins à des options plus nationalistes. Comment résoudre cette équation à inconnues multiples, sachant qu’on ne sait pas toujours de quelle Europe on parle ?
Le plus grand reproche qu’on puisse faire à l’Union européenne est d’avoir discrédité l’Europe, alors que les conditions objectives de la nécessité d’une Europe politiquement unie sont plus présentes que jamais. Tout en estimant que le souverainisme ne mène nulle part, parce qu’aucun État isolé n’est en mesure de faire face aux défis planétaires actuels, à commencer par la maîtrise du système financier, je comprends très bien les critiques que les souverainistes adressent à l’Union européenne. Mieux encore, je les partage puisque la souveraineté qu’on enlève aux nations ne se trouve pas reportée au niveau supranational, mais disparaît au contraire dans une sorte de trou noir. Il est tout à fait naturel, dans ces conditions, d’être tenté par un repli sur l’État-nation. Pour moi, cependant, le mot d’ordre n’est pas « Pour la France, contre l’Europe », mais plutôt « Pour l’Europe, contre Bruxelles ».
Que vous inspire l’indéniable victoire du Front national aux récentes élections européennes ?
Elle confirme que les Français n’en peuvent plus de voir, année après année, se succéder des partis de gouvernement qui font la même politique libérale sans jamais tenir leurs promesses ni obtenir de résultats. À tort ou à raison, le FN leur apparaît, dès lors, comme l’ultime espoir. En même temps qu’il marque un tournant historique (mais il faudra attendre les résultats des prochaines élections régionales pour savoir si le FN est vraiment devenu le premier parti de France), le résultat du parti de Marine Le Pen est riche d’enseignements. Il montre d’abord, non seulement que la diabolisation dont il a fait l’objet ne fonctionne plus, car les gens ne croient tout simplement plus à des arguments trop répétés pour conserver encore un sens, mais que cette diabolisation, dont l’objectif était de délégitimer un compétiteur gênant en le transformant en ennemi répulsif et haïssable, a abouti exactement au résultat inverse, à savoir l’installation durable du FN au centre de la vie politique française. Comme l’expliquait ces jours-ci Pierre-André Taguieff dans Le Figaro, à l’occasion de la parution de son excellent livre intitulé Du diable en politique : « La propagande antilepéniste aura globalement joué le rôle d’un puissant facteur de la montée du FN. » Quand on aura compris cela, on aura compris beaucoup.
Cette victoire électorale montre également combien Marine Le Pen a eu raison de résister à ceux qui la poussaient à se positionner de façon préférentielle en parti de la « droite nationale ». Le FN, aujourd’hui, transcende avec bonheur le clivage droite-gauche. C’est chez les jeunes et dans les classes populaires qu’il obtient ses meilleurs scores : aux européennes, 43 % des ouvriers ont voté pour le Front, 8 % seulement pour le PS ! Cette assise populaire montre que le FN a cessé d’être un parti de protestation pour devenir un parti capable d’aspirer au pouvoir – son adversaire prioritaire restant plus que jamais l’UMP.
Dans la foulée, que pensez-vous de la montée en puissance de tous ces mouvements « identitaires » et « eurosceptiques » en Europe ?
Leur dénominateur commun est de toute évidence le populisme. Il ne faut pas se lasser de rappeler que le populisme n’est pas une idéologie, mais un style, et que ce style est compatible avec des orientations très différentes. Il suffit d’ailleurs de comparer le FN avec la Ligue du Nord en Italie, ou le Vlaams Belang en Flandre, pour voir à quel point leurs positions divergent, que ce soit à propos du régionalisme, du programme économique et social ou de la « laïcité ». La montée en puissance des mouvements populistes traduit évidemment le discrédit des partis de la Nouvelle Classe, aujourd’hui totalement coupés du peuple, et la défiance dont ils font l’objet, qui alimente désormais de véritables paniques morales. Elle met aussi en lumière l’incroyable ampleur de la crise de la représentation. Le FN, arrivé en tête du scrutin du 25 mai, ne dispose que de deux ou trois députés à l’Assemblée nationale. L’UKIP, premier parti britannique depuis 1910 à avoir distancé à la fois les conservateurs et les travaillistes, ne dispose pas d’un seul siège au Parlement de Londres ! Et on s’étonne que ça craque ?
À ce stade électoral, que faire de l’Europe ? La redéfinir ? La remettre sur d’autres rails ? En finir avec elle une bonne fois pour toutes ou, tout au contraire, lui redonner une autre vie, en admettant que ce soit encore possible ?
L’Europe est aujourd’hui un grand corps malade, paralysé, bloqué, incapable de définir son identité, prêt à sortir de l’Histoire pour devenir un objet de l’histoire des autres, comme en témoigne son docile consentement à se fondre dans une grande zone de libre-échange atlantique où les normes environnementales, sanitaires et sociales américaines s’imposeraient inéluctablement. Cette Europe-là s’est construite depuis le début en dépit du bon sens, du haut vers le bas, sans tenir compte du principe de subsidiarité, sans se fixer de frontières et sans que les peuples soient jamais associés à sa construction. Elle baigne dans l’angélisme et l’inconscience de soi, elle a fait siens les principes du libéralisme le plus destructeur. La remettre sur ses rails impliquerait qu’elle décide d’être une puissance souveraine avant d’être un marché, et que cette puissance soit capable d’incarner un modèle de culture et de civilisation capable de jouer son rôle dans un monde redevenu multipolaire. On en est loin.
Alain de Benoist, propos recueillis par Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire, 26 mai 2014)