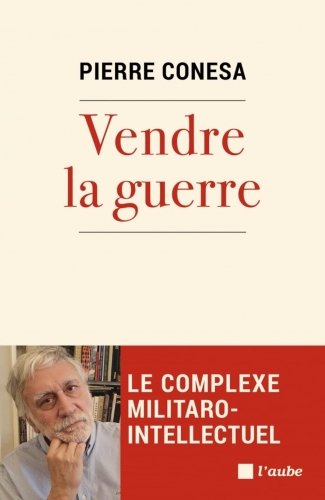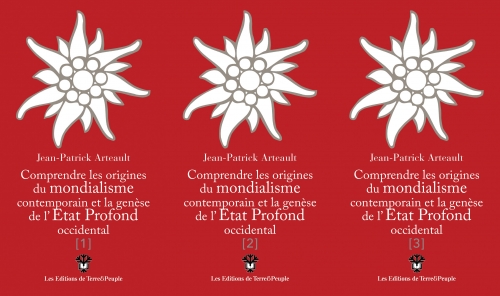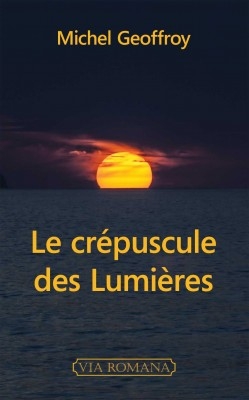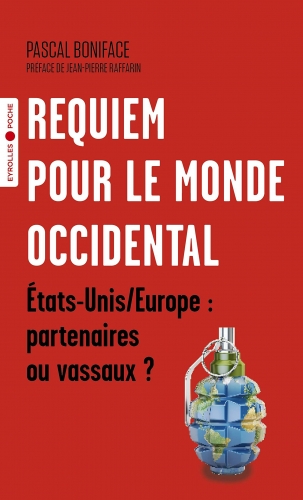Au sommaire cette semaine :
- sur La Voie de l'épée, Michel Goya nous livre une première analyse de la guerre russo-ukrainienne...
L’infanterie, les chars et la guerre en Ukraine (1ère partie - Du design de l'acier)
L’infanterie, les chars et la guerre en Ukraine (2e partie- Routes, bastions et corrosion)
L’infanterie, les chars et la guerre en Ukraine (3e partie-Théorie de la ligne)

- le laboratoire d'idée Fondapol traduit une étude américaine de Lorenzo Vidino sur le développement d'un islamisme qui s'appuie sur le wokisme...
La montée en puissance de l'islamisme woke dans le monde occidental