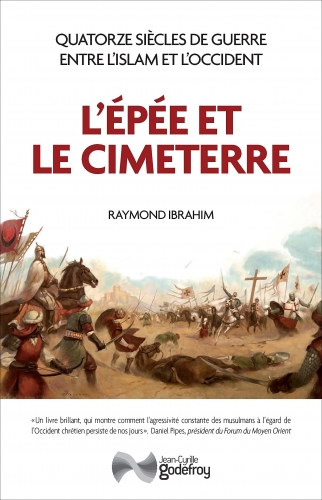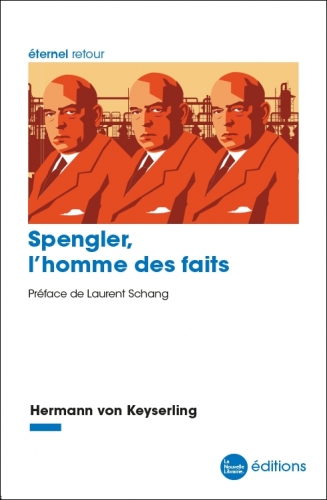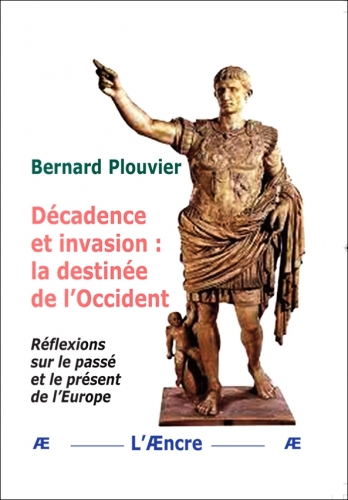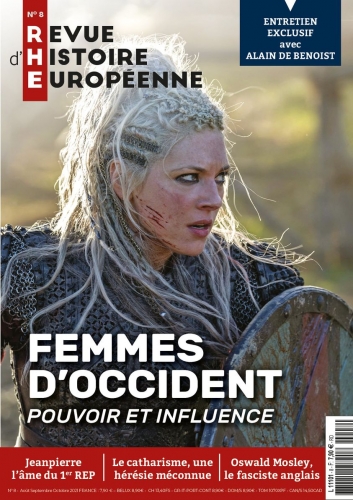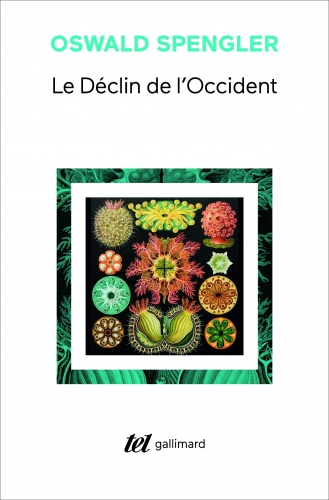Vous pouvez découvrir ci-dessous le nouveau numéro de la Revue d'Histoire Européenne, dirigée par Laurent Berrafato. Ce trimestre le lecteur trouvera un dossier de fond consacré au pouvoir et à l'influence des femmes dans l'histoire de l'Occident, des articles variés et les rubriques régulières : actualités, interview, expositions, mémoire des lieux, portrait, histoire politique, cinéma, l’autopsie d’une bataille, l’histoire dans l’art,…
Il est possible de se procurer la revue en kiosque ou en ligne sur le site de la Librairie du collectionneur.
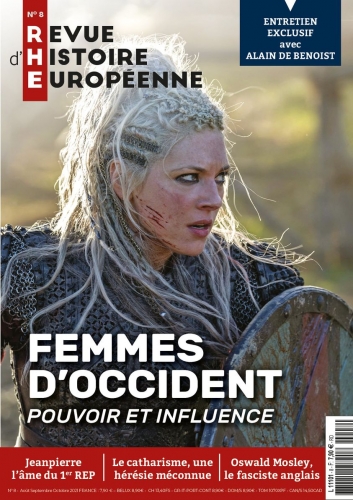
Sommaire :
L'HISTOIRE EN ACTUALITÉ
EXPOSTION
Autour de Napoléon
MÉMOIRE DES LIEUX
Le château de Langeais
PORTRAIT
Le lieutenant-colonel Jeanpierre.
ENTRETIEN
Alain de Benoist
DOSSIER
Femmes d'Occident. Pouvoir et influence (avec des articles de Dominique Venner, Yann Trébaol, Damien Bouet, Jean du Pélem, Jean Thibault, Claude Franc, Diane A. Roger, Christine Delavigne, Olivier Frèrejacques, Adélaïde de la Coume, Paul Villatoux)
1456 : LE SIÈGE DE BELGRADE
La grande défaite de Mehmet II
LES CATHARES
Une hérésie méconnue
1947 : LA RÉVOLTE DE NOÉ
Un camp de l'épuration française
HISTOIRE POLITIQUE
L'Union fasciste britannique
AUTOPSIE D'UNE BATAILLE
6 août 1870 : la bataille de Woerth
UN TABLEAU, UNE HISTOIRE
La mort de César, de Vincenzo Camuccini
L'HISTOIRE AU CINEMA
7 films pour 6 femmes
L'ABOMINABLE HISTOIRE DE FRANCE
Une chronique iconoclaste de notre Histoire