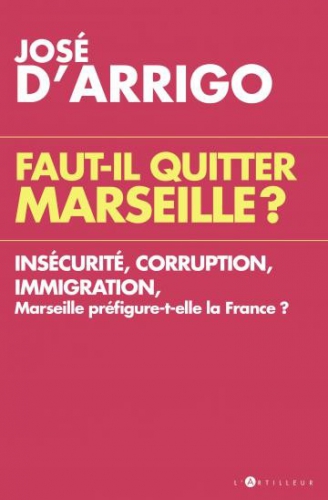Qu'est-ce qu'être Français? La réponse d'un Québécois
Le Français de souche est victime d'un vilain paradoxe: officiellement, il n'existe pas, fondamentalement parce qu'il n'existerait plus. La nation française serait tellement métissée aujourd'hui qu'on ne saurait plus discerner quelque population de souche que ce soit. Il s'agirait d'un fantasme généalogique d'extrême-droite, référant à un âge d'or révolu de l'homogénéité ethnique qui aurait en fait été un enfer. En fait, il se pourrait même qu'il n'ait jamais existé: le métissage serait la véritable loi de l'histoire et d'une époque à l'autre, il aurait imposé ses codes à la France, qui n'existerait qu'au pluriel. Le Français de souche n'aurait même jamais existé, car il n'y aurait jamais eu d'époque d'avant l'immigration de masse.
Et pourtant, de temps en temps, sans avertir, il revient à l'avant-scène, à la manière d'un affreux personnage qui sent très mauvais et qu'on évoque publiquement pour en dire du mal. C'est ce qui lui arrivé il y a quelques jours lorsque François Hollande y a fait référence pour préciser que les barbares qui avaient profané les sépultures dans un cimetière juif n'étaient pas seulement des «jeunes» parmi d'autres, pour reprendre la formule médiatiquement convenu, mais bien des Français de souche -autrement dit, ils n'étaient ni arabes, ni musulmans, et dans ce cas, il était tout à fait pertinent de rappeler leur origine ethnique sans que personne ne hurle à l'amalgame. On peut parler du Français de souche, mais seulement pour dire qu'il est un salaud.
La chose n'est pas nouvelle et dépasse les seules préoccupations sémantiques. Il y a plus de dix ans, on s'en souvient, s'inquiétant de la persistance de l'identité française dans un pays qu'il aurait voulu soumettre au génie de la mondialisation et de la construction européenne, Philippe Sollers s'était permis une tirade contre la France moisie. Il pensait à la France béret-baguette, gouailleuse, enracinée, celle du terroir, qui préfère la souveraineté nationale au fédéralisme européen et qui s'imagine encore qu'il faut posséder quelques rudiments de culture française pour se dire français. Plus récemment, dans le débat sur l'identité nationale qu'il avait enclenché, Nicolas Sarkozy avait dit vouloir du gros rouge qui tache, manière comme une autre de tourner en dérision ce qu'il croyait être les préjugés de la France de souche devant les étrangers.
D'une fois à l'autre, on le verra, c'est la même logique qui se met à l'œuvre: ce qui est spécifiquement français n'existe pas, et si cela existe, c'est très mal et il faut s'en distancier, s'en séparer, s'en débarrasser pour que naisse une nouvelle France post-identitaire, post-historique et post-nationale. Au mieux, ce sera pittoresque, et alors, on transformera cela en décor pour les touristes. Mais il n'est plus possible de se représenter autrement que négativement toute forme de substrat historique spécifique à la France. La poussée à l'indifférenciation qui traverse la mondialisation fait en sorte que ce qui est spécifique à un peuple et ne se laisse pas aisément traduire dans la culture globale des droits de l'homme est connoté négativement de manière automatique.
C'est le paradoxe de l'identité française, en fait, et un semblable raisonnement pourrait s'appliquer aux autres nations occidentales, qui sont aussi soumises à la censure de fer propre à l'idéologie multiculturaliste. On dira que la France qui mérite d'être célébrée se distingue par les valeurs de la République, mais on oublie que ces valeurs, du moins, telles qu'elles se formulent aujourd'hui, ne se distinguent pas fondamentalement des valeurs revendiquées par d'autres nations, comme l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, le Québec ou l'Italie. Autrement dit, la France cherche à se définir par ce qu'elle n'a pas de singulier, et refoule dans des stéréotypes négatifs ce qu'elle pourrait avoir en propre.
Qu'est-ce qui fait que la France n'est pas le Danemark? On ne trouvera pas vraiment la réponse à cette question dans le seul universalisme républicain. D'une manière ou de l'autre, et en parlant ou non du Français de souche, il faudra bien rappeler les droits de l'histoire, ou si on préfère, des cultures historiques, celles qui font que les peuples ne sont pas interchangeables, qu'ils ont chacun une personnalité singulière, qui s'exprime dans l'appropriation des paysages, dans la cuisine (il est amusant de noter que dans Soumission, la jeune Myriam, qui l'a quitté pour Israël, exprime sa nostalgie de la France en parlant des fromages! Quant à lui, Éric Zemmour, dans la tournée de promotion du Suicide français, a donné le même exemple pour parler concrètement de l'identité française), dans la chanson, dans les contes et légendes, autrement dit, dans les mœurs, dans le mode de vie. Bien évidemment, le culte de la république à la française caractérise aussi le particularisme français.
Devenir Français, cela ne consiste pas, alors, à se contenter d'une carte d'identité comme si un pays n'était qu'une association administrative s'ouvrant à n'importe qui s'y installe, mais cela ne saurait exiger non plus le partage d'une généalogie pluri centenaire. Mais cela consiste à s'approprier une culture, à s'en approprier la mémoire, aussi, pour la faire sienne. Cela consiste à envoyer les signaux, nombreux, qui témoignent de mille manières d'une appartenance héritée ou revendiquée à un peuple, à une identité qui a noué ses fils intimes au fil de l'histoire, et qu'il serait bien triste de voir aujourd'hui se dissoudre. Nous ne pourrons pas toujours vivre dans le déni des cultures.
Mathieu Bock-Côté (Figarovox, 3 mars 2015)