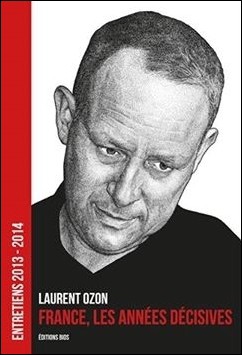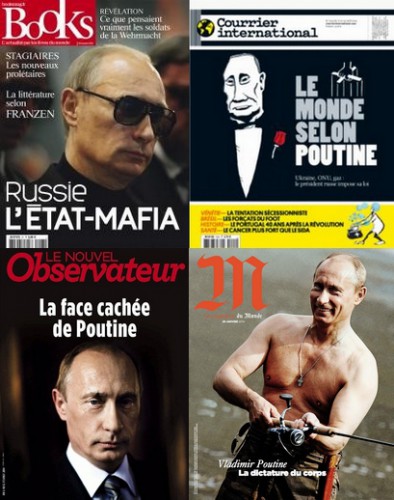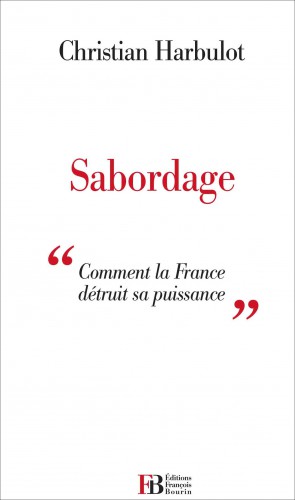Ce qu’on dit et ce qu’on ne dit pas sur le lynchage... Quand la peur pathologique de la stigmatisation vire à l’aveuglement
Atlantico : Alors que les condamnations du lynchage d'un jeune Rom de 16 ans à Pierrefitte sur Seine ont été nombreuses et unanimes, aucune trace de mise en perspective du contexte et de l'environnement dans lequel cette agression a eu lieu. Aucune mention n'est faite du climat de violence qui peut généralement régner dans cette ville de Seine-Saint-Denis. Pourtant les témoignages et faits divers ne manquent pas : gynécologue ou journalistes agressés, tirs de mortiers sur des CRS... Le degré de barbarie de l'acte commis est-il vraiment sans lien avec l'environnement violent dans lequel il a été perpétré ? Un tel acte aurait-il pu avoir lieu dans n'importe quel endroit en France ?
Guylain Chevrier : On se demande de quoi l’on parle effectivement, alors qu’il n’est ici aucunement question de stigmatisation pour expliquer la cause de ce lynchage épouvantable. C’est plutôt l’argument massue qui sert un discours qui soigneusement élude le questionnement sur les véritables causes de ce type d’acte. Des actes d’une violence qui choquent l’opinion en n’ayant plus de limite et marquent de plus en plus les quartiers sensibles de la banlieue. Ce qui vient de se passer est le reflet d’une dégradation abyssale du lien social qui lui, a bien des causes.
On apprend que ce lynchage a été la conséquence d’un cambriolage, commis par le jeune Rom qui en a été victime, dans un appartement d’une cité proche qui aurait concerné l’un des membres d’une bande locale qui aurait vu rouge. On a ici les ingrédients de ce qui en ce moment s’installe dans le paysage de certaines banlieues, selon un mode qui se généralise. On voit se développer une logique de bandes et de communautés, avec une ethnicisation même parfois des quartiers, qui pose déjà potentiellement le risque de ce genre de basculement dans une violence qui n’a pas de limite. Il s’y développe un rejet de l’autre sur le fondement des codes propres à chaque communauté, pouvant à tout moment se traduire par des violences intercommunautaires, ou entre groupes rivaux. Le territoire devient alors un enjeu de rivalité dans l’occupation de l’espace qui n’a plus rien à voir avec la nation mais avec des zones dont des groupes d’intérêts particuliers concurrents prennent, sous une forme ou sous une autre, possession, en se croyant en situation de faire leur loi. Il est évident que certains quartiers, certaines villes et départements sont plus marqués par la concentration de ces phénomènes, qui vont avec ce type de logiciel se définissant entre dégradation sociale profonde, phénomène de bandes et multiculturalisme local.
Une situation que l’on doit pour une part à un échec de l’intégration de trop d’enfants d’immigrés qui n’ont pu trouver leur place dans la société française et en viennent même à en rejeter les valeurs, le modèle, par perte de signification. On joue même trop souvent sur une promotion des communautés qui va avec un repli communautaire que l’on peut penser donner des facilités pour gérer certains phénomènes d’exclusion, et ce, de façon totalement erronée. Cela se retourne vite contre la société en se manifestant par un recul du sentiment d’appartenance et un rejet du pays d’accueil ainsi que de ses lois. On peut même en arriver à une délinquance qui se justifie par le rejet de la loi française pour ceux qui s’identifient à une communauté qui ne la reconnait déjà pas.
Alexandre Baratta : Dans ma pratique d’expert judiciaire portant sur les régions Alsace, Lorraine et parisienne, je suis régulièrement confronté aux affaires de violences de toutes sortes. Dont la fréquence et la cruauté atteint un niveau de banalité déconcertant. Règlements de comptes au pistolet automatique ; home-jacking avec séquestration du locataire du logement pouvant aller jusqu’à la torture et actes de barbarie (crâne défoncé à coups de pelle), agressions gratuites à l’arme blanche dans les transports en commun... Le lynchage du jeune Rom de 16 ans aurait pu survenir n’importe où en France, pour la simple raison que de tels faits surviennent régulièrement partout en France. Souvenons-nous de l’octogénaire de 89 ans séquestrée chez elle à Bar-le-Duc en octobre 2013, battue, puis enfermée dans sa voiture et jetée dans le canal. Souvenons-nous des 3 jeunes ayant séquestré chez lui un vieillard à Montigny-les-Metz avant de le torturer jusqu’à entrainer son décès en avril 2012.
De telles violences se produisent régulièrement en France, sans qu’elles ne connaissent la même couverture médiatique. J’y suis confronté en moyenne deux fois par semaine dans le cadre de mes missions d’expertises judiciaires. Bien entendu, de tels actes de violence sont plus régulièrement observés dans des quartiers à risque, de véritables zones de "non-droit". La Seine Saint Denis en fait partie. Le point commun de ces zones : une grande précarité, le désengagement de l’Etat (grande précarité, absence de politique sanitaire et criminologique efficace).
Il est remarquable de souligner la gradation grandissante des actes de cruauté, chez des délinquants et des criminels de plus en plus jeunes. Il n’est pas rare de voir des adolescents de 14 ans auteurs de violences gratuites particulièrement sordides.
Tarik Yildiz : Il y a un environnement qui est plutôt violent, et ce n’est pas uniquement Pierrefitte. C’est quelque chose qui est assez caractéristique de ce qui se passe aujourd’hui en France. On a de plus en plus de zones qui, par le passé, pouvaient être localisées uniquement dans les cités, et qui maintenant prennent de l’ampleur dans les banlieus des grandes aglomérations (Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, etc) et on a une atmosphère faite de violences, qui peut être de la petite délinquance. Ce sont les vols à l’arrachée, les violences aux personnes, des agressions a répétition. C’est très courant à Pierrefitte, notamment sur la Nationale 1 qui passe à proximité de la cité et quasiment chaque jour il y a des gens qui se font agresser avec leur voiture, avec un bris de glace, et après ils volent des sacs à main. cela arrive quotidiennement. J’ai pu le constater à plusieurs reprises.
Mais pour moi le problème est vraiment global, et ce n’est pas pour minimiser ce qui se passe à Pierrefitte, mais malheureusement ça peut se passer aujourd’hui dans beaucoup d’endroits en France, et de plus en plus. Cela peut arriver dans ce qu’on appelle les "banlieues", c’est-à-dire les banlieues plutôt pauvres des grandes agglomérations françaises. Dans ces endroits je pense que ça peut se passer partout, particulièrement dans les quartiers et les villes difficiles. Il n’empêche que c’est d’autant plus inquiétant que le problème n’est pas borné à une seule zone en particulier et que, au contraire, il est en train de progresser un petit peu partout. Ajoutons que la démission perçue de l’Etat favorise les règlements de comptes en direct.
En avril 2010, un habitant de Pierrefitte sur Seine avait signé sur le site Mediapart un billet de blog dénonçant les œillères des élus sur la progression de la violence dans les cités difficiles. Peut-on parler d'un aveuglement collectif sur cette question ? Par peur de stigmatiser certaines populations, en vient-on à refuser de regarder en face leur réalité, au détriment finalement des plus faibles d'entre eux ?
Guylain Chevrier : On laisse les choses se dégrader actuellement en envoyant comme seul message de ne pas stigmatiser les populations en question sous prétexte de victimisation. On le fait, de plus, sous le signe d’un recul constant des sanctions face à des actes graves, parlant de substituer systématiquement à la prison des peines alternatives qui maintiennent les individus en cause dans leur milieu ordinaire aménagées de quelques contraintes, comme le prévoit en le généralisant la réforme pénale de la garde des Sceaux, Mme Taubira. Ainsi, quel message délivre-t-on ? "Allez-y, continuez !", parce que l’on ne veut pas ou l’on n’est pas en situation de leur dire, "arrêtez !", on va vous proposer autre choses, une société qui vous permette de trouver votre place, mais avec des exigences et des obligations qui soient les mêmes pour tous.
Le discours laxiste actuel en matière de répression des délits a à voir avec une perte de considération pour ceux dont les conditions sociales les exposent plus que les autres au risque de la délinquance. Ce contexte est comme une invitation à un piège qui se referme sur eux. Il faut en réalité changer complètement de philosophie en se ré-intéressant à ce qui fait le bien commun, dont le respect de la loi égale pour tous est une dimension essentielle.
Les mineurs aujourd’hui sont, lorsqu’ils commettent des actes de délinquance, trop souvent confrontés à une absence de réponse rapide et proportionnée, capable de leur faire prendre conscience de la responsabilité de leurs actes. Les réponses prennent de longs mois avec des sanctions qui ont souvent peu de signification dans la façon dont elles sont mises en œuvre, tels les "travaux d’intérêt général", les fameux TIG. Aussi, ce manque de réponse est bien connu des jeunes, un phénomène qui se collectivise sous la forme d’un laisser-faire qui est pris pour un laissez-passer aux lourdes conséquences, car les premières victimes de ce laxisme sont les jeunes en risque de délinquance eux-mêmes, et leurs futures victimes.
Alexandre Baratta : En effet, la France se caractérise par une peur de la stigmatisation. Il s’agit même d’un leitmotiv particulièrement prégnant : "il ne faut pas stigmatiser…". Un discours similaire est retrouvé dans le cas de la schizophrénie : il est de bon ton d’affirmer que les personnes souffrant de schizophrénie ne sont pas plus dangereuses que les autres, et qu’il ne faut pas les stigmatiser. C’est faire fi des données criminologiques : la schizophrénie multiplie le risque de violence par deux ; risque multiplié par neuf si elle s’associe à la consommation de stupéfiants.
Le même déni de réalité se retrouve face aux phénomènes de violences dans les zones urbaines dites à risques.
Tarik Yildiz : je pense qu’il y a surtout un aveuglement des élites au sens large. Il s’agit d’une certaine caste politico-médiatique. En revanche, les gens sur le terrain, quand on les interroge, ne sont pas dupes du tout et d’ailleurs les habitants de ces villes-là sont les premiers à se plaindre et à faire remonter des choses, que ce soit à la mairie, au commissariat ou ailleurs. Au quotidien, quand on discute avec les uns et les autres, et même dans les enquêtes d’opinion, on se rend compte que les préoccupations majeures des gens, ce sont des questions liées à la petite délinquance et à la sécurité en général. C’est donc quelque chose de très ancré dans la population, qui est devenu un sujet majeur. En revanche, cela ne se traduit jamais par des actes au niveau politique d’une part, et dans le traitement médiatique de l’autre. Je crois que c’est dramatique parce que, étant donné qu’on ne pose pas le constat de façon sereine, on n'arrive pas à répondre aux problématiques, et c’est ce qu’il y a de plus dangereux.
Cette situation existe forcément au détriment des plus faibles. les premiers concernés, ce ne sont pas les gens qui vivent dans les beaux quartiers, les gens qui ont une vie confortable. Ce sont tous les autres, c'est-à-dire une grande majorité des Français. Ensuite, il peut y avoir en arrière-plan la peur de stigmatiser certaines populations, mais c’est une culture politique qui s’est un peu installée en France, qui fait qu’on est toujours très frileux avec ces questions. D’une part, parce que tous ceux qui véhiculent cette culture ne vivent pas cela au quotidien. On s’aperçoit que parmi les sociologues, parfois les responsables associatifs, l’élite politique, la presse , etc.
Ces gens qui véhiculent ces craintes ne vivent pas au jour le jour dans ces quartiers-là. Ils sont loin de cette réalité. Du coup, parfois ils sont de bonne foi et pensent que ceux qui utilisent ces questions-là le font avec de mauvaises intentions, parfois pour imposer une théologie. On n'arrive pas à avoir un débat serein en se disant qu’il y a de vraies préoccupations, majeures, et qu’il faut écouter les gens. Il y a effectivement d’autres craintes. Traditionnellement en France, on fait des liens entre la condition sociale et les actes de délinquance. C'est une conception un peu marxiste consistant à dire que si on a des problèmes c’est parce qu’on est pauvre, ce qui peut parfois se défendre, mais c’est devenu systématique dans la culture politique française.
Quel prix payons-nous pour cet aveuglement ? Comment est-il instrumentalisé par ceux qui, dans ces territoires, ont intérêt au maintien de zones de non droit ?
Guylain Chevrier : Les peines-plancher ont été supprimées, ainsi que les tribunaux correctionnels pour adolescents de 16 à 18 ans, la garde des Sceaux en appelle même à moins de répression encore. Mais qu’a-t-il été mis à la place, rien ! Le précédent président de la République avait supprimé ses moyens d’agir à la Protection judiciaire de la jeunesse, la majorité actuelle qui gouverne n’a pas réinvesti de moyens dans ce domaine. Si l’on veut garantir le primat de l’éducatif sur le répressif, il faut s’en donner les moyens et penser leur utilisation de telle façon que cela n’apparaisse pas comme un simple pis-aller, mais bien comme une politique de lutte contre la délinquance des mineurs. Il faut une politique d’action éducative qui soit à la mesure des enjeux, ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui ! Que ce soit du côté des moyens ou du projet, on en reste à une idéologie d’accompagnement de la situation qui fait des délinquants d’abord des victimes des dysfonctionnements sociaux, dont l’argument atteint aussi ses limites, et ne saurait amener à faire l’économie de réponses cohérentes qui rappellent à la loi.
Nous sommes tout simplement en plein laxisme et désengagement de l’Etat de l’une de ses missions essentielles, la justice, ce qui conduit à ne plus respecter non seulement l’Etat mais par voie de conséquence la société, les autres. Lorsqu’on se fait respecter, on inspire le respect, on en fait une valeur collective de référence attractive. Ces jeunes des banlieues le savent bien, pour lesquels l’usage en est fait à coups de rapports de forces, à défaut que la société leur délivre un autre message.
"L'excuse de minorité" - le principe selon lequel les peines applicables aux mineurs sont plus faibles, pour les mêmes faits, que celles visant les adultes - doit être maintenue. Mais aller uniquement dans ce sens pour ne pas sanctionner, lorsque l’on a affaire à des multirécidivistes, c’est tout simplement encourager la généralisation de ces faits pour des milliers de jeunes. C’est l’encouragement d’un modèle inspiré de ceux qui en ont déjà franchi le pas, à ne pas avoir eu à temps les réponses appropriées leur faisant percevoir l’intérêt de la loi, sa valeur de protection pour tous, le bien commun précieux qu’elle représente en dehors duquel aucune vie sociale n’est viable. C’est tout simplement la garantie des libertés individuelles et de la démocratie dont cet enjeu résonne.
Alexandre Baratta : Le prix à payer est lourd, avec absence de politique de répression adaptée ; ainsi qu’une politique de prévention inadaptée (suivis addictologiques mis en échec avec les agressions des médecins par exemple). Nous précisons à ce sujet qu’en matière de criminologie, la France a un retard considérable par rapport à ses voisins européens et autres pays anglo-saxons.
Les principales victimes sont les habitants de ces zones. Mais ne nous y trompons pas : ces zones urbaines sensibles ne doivent pas nous faire oublier que de nombreuses violences se produisent chaque jour sur le territoire ; avec une augmentation galopante de leur fréquence et de leur gravité.
Pour s’en rendre compte, il suffit de vérifier le nombre d’agressions des personnels soignants dans les urgences de zones non étiquetées comme sensibles. Ces agressions, pouvant être graves, sont quotidiennes, et tendent à se banaliser.
Tarik Yildiz : Etant donné que l’on ne pose pas le constat, on n'apporte pas les solutions adéquates. on ne prend pas le problème à bras le corps. On ne veut pas voir qu’il y a une certaine jeunesse qui est en manque d’autorité, qui veut des limites, où il y a besoin parfois de sanctions, de règles , de sanctions qui fixent une sorte d’ordre dans la société. C’est un grand problème parce que ces jeunes-là percoivent l’état en général comme étant mou. Dans ces âges et ces conditions-là, les jeunes testent les limites et ils vont de plus en plus loin dans la petite délinquance, et puis quand ils sont condamnés pour la quinzième fois ils font un petit passage en prison mais c’est presque considéré comme quelque chose de valorisant, parfois. C’est une culture qui s’est installée, et étant donné qu’on n'a pas posé le bon constat au départ, on n'arrive pas à trouver des réponses qui soient vraiment adéquates. Cela amène à des problématiques assez graves. C’est pour cela que ce qui s’est passé à Pierrefitte peut se passer autre part, dans le même contexte, et cela est voué à progresser.
La force publique est accusée de démission. En quoi cette démission est-elle la conséquence de cet aveuglement ? Refuse-t-on de se donner les moyens de lutter ?
Guylain Chevrier : La police ne peut jouer son rôle et être elle-même respectée, qu’à la condition de représenter une société qui se fait respecter et qui en même temps délivre un message de respect. Est-ce bien la meilleure façon de respecter ces jeunes que d’organiser ce laxisme, n’est-ce pas leur dire ainsi qu’ils ne valent finalement rien à nos yeux si on les laisse faire et s’enfoncer dans la délinquance au lieu de leur dire fermement et avec bienveillance "arrêtez" ! ? Dire non, c’est envoyer ce message qu’ils ont de la valeur aux yeux de la société et qu’elle tient à eux, et refuse de les laisser toucher le fond.
Il faut évidemment aussi se donner les moyens de l’accompagnement éducatif et social de ces jeunes et de leurs familles. Faut-il encore ne pas non plus favoriser le regroupement de populations socialement sinistrées, sous prétexte de conditions sélectives d’accès au logement social qui conduisent à une homogénéisation et à l’enfermement, à la ghettoïsation, au lieu de la mixité sociale qui est un facteur essentiel de la cohésion sociale, en favorisant cet équilibre du vivre ensemble qui s’y nourrit.
Alexandre Baratta : Lorsque la force publique est incapable d’assurer la protection de ses propres agents (contrôleurs de train agressés ; pompiers caillassés ; véritables embuscades organisées contre des patrouilles de police) ; comment serait-elle en mesure d’assurer la protection du citoyen lambda ? Surtout lorsque celui-ci vit dans une zone urbaine gangrenée par une économie parallèle basée sur le trafic de stupéfiants ? Mais la priorité est ailleurs, parce qu’il ne faut surtout pas stigmatiser, toujours le même leitmotiv récité tel un mantra.
Tarik Yildiz : Il y a une démission qui n’est pas assumée dans la mesure où il y a des problèmes très graves de délinquance qui se passent un peu partout en France, et cela ne date pas d’hier. tous les gouvernements y ont participé. C’est un problème très profond, et en réponse, on a de temps en temps des acteurs associatifs qui sont complètement à côté de la plaque parce que la jeunesse face à eux a besoin de repères, de choses fixes et d’ordre, et c’est dans ce sens qu’on ne veut pas évoluer. Si on a peur de donner une sanction très rapidement de manière efficace, c’est un problème. En fait, c’est toute la chaîne qui est à revoir, donc il faut un minimum de courage pour le mettre en place.
Il y a certes l’aspect policier au départ - ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu’ils ont -, et ensuite il y a le passage devant la justice, qui est long et fastidieux. Ensuite, à la première ou à la deuxième condamantion, cela ne se traduit pas forcément par une peine de prison, et puis les juges préfèrent ne pas envoyer ces jeunes en prison parce qu’ils considèrent, à juste titre, que quand ils vont en prison ils ressortent pires que lorsqu’ils sont rentrés. C'est l'effet "école du crime", quand ils vont en prison ils se radicalisent en devenant parfois des extrémistes islamistes, et certains s’en sortent en ayant appris d’autres techniques de cambriolage, etc.
C’est toute la chaîne qui est à revoir. Il faudrait, par exemple, construire de nouvelles places de prison pour que les conditions soient décentes et qu’il n’y ait plus d’école du crime. Il faudrait apporter une réponse juste et très rapide de la justice au premier acte de délinquance. C’est très important. Et donner plus de moyens d’agir. C’est toujours la même chose, mais tant qu’on n'ira pas dans ce sens-là, avec des réformes, eh bien malheureusement on ne pourra pas avancer sur ce dossier-là et on ne pourra pas s’en sortir.
Cet aveuglement ne se limite pas aux causes de la violence. Comment se manifeste-t-il dans les domaines de l'échec scolaire ? Avec quelles conséquences ?
Guylain Chevrier : L’échec scolaire est lié à un manque évident de perspective mais aussi à ce laxisme devant l’exigence du respect de la loi, qui incite à son contournement et à la facilité du décrochage à la faveur des phénomènes de bandes. La baisse des exigences scolaires sous prétexte d’intégrer tout le monde, comme si tout tirer vers le bas allait le permettre, est un autre aspect de la dévalorisation de l’école. Le recul progressif de la culture générale et de l’histoire en nombre d’heures allouées, dans les programmes scolaires, est de ce point de vue significatif. La volonté d’intégrer la diversité des populations jusqu’à en abaisser les exigences, tout en développant des programmes où on encourage l’enseignement des religions et des cultures d’origines, est-elle bien la bonne voie ?
L’enseignement des valeurs de la république devrait être pris bien plus au sérieux à condition qu’on leur donne le sens d’une réussite pour tous qui implique l’effort, l’élévation de soi et donc l‘estime de soi. Nous verrons de ce point de vue les résultats de ce qu’a mis en place le précédent ministre de l’éducation nationale, Vincent Peillon, autour de la Charte de la laïcité à l’école, qui n’est pas à négliger. La décision de l’actuel ministre de l’éducation Benoît Hamon, de laisser à l’appréciation des établissements scolaires au cas par cas l’accompagnement des sorties scolaires par des mères voilées, contre le sens de la mission laïque de l’école qu’elle s’exerce à l’intérieur de ses murs ou à l’extérieur, est un très mauvais signe quant au respect de ces valeurs et particulièrement de notre République laïque. C’est un signe qui va à l’inverse de l‘intégration et des valeurs qui devraient la porter. C’est aussi encourager le malentendu entre les populations de quartiers marquées socialement ou/et par la diversité culturelle et le reste de la population française, avec tous les dangers de rupture que cela constitue, y compris sur le plan du décrochage politique et de la promotion des extrêmes.
Tarik Yildiz : Sur le volet éducation, il y a moins de conséquences à court terme, davantage à long terme. On a créé une génération qui arrivait à faire des études, sans aller très loin, mais il y aussi toute une partie de la population qui décroche complètement du système scolaire, et c’est parfois les mêmes personnes que l’on retrouve dans la délinquance. Et puis, même quand il y a un certain niveau, celui des collèges, et des lycées dans une moindre mesure dans ces zones là, cela pose un gros problème. Les différences de niveaux sont extrémement fortes et notables, l’écart n’était pas aussi important il y a encore 20 ans. Aujourd’hui il existe donc une France à plusieurs niveaux avec des gens qui vont avoir une autre culture, d’autres codes, avec une culture "au rabais", où on va essayer d’adapter la connaissance en fonction des gens que l’on a en face de soi, et cela a des conséquences désastreuses. Cela se voit particulièrement dans les collèges, où violence plus échec scolaire donnent des résultats très inquiétants.
Et en matière d'échec de l'intégration, de chômage, de lutte contre la pauvreté ?
Guylain Chevrier : La lutte contre les exclusions passe par plus d’intégration sociale, dont la condition est la réduction des inégalités, alors que celles-ci ne font que se creuser. Pour lutter correctement contre l’exclusion sociale il faut aussi avoir un projet de société qui se tienne et réponde aux grands besoins sociaux et permette, au-delà de la grande cause économique, à chacun de trouver à se réaliser, à se sentir de la valeur, que la société s’intéresse à tous.
Pour autant, la question économique n’est pas la seule en jeu. C’est pour cela qu’il faut rejeter la tendance à vouloir en passer aujourd’hui par la logique de "l’inclusion sociale", qui considère l’intégration économique comme une fin en soi jusqu’à utiliser pour cela le relai communautaire, en oubliant les valeurs qui conditionnent de se sentir appartenir à une même société. La notion d’intégration sociale a une portée plus large qui implique l’accession à un corpus de valeurs communes dans lesquelles tous se reconnaissent, car aucune société ne peut être une simple addition de différences.
C’est aussi un signe fort à envoyer à la diversité des populations qui vivent sur le territoire commun. Il y a danger à encourager le repli communautaire à travers un clientélisme politique qui joue sur les revendications identitaires comme mise en jeu de l’influence électorale. Cela pousse dans le sens de la division du corps social et politique, qui provoque des ruptures qui elles aussi ont leurs conséquences sur la montée de la violence dans les quartiers. Il en va avec cela tout particulièrement de la cohésion sociale, c’est-à-dire du degré de la reconnaissance qui est celui des citoyens dans leurs institutions, dans notre République, sa promesse d’égalité et de solidarité sociale.
Alexandre Baratta : L’échec scolaire, tout comme le chômage sont des avatars des phénomènes de violences grandissants. Nous savons depuis fort longtemps qu’une désinsertion socio-professionnelle, l’absence de qualification diplômante sont des facteurs de risque de délinquance. Il s’agit donc de leviers d’actions efficaces dans une politique de lutte contre la délinquance, au même titre que les sanctions pénales de type répressif.
Le problème des zones urbaines sensibles provient des économies parallèles. L’un des exemples est cet auteur d’homicide récemment examiné en expertise. Déscolarisé à 16 ans, il a débuté une carrière de dealer en vendant du cannabis. Avec un bénéfice mensuel de 3000 euros, nets d’impôts. Il n’a jamais travaillé de sa vie. Lever entre 10h et 11h, son activité commerciale est effectuée l’après-midi ; pour ensuite consacrer la soirée à des sorties festives jusque tard dans la nuit. Aujourd’hui âgé de 34 ans, comment lui proposer une insertion sociale cohérente avec un projet professionnel incertain, nécessitant plus d’efforts pour un salaire divisé par 3 ? En passant par une lutte contre cette économie parallèle, omniprésente dans les banlieues. Mais attention : la pauvreté n’est pas l’une des causes de la violence : elle en est davantage la conséquence.
Tarik Yildiz : L’échec de l’intégration est très lié à l’éducation et à la violence. Je suis persuadé que si on règle ces deux questions en montrant un Etat fort sur ces deux volets-là, on aura gagné le pari de l’intégration. Pour le chômage je ne pense pas que ce soit l’Etat qui décrète de le supprimer. Ce sont des choses qui sont autrement plus complexes. Il y a des taux de chômage qui sont très importants dans d’autres zones en France, notamment dans certaines zones rurales. C’est un problème plus général et il y a des moyens qui sont mis à disposition pour aider l’emploi dans les ZUS, etc. Le chômage est un levier commun à un ensemble de la société. Faire des politiques différenciées vis-à-vis de ces populations, c’est un échec en soi.
Guylain Chevrier, Alexandre Baratta et Tarik Yildiz (Atlantico, 18 juin 2014)