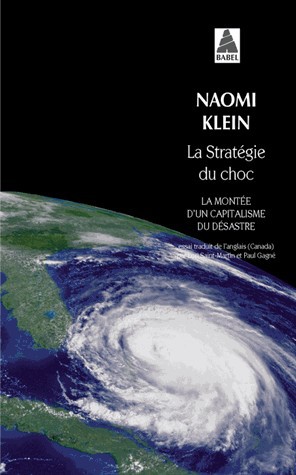“Si la Russie s’éloigne de l’Occident ce sera de la faute de l’Occident américain”
Aymeric Chauprade bonjour, pourriez-vous vous présenter aux lecteurs de RIA-Novosti qui ne vous connaîtraient pas ?
Je suis géopolitologue. Une formation scientifique d’abord (mathématiques) puis de sciences politiques (docteur) et dix années titulaire de la Chaire de géopolitique de l’Ecole de Guerre à Paris, entre 1999 et 2009. J’ai aussi enseigné la géopolitique et l’histoire des idées politiques en France à la Sorbonne et en Suisse à l’Université de Neuchâtel.
Je suis maintenant également consultant international et très heureux de travailler de plus en plus avec la Russie. Mais je suis également souvent en Amérique Latine et j’ai des réseaux africains développés.
Vous êtes considéré comme l’un des fondateurs de la nouvelle géopolitique française, pluridisciplinaire, attentive à décrire le « continu et le discontinu » dans l’analyse des questions internationales, pourriez vous expliquer aux lecteurs de RIA-Novosti ce qu’il en est exactement ?
Je me rattache au courant dit réaliste qui tient compte de la force des facteurs de la géographie physique, identitaire et des ressources, dans l’analyse des relations internationales. Mais pour autant, je ne néglige pas les facteurs idéologiques. Ils viennent en combinaison des facteurs classiques de la géopolitique que j’évoquais à l’instant à savoir les déterminants liés à l’espace, aux hommes dans leur identité culturelle (ethnie, religion…), et à la quête des ressources. J’insiste sur la multicausalité (il n’y a pas de cause unique mais chaque situation est la combinaison unique, un peu comme l’ADN d’une personne, d’une multiplicité de facteurs déterminants) et sur la multidisciplinarité (je refuse l’idée que ma matière, la géopolitique, puisse rendre compte à elle seule de la complexité de l’histoire ; attention au “tout géopolitique”, au “tout économique” ou “tout sociologique”). La tentation de tout expliquer par sa discipline, comme le font beaucoup les sociologues aujourd’hui, est une dérive née de l’hyperspécialisation qui nous éloigne de l’époque des savants généralistes, ces savants du XVIe siècle qui étaient à la fois philosophes, mathématiciens et souvent hommes de lettres!
Quant au “continu et au discontinu” c’est ce souci qui me vient de ma première formation scientifique de séparer la dimension continue et même parfois linéaire des phénomènes, de leur dimension discontinue et parfois erratique. Il faut savoir suivre les courbes des facteurs de temps long (la démographie par exemple) mais il faut aussi savoir lire les discontinuités, les sauts, de l’Histoire.
Vous avez le mois dernier été invité au prestigieux Forum Valdaï, cofondé par RIA-Novosti. Pourriez-vous nous faire part de vos impressions sur ce forum ?
D’abord j’ai été très honoré de figurer parmi les nouveaux invités du Forum de Valdaï. Ce fut une expérience véritablement passionnante. Les débats sont de qualité, l’organisation rigoureuse. C’est une sorte de Davos russe mais avec une différence notable : il n’y a pas de pensée unique mondialiste unanimement partagée. Des sensibilités différentes sont représentées. Si l’on voulait simplifier d’un côté, les Occidentalistes qui, Russes ou Occidentaux, célèbrent le “modèle démocratique occidental”, essentiellement américain et considèrent que celui-ci doit être l’horizon vers lequel doit tendre la société russe, et de l’autre côté, les partisans d’un modèle original russe, dont je fais partie, bien que n’étant pas russe, qui considèrent que la Russie n’est pas seulement une nation, mais une civilisation, dont la profondeur historique est telle qu’elle permet de proposer aux Russes un modèle original. A Valdai, j’ai beaucoup entendu les Occidentalistes se lamenter du fait que la Russie était encore loin des standards occidentaux, à cause d’un prétendu déficit démocratique et d’une forte corruption. Je n’idéalise pas la Russie sous Poutine qui travaille d’arrache-pied au redressement de ce pays depuis 13 ans ; j’en mesure les maux mais je dis simplement que lorsque l’on parle de corruption il faudrait premièrement rappeler que les indicateurs de mesure sont faits pour l’essentiel par les Occidentaux, et les Américains en particulier, ce qui n’est pas une assurance d’objectivité, et deuxièmement s’intéresser non seulement à la corruption de l’Occident lui-même mais à son fort pouvoir corrupteur dans les pays en voie de développement!
Par ailleurs je considère que si la Russie court derrière le modèle occidental, elle sera toujours en retard. Bien au contraire, un pays qui a su pousser si loin la création artistique et scientifique, me paraît plus que capable de proposer un contre-modèle, lequel ne devra pas être fondé sur la toute puissance de l’individualisme, mais au contraire sur l’âme russe, sur la dimension spirituelle de ce pays. Il faut faire attention à une chose : le communisme, comme rouleau compresseur de l’esprit critique et de la dimension spirituelle de l’homme, a été un préparateur redoutable pour le projet de marchandisation de l’homme que propose l’individualisme américain.
Je suis convaincu que le retour à la Sainte Russie, au contraire, peut être un formidable réveil du génie créateur russe, qui seul lui permettra de reconstruire, au-delà des hydrocarbures et d’autres secteurs, une économie performante et innovatrice.
La question de l’identité a été extrêmement discutée et le président russe a utilisé une rhétorique eurasiatique pour parler de l’Etat Civilisation russe, pensez vous comme certains que le réveil russe l’éloigne de l’Occident, et donc de l’Europe, et devrait intensifier son rapprochement avec la Chine?
Si la Russie s’éloigne de l’Occident ce sera de la faute de l’Occident américain. La Russie est en effet diabolisée dans les médias américains dominants et par conséquent dans les médias européens qui s’en inspirent. Cette diabolisation est injuste, c’est de la mauvaise foi qui vise à présenter le redressement russe comme agressif alors que celui-ci cherche à consolider sa souveraineté face à l’impérialisme américain qui fait glisser les frontières de l’OTAN aux frontières de la Russie et de la Chine.
La Russie développe ses relations avec la Chine, dans le cadre notamment du groupe de Shangaï et aussi parce que les Chinois ont compris que les Russes pouvaient être des partenaires solides dans un monde multipolaire. De fait, ces deux puissances partagent la même vision de l’organisation du monde : elles respectent la souveraineté des Etats, refusent l’ingérence chez les autres, veulent l’équilibre des puissances comme garantie de la paix mondiale. Toutes deux s’opposent au projet unipolaire américain qui, il suffit de le constater, a déclenché une succession de guerres depuis l’effondrement soviétique : Irak, Yougoslavie, Afghanistan, Libye, Syrie maintenant… Où avez-vous vu les Russes dans toutes ces guerres?
Je pense que la Russie ne veut pas se contenter d’un partenariat avec la Chine. Certes la Russie est une puissance eurasiatique, mais il suffit de s’intéresser à son histoire, à son patrimoine culturel, pour voir qu’elle est une puissance profondément européenne et qu’elle n’entend pas se couper de l’Europe. Si les Européens se libéraient de leur dépendance à l’égard des Etats-Unis tout pourrait changer et un fort partenariat stratégique pourrait se nouer entre l’Europe et la Russie.
Vous aviez lancé le 13 juin dernier un « Appel de Moscou », quel regard global portez vous sur la Russie d’aujourd’hui?
D’abord j’essaie de ne pas idéaliser la Russie même si je ne vous cache pas que je me sens extrêmement bien dans ce pays, parce que le matérialisme m’y paraît sans cesse équilibré par une sorte de profondeur d’âme insondable. Je pense que quelque chose est en train de se passer dans la Russie de Poutine et j’espère seulement que le Président Poutine pense à la manière de perpétuer son héritage, car la pire chose qui pourrait arriver ce serait le retour des occidentalistes de l’ère Eltsine, qui prennent la Russie pour un pays du Tiers monde qu’il faudrait mettre aux normes occidentales. L’appel de Moscou que j’ai lancé poursuivait deux buts: d’abord montrer mon soutien au refus russe du programme nihiliste venu d’Occident (mariage homosexuel, théorie du genre, marchandisation du corps), ensuite montrer aux Français qui défendent la famille et les valeurs naturelles que la Russie peut être une alliée précieuse dans ce combat. Je suis très surpris et heureux de constater à quel point mon appel de Moscou lancé à la Douma le 13 juin 2013 a circulé en France dans les milieux catholiques qui se sont mobilisés contre le mariage homosexuel.
Le souverainisme est à vos yeux une notion clef de l’équilibre mondial. Très curieusement ce concept est abandonné en Europe alors qu’en Russie et dans nombre de pays émergents l’affirmation et le maintien de la souveraineté semble au contraire un objectif essentiel. Comment expliquez-vous cette différence d’orientation?
La souveraineté est une évidence pour tous les peuples du monde, et en particulier pour ceux qui ont pris leur indépendance récemment ou qui aspirent à créer un Etat indépendant. Les Européens de l’Ouest, ou plutôt leur fausses élites gouvernantes, sont les seules du monde à avoir abdiqué la souveraineté de leurs peuples. C’est une trahison dont elles devront répondre devant l’Histoire. Des millions de Français ont péri à travers l’Histoire pour défendre la liberté et la souveraineté du peuple français, sous les monarques comme en République. Mon nom est inscrit sur les monuments aux morts français. Si les Français voulaient s’en souvenir, il n’est pas une famille française qui n’ait son nom inscrit sur ces monuments aux morts, de la Première, de la Deuxième ou des guerres de défense de l’Empire français.
Imaginez-vous un Américain ou un Russe abdiquer sa souveraineté? Pour eux le patriotisme est une évidence, qui va d’ailleurs tellement de soi que tout parti affirmant un programme nationaliste en Russie est perçu comme extrémiste parce qu’il n’y a nul besoin là-bas d’affirmer l’évidence. Nos amis russes doivent comprendre en revanche qu’en France ce n’est plus l’évidence et par conséquent qu’il est normal qu’un parti politique qui veut rendre au peuple la souveraineté, mette celle-ci au sommet de son programme!
Aujourd’hui nous assistons à une relative rapide modification des relations internationales, avec le basculement du monde vers l’Asie et la potentielle fin du monde unipolaire. Comment envisagez vous que cette transition puisse se passer?
Ce que je vois c’est que les Etats-Unis refusent de perdre leur premier rang mondial et peuvent créer de grands désordres, peut-être même des guerres de grande ampleur, dans les décennies à venir, et que les Européens, quant à eux, sont dans la gesticulation kantienne, la proclamation de belles leçons de morale qui s’accompagnent d’un déclin en puissance dramatique et donc pathétique.
Au sein de cet basculement, la France semble quant à elle pourtant de plus en plus aligner sa politique étrangère sur les intérêts américains, cela est visible avec la crise en Syrie. Comment l’expliquez-vous?
Je l’explique très simplement. L’oligarchie mondialiste a pris le contrôle des principaux partis de gouvernement français, le PS et l’UMP. La majorité de ses dirigeants ont été initiés dans les grands clubs transatlantiques. Ils ont épousé le programme mondialiste et ne raisonnent plus en patriotes français comme le faisait le général de Gaulle. Lorsque le peuple français l’aura compris, ces fausses élites seront balayés car elles n’ont pour bilan que le déclin en puissance de la France et la perte de sa souveraineté.
Vous avez soutenu Philippe de Villers en 2004, auriez appelé à Voter pour Nicolas Sarkozy en 2007 et vous venez de vous ranger au coté de Marine Le Pen. Souhaitez-vous désormais entamer une carrière politique?
Le mot carrière ne me va guère. Si j’avais choisi de faire une carrière dans le système, alors j’aurais choisi de proclamer autre chose que des vérités qui dérangent. Je n’ai qu’une ambition, pouvoir dire à mes enfants, au seuil de la mort, que j’ai fait ce que je pouvais pour défendre la liberté et la souveraineté du peuple français. J’ai soutenu Philippe de Villiers que je respecte.
Mais je n’ai jamais appelé à voter pour Nicolas Sarkozy, que je vois comme soumis aux intérêts américains. Je ne sais qui a pu dire une chose pareille mais je vous mets au défi de trouver un seul texte de soutien de ma part à Nicolas Sarkozy. C’est d’ailleurs son gouvernement, en la personne de son ministre de la défense Hervé Morin, qui m’a brutalement écarté de l’Ecole de Guerre parce j’étais trop attaché à l’indépendance de la France et que je m’opposait au retour de la France dans les structures intégrées de l’OTAN. Donc de grâce que l’on ne dise jamais que j’ai soutenu ou appelé à voter Sarkozy.
En revanche, oui je soutiens Marine le Pen et il est possible que je joue prochainement un rôle sur la scène politique à ses côtés. Marine a un caractère fort, une carapace héritée des coups que son père a pris pendant tant d’années, et je la sens donc capable de prendre en main avec courage le destin du pays. Le courage plus que l’intelligence est ce qui manque aux pseudo-élites françaises, lesquelles sont conformistes et soumises à l’idéologie mondialiste par confort.
Comment envisageriez vous la relation franco-russe?
Je l’ai dit et je le redis haut et fort. Si le Front national arrive au pouvoir, il rompra avec l’OTAN et proposera une alliance stratégique avec la Russie. Ce sera un tremblement de terre énorme au niveau international et c’est la raison pour laquelle, avant d’arriver en haut des marches, et même avec le soutien du peuple, il nous faudra affronter des forces considérables. Nous y sommes prêts. Et n’oubliez pas que la France est le pays de Jeanne d’Arc. Tout est possible donc, même quand tout semble perdu!
Merci Aymeric Chauprade.
Aymeric Chauprade, propos recueillis par Alexandre Latsa (Ria Novosti, 16 octobre 2013)