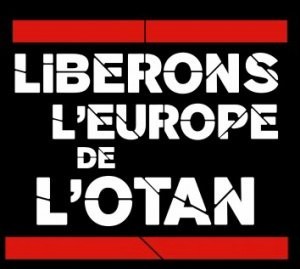Il faut dissoudre l'OTAN
L’Alliance Atlantique et son bras armé l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, l’Otan, datent de la fin de la deuxième guerre mondiale. Elles avaient été créées pour assurer la sécurité de l’Occident devant la menace que constituait l’Union Soviétique. Depuis l’Union Soviétique a disparu, la Russie ne constitue pas une menace et devrait intégrer à terme l’Europe, même si elle ne fait pas partie de l’Union Européenne et pourtant l’Otan existe toujours.
’Europe et la France ont elles intérêt à son maintien ? N’empêche-t-il pas la constitution d’une défense européenne digne de ce nom, et n’entraine-t-il pas l’Europe et la France dans des interventions extérieures où elles n’ont pas d’intérêt ?
L’Alliance Atlantique
Alliance défensive, l’Alliance Atlantique a été fondée par le traité de l’Atlantique Nord à Washington, le 4 avril 1949. Créée pour développer la capacité de résister à toute attaque armée, elle s’est également fixée une mission complémentaire de prévention et de gestion des crises qui peuvent porter atteinte à la sécurité européenne. Elle a théoriquement pour objectif de sauvegarder la liberté, l’héritage commun et une civilisation qui déclare se fonder sur les principes de la démocratie, de la liberté individuelle et de l’état de droit comme le stipule son préambule repris de la Charte des Nations-unies.
L’article 5 du traité sur la solidarité entre ses membres en cas d’agression, en est le point primordial. Le traité va finalement être l’élément qui soudera réellement le bloc occidental derrière les États-Unis, installant peu à peu une hégémonie américaine et une vassalisation de l’Europe. L’Alliance Atlantique rassemble vingt-huit nations raccordant l’Europe de l’Ouest à l’Europe de l’Est. Elle dispose d’une organisation militaire intégrée sous commandement américain.
Le Sommet du Cinquantenaire de l’Organisation qui s’est tenu à Washington du 23 au 25 avril 1999 a débattu, entre autres, de la transformation de l’Otan dans le nouveau contexte géopolitique de l’après guerre froide, un débat centré en Europe sur la nature des relations entre l’Union et l’Alliance atlantique. La guerre du Kosovo menée alors, au même moment, a symbolisé le triomphe de la conception anglo-américaine : d’alliance défensive, l’Organisation tend à devenir l’instrument d’interventions offensives et l’Union européenne s’est placée sous sa tutelle.
L’organisation militaire intégrée
L’alliance ayant pour but de protéger l’Europe d’une attaque du bloc soviétique, les européens furent heureux de bénéficier du parapluie américain. Ils l’ont instamment réclamé à l’origine. L’organisation militaire fut donc dominée par l’Amérique qui en exerça les principaux commandements.
Voulant secouer la tutelle américaine et garder l’indépendance de décision, le général de Gaulle décida de constituer une force nucléaire autonome et de quitter le commandement militaire intégré de l’Otan. Le siège de l’Otan quitta Paris pour Bruxelles en 1966 et toutes les infrastructures étrangères quittèrent la France. Celle-ci ne quitta pas pour autant l’Alliance Atlantique et des accords prévoyaient la réintégration des forces armées françaises en cas de conflit ouvert entre les deux blocs. Elle maintint des forces en République fédérale d’Allemagne (RFA). Déjà en 1962, au moment de la crise de Cuba, la France avait montré sa solidarité avec l’Alliance. De fait les forces françaises continuèrent à s’entrainer avec les forces de l’Otan et à s’aligner sur leurs normes, c’est à dire les normes américaines.
Après la chute du mur et la disparition de la menace soviétique, la France participa pour la première fois à une opération de l’Otan dans les Balkans. C’était le début d’une réorientation de l’Otan qui avait perdu son ennemi naturel. Les attentats du 11 septembre lui ont offert un nouveau rôle, la lutte contre le terrorisme. L’islamisme remplace ainsi le communisme comme principale menace du monde libre. En 2009, la France réintègre l’Otan.
Interventions de l’Otan
La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, est la date symbolique de la fin de la guerre froide et marque la victoire sans combat de l’Alliance Atlantique sur l’Union Soviétique. La menace ayant disparu on aurait pu penser que l’Alliance, défensive, ou au moins son organisation militaire, allait disparaître. Il n’en a rien été, l’Europe n’ayant pas voulu ou pas pu constituer une défense crédible préféra rester sous le parapluie américain. Certains pays de l’Europe de l’Est, la Hongrie, la Pologne et la République Tchèque choisirent même de la rejoindre, voulant se protéger d’un éventuel retour de la menace russe.
D’une alliance défensive contre un ennemi défini, elle devint une alliance politique dont les objectifs furent peu à peu définis par les Etats-Unis qui assuraient, il est vrai, la plus grande part de la charge. Néanmoins, quand on récapitule les interventions militaires auxquelles l’Otan et ses alliés participèrent on peut se demander si elles servaient vraiment les intérêts de l’Europe et singulièrement de la France.
En 1990, si l’intervention était bien cautionnée par l’ONU, ce sont les Etats-Unis qui entrainèrent une coalition de 34 états dans la guerre contre l’Irak de Saddam Hussein pour la défense du Koweit. Le principal mobile de cette guerre était la défense des intérêts pétroliers et économiques des Etats-Unis. En 2003 la France refusera de suivre les Etats-Unis dans la guerre qui éliminera Saddam Hussein. Cette guerre durera jusqu’en décembre 2011 jusqu’au retrait du dernier soldat américain, laissant l’Irak dans le désordre et la violence.
Dans les Balkans cela commencera avec l’éclatement de la Yougoslavie. D’abord en Bosnie où en 1995, l’Otan intervient contre les milices Serbes au profit des Bosniaques et des Croates. En 1999, avec l’accord implicite des Nations unies, l’Otan attaque la Serbie pour la contraindre à évacuer la Kosovo où la majorité albanaise est en rébellion, les bombardements durent 70 jours et obligent les forces Serbes à quitter le Kosovo. Le Kosovo est maintenant indépendant, mais la situation n’est toujours pas stabilisée et l’Otan y maintient encore des troupes (KFOR).
La guerre d’Afghanistan débute en 2001 à la suite des attentats du 11 septembre, dans le but de capturer Oussama Ben Laden, elle est menée par une coalition réunie par l’Otan et à laquelle le France prend part, sous commandement américain. Peu à peu les buts de la guerre changent : on veut établir un gouvernement démocratique et chasser les taliban. La mort de Ben Laden en mai 2011 n’arrête donc pas les combats. Les Américains transfèrent peu à peu la responsabilité du conflit à l’armée afghane en annonçant leur retrait pour 2014. Il est peu probable que l’Afghanistan y gagne le calme et la démocratie.
L’intervention en Libye en 2011, se fit apparemment à l’initiative de la France et de la Grande Bretagne mais fut en fait une intervention de l’Otan : les Etats-Unis assurèrent le succès de l’opération par des frappes initiales détruisant la défense anti aérienne de la Libye et fournissant un soutien en renseignements, en transports aériens, en ravitaillement en vol. Sans les Etats-Unis, quoiqu’on pense par ailleurs du bien-fondé de cette intervention, elle n’aurait pas abouti dans les mêmes conditions.
La question que l’on peut d’abord se poser, c’est de savoir si ces interventions voulues par les Américains et motivées par la défense de leurs intérêts surtout en Irak et en Afghanistan, ont été d’un quelconque bénéfice pour la France et même pour l’Europe. Elles ont en général abouti à la déstabilisation des zones de conflit et à la propagation d’un l’Islam radical.
L’intérêt des Etats-Unis se porte de plus en plus vers l’océan Indien et le Pacifique, faut-il les suivre ? En réalité la défense de l’Europe ne passe pas par-là, nous n’allons pas nous battre pour les Spratleys et les Paracels.
Remarquons de plus que là où il s’agit de défendre les intérêts de la France, actuellement au Mali, l’Otan ne nous est d’aucune aide. Dans l’océan Indien pour lutter contre la piraterie, l’Europe s’est organisée et a mis sur pied l’opération Atalante à laquelle participe neuf nations européennes, ce qui prouve que, quand on veut on peut.
L’OTAN nous impose les choix d’équipements
L’Otan fonctionne aux normes américaines, ce qui revient à dire qu’elle s’aligne sur les méthodes de combat américaines ce qui est toujours couteux et pas forcément efficace.
On est étonné quand on a connu les méthodes de combat du temps de Bigeard de voir crapahuter des hommes chargés de quarante kilos d’équipement, ce qui oblige à les véhiculer sur des itinéraires obligés et accroit leur vulnérabilité. Mais surtout la conception et les performances de nos matériels sont peu ou prou alignées sur les matériels américains.
Prenons un exemple évident, le Rafale, un avion dit polyvalent supposé bon pour toutes missions. Il s’agit en fait d’un intercepteur bi-sonique adapté à l’assaut et à l’appui au sol. C’est un excellent avion mais fort cher. Pour quelles missions avons-nous besoin d’un intercepteur bi-sonique ? Sommes-nous menacés par des avions de son niveau ? Il ne semble pas et pour faire la police de l’espace aérien français ou même européen, le Mirage 2000 n’était-il pas bien suffisant. D’ailleurs les Suisses sont sur le point de lui préférer le Gripen suédois, mono-réacteur moins performant mais moins cher.
Le Rafale est adapté à l’assaut et à l’appui au sol mais pour ces missions, il n’est nul besoin, bien au contraire, d’un avion bi-sonique si cher qu’on n’ose pas le risquer à basse altitude. Il aurait fallu développer un avion rustique, d’une grande autonomie et capable de grande capacité d’emport en armes, en quelque sorte un successeur de l’A-10 Thunderboldt II américain. Le Rafale de Dassault se trouve de plus confronté à l’Eurofighter Typhoon construit par un consortium européen. Les deux avions européens sont en concurrence, à ce jour Dassault n’a vendu aucun appareil hors de France, le Typhoon étant retenu par l’Autriche et l’Arabie Saoudite.
On constate de plus que la tendance mondiale, y compris en Europe, est d’acheter, pour des raisons souvent politiques, le matériel américain, en l’occurrence le F-35 encore en développement et dont le prix ne cesse d’augmenter. Parmi les acheteurs du F-35 on trouve même des pays européens développant le Typhoon.
Il est donc inutile de vouloir concurrencer un matériel américain fabriqué à des milliers d’exemplaires et qui devient la norme. Mieux vaudrait concevoir à l’échelle de l’Europe des matériels correspondant à nos besoins réels sans chercher à s’aligner sur les Etats Unis. Ajoutons que le Rafale, excellent avion qu’on n’arrive pas à vendre, est une lourde charge dans le budget des armées.
Organiser la défense européenne
Tant qu’il n’y aura pas d’union politique, totale ou partielle, l’organisation d’une défense européenne intégrée n’est pas envisageable. Si l’Otan est dissous il faudra cependant organiser au moindre coût la défense des différentes nations et faire ensemble ce qui peut l’être, en ne comptant plus sur le soutien américain.
Certaines tâches communes peuvent être assumées dès maintenant par l ‘ensemble de l’Union si elles ne dépendent pas de choix politiques, pensons en particulier à la police de l’espace aérien européen qui devrait être organisée globalement sans tenir compte des frontières en regroupant les moyens actuellement dispersés. Cette défense serait centralisée aussi bien pour la surveillance et la police du ciel européen que la gestion des moyens qui lui sont affectés, installations de détection, avions. Déjà la police du ciel des Etats Baltes est assurée par les autres pays.
Il pourrait en être de même pour la surveillance des frontières maritimes où les marines de l’Union seraient compétentes dans l’ensemble des eaux territoriales. Cela nécessiterait évidemment une unification des procédures et une compatibilité des moyens de détection et de transmissions. L’opération Atalante qui regroupe un certain nombre de bateaux de l’Union pour la lutte contre la piraterie montre que, nécessité faisant loi, les moyens de plusieurs pays européens peuvent être mis en commun efficacement.
L’Europe constitue un marché important pour l’industrie de l’armement. Des exemples comme la concurrence actuelle sur le marché de l’avion multi-rôle qui finalement profite à l’industrie américaine ne devraient pas être. Cela nécessiterait la constitution d’une véritable Agence Européenne de l’Armement capable de définir les spécifications des matériels adaptés aux besoins des armées européennes, de faire des appels d’offre et de passer des marchés. Bien entendu il faudrait qu’elle se dégage de l’influence américaine et choisisse les matériels les mieux adaptés à nos besoins dans une perspective d’efficacité mais aussi d’économie. L’échec de la fusion EADS-BAE, ne va pas dans ce sens.
La mise en commun pourrait s’étendre à de nombreux domaines : le transport aérien avec des appareils standardisés, gérés et entretenus en commun même si chacun reste la propriété d’un seul Etat, avec les procédures de location ou de compensations nécessaires, le ravitaillement en vol, les avions de patrouille maritime ou de guet aérien, la guerre des mines.
Les satellites de transmission et de surveillance seraient bien entendu mutualisés, chacun ayant accès à leurs moyens selon des procédures à définir. Mais la mise en commun pourrait être étendue à d’autres domaines : achat de munitions et de combustibles et gestion des stocks, formation, entrainement, y compris pour l’utilisation des camps d’entrainement, des simulateurs, des champs de tir et des centres d’essais.
Cela nécessiterait bien entendu la mise en place de structures qu’il faudrait définir les plus légères possibles et l’existence d’un état-major opérationnel commun permanent capable de gérer des interventions impliquant plusieurs pays. La dissolution de l’Otan et de ses structures surabondantes permettrait de récupérer, et au-delà, le personnel nécessaire. Ainsi, petit à petit, les militaires des différents pays de l’Union apprendraient à travailler ensemble sans la tutelle américaine.
Les Etats-Unis se désengagent de l’Europe
Comme le dit le général Jean Cot dans le numéro de mai de la RDN "Il est scandaleux que les gouvernements des vingt-sept pays européens et les plus grands dont le nôtre, puissent s’en remettre pour leur défense, au travers de l’Otan, à une puissance extérieure", d’autant que les Etats-Unis sont en train de réorienter leur défense vers l’Asie et le Pacifique, l’Europe n’étant absolument plus prioritaire.
L’Otan nous a déjà entrainés dans des interventions où nous n’avions rien à gagner comme la Serbie, l’Irak et encore l’Afghanistan. Quand nous avons jugé bon d’intervenir en Libye nous n’avons pu le faire qu’avec l’aide des Etats Unis. Pour la Syrie même avec l’Otan, nous serions bien incapables d’y agir. Quant au Mali, où nous avons des intérêts à défendre contre la conquête du Nord-Mali par des islamistes radicaux, nous en sommes à rechercher le soutien de pays européens, d’ailleurs pas intéressés, les Américains et l’Otan ne nous suivront pas.
Nous avons donc perdu toute indépendance de décision
Pourquoi donc rester dans l’Otan, nous risquons d’être entrainés dans des conflits, où nous et les Européens n’avons rien à gagner notamment en Iran et peut être plus tard en Asie. Irons-nous nous battre pour les archipels de la mer de Chine sous lesquels il y a peut-être du pétrole alors que nous sommes incapables d’assurer la garde de nos Zones économiques exclusives ? Veut-on vraiment financer le bouclier antimissile américain, alors que nous finançons déjà notre dissuasion ?
La dissolution de l’Otan mettrait l’Europe devant ses responsabilités, la nécessité de constituer une défense crédible, avec un niveau plus ou moins grand d’intégration.
Il faut commencer par mettre en commun tout ce que l’on peut sans perdre son autonomie de décision puis, peut-être, aller vers des regroupements industriels ou nationaux. Mais tant que l’Otan existera, rien ne se passera et l’Europe restera une vassale des Etats Unis.
Dernier argument géopolitique, la Russie considère l’Otan comme une menace, sa dissolution permettrait un rapprochement avec ce pays dont la place est maintenant dans le concert européen tant nous avons d’intérêts, économiques et politiques communs.
Contre-amiral François Jourdier (Revue Défense nationale, 2 novembre 2012)