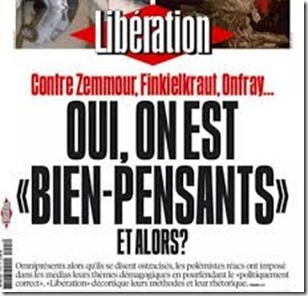Angleterre : la fracture communautaire
La violence des affrontements entre des Anglais de souche et la police peut surprendre dans un pays qui a théorisé le « Policing by consent », le consentement du public à l’action policière. De chaque côté de la Manche, la presse de grand chemin et les politiciens ont tôt fait de qualifier les protestataires de racistes primaires, en déniant toute légitimité aux revendications identitaires exprimées par cette « Angleterre périphérique » (selon le concept de Christophe Guilluy concernant des zones marginalisées par rapport aux métropoles qui bénéficient de la mondialisation économique). La récente mobilisation des Mahorais contre l’immigration massive aurait pourtant pu leur inspirer une lecture moins binaire des événements…
Un modèle multiculturel en crise
Le Royaume-Uni s’est constitué de longue date comme une société multiculturelle juxtaposant les communautés ethniques les plus diverses.
En 1968, Enoch Powell a mis en garde ses compatriotes contre les conséquences catastrophiques de l’immigration de masse en l’absence d’intégration aux valeurs de la société britannique.
Depuis lors, Londres, où le nombre de Britanniques de souche est désormais inférieur à 50 %, a connu des émeutes ethniques très violentes. En 1981, sous le gouvernement de Margaret Thatcher, l’une d’entre elles a éclaté dans le quartier de Brixton, la « capitale » de la communauté jamaïcaine (en France, en pleine campagne présidentielle, les informations télévisées évoquaient les agissements de bandes de skinheads !). La dernière en date, en 2011, a gagné tout le pays à partir du quartier multiethnique de Tottenham. Le Premier ministre David Cameron a alors reconnu l’échec du multiculturalisme à l’anglaise, qui conduit chaque communauté à vivre séparées les unes des autres au détriment du sentiment d’identité nationale.
Par ailleurs, après celui de Londres en 2005, une série d’attentats terroristes islamistes a frappé la Grande-Bretagne, après de longues années de tolérance des autorités à l’égard de la présence croissante de djihadistes dans la capitale (une politique initiée dès 1979 avec le soutien britannique aux moudjahidines lors de la guerre soviéto-afghane).
Dans les années 2010, deux scandales pédophiles majeurs sont survenus à Telford et à Rotherham, où, durant plusieurs décennies, un total effarant de 2 500 jeunes adolescentes blanches issues de milieux populaires ont été droguées, maltraitées, prostituées, violées et parfois torturées, contraintes à avorter ou même tuées par des gangs issus de la communauté pakistanaise.
Du point de vue socio-économique, la classe ouvrière traditionnelle anglaise a subi une paupérisation régulière suite à des vagues de désindustrialisation et de fermetures d’entreprises, conjuguée à un démantèlement des services publics.
La poursuite de l’immigration massive, voulue par les différents gouvernements conservateurs et travaillistes pour combler des besoins en main-d’œuvre à moindre prix, a encore aggravé sa situation à cause d’une mise en concurrence salariale souvent défavorable aux autochtones.
En vertu des concepts libéraux de « main invisible » et de « laissez-faire », les Tories (Conservateurs) restent fermement attachés au libre-échangisme mondialisé, tandis que le Labour Party (Travailliste) s’inspire de théories similaires à celles que diffuse en France le cercle de réflexion Terra Nova, selon lequel la société de demain deviendra « plus jeune, plus diverse, plus féminisée » et sera « unifiée par des valeurs culturelles progressistes », rendant d’ores et déjà obsolescent le « discours politique de gauche ouvriériste » (comme disait François Hollande : « Perdre les ouvriers, ce n’est pas grave. »).
En 2016, le vote en faveur du Brexit, largement motivé par les refus de l’immigration massive et du « dumping social », n’a pas modifié la politique des gouvernements conservateurs successifs, à l’exception d’un projet non abouti d’expulsion au Rwanda des demandeurs d’asile entrés illégalement au Royaume-Uni.
Cette proposition a été enterrée dès son arrivée par le nouveau Premier ministre travailliste Keir Starmer, celui-là même qui avait publiquement posé un genou à terre en signe de soutien au mouvement Black Lives Matter.
La ministre de l’Intérieur Yvette Cooper est quant à elle chargée d’une acquisition massive de logements à travers le pays en vue de les attribuer à des migrants…
Le crime de trop
La colère qui couvait dans les milieux populaires a explosé après le massacre des fillettes de Southport. Des rassemblements se sont très vite formés, parsemés de drapeaux britanniques et d’Union Jack, où la foule reprenait les mots d’ordre anti-immigration « Enough is enough ! » et « Stop the boats ! ».
Ces attroupements ont souvent dégénéré en confrontations violentes avec la police, accusée de mansuétude envers les communautés immigrées. Des dégradations ont également été commises contre des mosquées et des hôtels hébergeant des migrants.
Tommy Robinson, le fondateur du mouvement English Defence League (hostile à «l’islamisation » et pro-israélien) a été soupçonné par les médias d’attiser la violence via les réseaux sociaux.
En réaction, des manifestations ont été organisées dans plusieurs grandes villes par des partisans de l’ouverture des frontières reprenant le slogan « Refugees Welcome ! ». Les activistes dits antifascistes, renforcés par le député Raphaël Arnaud venu pour l’occasion, étaient évidemment présents. Selon ces derniers, les prolétariats immigrés et anglais ne doivent pas se diviser mais au contraire s’unir pour combattre le système capitaliste qui cherche à les diviser pour mieux les exploiter (ici comme ailleurs, le fait qu’ils soient sur la même ligne que le grand patronat pour l’accueil des migrants ne semble pas les effleurer…).
Des milices pakistanaises se sont également mobilisées au nom de la défense des mosquées, en scandant « Allah Akbar ! ». Certains de leurs membres ont exhibé des armes blanches pour montrer leur détermination, tandis que d’autres ont agressé des passants considérés comme racistes ou vandalisé un pub.
En France, si Marine Le Pen a préféré garder le silence sur ces événements, sa nièce Marion Maréchal a repris le slogan « trop c’est trop » (en français) sur son compte X, tout en écrivant que « le cri de désespoir et de colère des Britanniques doit être entendu ».
Une justice à deux vitesses
Le gouvernement a annoncé qu’il ferait preuve d’une extrême fermeté face à cette contestation. En raison de la surpopulation carcérale, 500 détenus de droit commun vont être libérés par anticipation afin de pouvoir emprisonner les émeutiers. Un détenu complice de meurtre par fourniture d’arme va sortir après 6 mois de détention alors qu’il devait en purger 32 !
Les tribunaux, restés exceptionnellement ouverts durant le week-end pour juger les manifestants anti-immigration, ont rendu des sentences inhabituellement lourdes. Un sexagénaire, sans antécédent judiciaire, a ainsi été condamné à une peine de 32 mois de prison pour avoir participé à une manifestation en étant porteur d’une matraque !
Les appels à la violence sur les réseaux sociaux sont durement châtiés. Suite à des publications appelant à détruire un hôtel de demandeurs d’asile accusés de vivre aux crochets des travailleurs et des contribuables, des peines de 20 et 38 mois ont été prononcées contre des jeunes hommes.
Pour faire bonne mesure, le juge a condamné à des peines de 20 et 18 mois d’emprisonnement deux Britanniques d’origine pakistanaise qui avaient agressé et blessé des protestataires drapés de l’Union Jack.
Une préférence communautaire assortie d’un mépris de classe
Sur sa plateforme X, Elon Musk a interpellé le Premier ministre anglais au sujet de la répression des manifestants : « Une police qui a choisi son camp, à deux vitesses », « Ne devriez-vous pas vous préoccuper de toutes les communautés ? ». Selon lui, « la guerre civile est inévitable ».
Nigel Farage, le chef de file du parti Reform UK qui a obtenu 13 % des voix lors des dernières élections législatives, a constaté de son côté qu’« une explosion démographique sans intégration allait forcément mal finir », tout en dénonçant un deux poids, deux mesures dans la répression policière.
Les manifestants ont surtout fait face à des polices locales, souvent peu aguerries au maintien de l’ordre. En effet, à l’exception de Londres et de quelques services spécialisés, la police britannique est organisée selon un système territorial, autour de comtés ou de regroupements de comtés. Depuis 2012, des Commissioners sont élus par l’électorat de leur région, sauf dans la capitale où c’est le Maire qui assume cette responsabilité auprès du Metropolitan Police Service.
Ce modèle diffère de celui qui est en vigueur en France, où la police est étatisée depuis 1941 (le directeur de la Sûreté générale Célestin Hennion avait vainement tenté d’imposer une réforme en ce sens dès avant la Première Guerre mondiale). Sous la Troisième République, trop de maires avaient la fâcheuse tendance de gêner voire d’entraver l’action policière en prônant l’indulgence ou un surcroît de sévérité pour des raisons étrangères au bien commun.
En Angleterre, les affaires pédophiles survenues à Telford et à Rotherham illustrent le pire de ce que peut générer le clientélisme communautaire au niveau municipal. Des enquêtes gouvernementales ont mis en évidence l’incurie des polices locales et des services sociaux, qui ont délibérément ignoré les signalements et même entravé les investigations par crainte d’être considérés comme racistes et d’attiser les tensions raciales.
Au-delà de l’incompétence avérée d’exécutants obnubilés par la lutte contre les discriminations au point de ne plus prendre en compte la réalité des faits, ces conclusions ne disent pas si des élus peu scrupuleux ont tenté de s’assurer le soutien électoral de certaines communautés en orientant complaisamment l’activité des services relevant de leur autorité.
Sans avoir étudié à Oxford ou Cambridge, les « petits Blancs » ont très bien compris qu’ils sont condamnés à subir, si rien ne change rapidement, non seulement une marginalisation socio-économique mais aussi la domination culturelle de communautés étrangères en augmentation démographique constante. Une fois le rapport de force en leur faveur assuré, celles-ci ne manqueront pas d’imposer leurs valeurs et leur mode de vie aux descendants déchus de l’ex-Empire colonial, dans l’indifférence totale d’un Establishment méprisant souverainement les white trashs.
C’est pourtant Elon Musk, l’homme le plus riche du monde actuellement selon Forbes, qui a pris la défense de ces catégories populaires !
Johan Hardoy (Polémia, 14 août 2024)