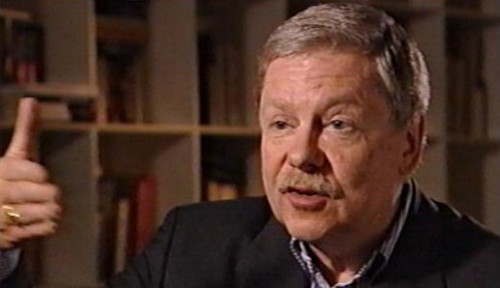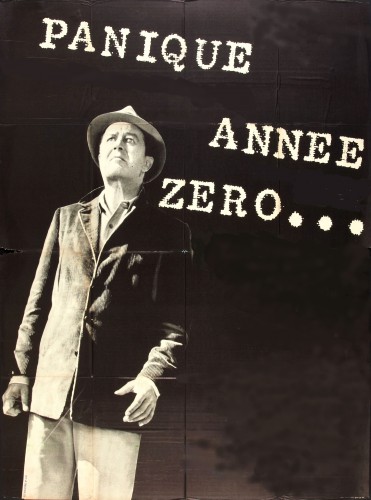Intégration : les 5 rapports qui poussent la France sur la voie du multiculturalisme choisi sans le dire trop haut
Après le rapport Tuot, les rapports remis par cinq commissions (voir ici) chargées, sur des sujets spécifiques, de formuler les pistes de refondation de la politique d’intégration, permettent de se figurer enfin la déclinaison française du multiculturalisme pour lequel l’UE (et donc la France, discrètement) a opté lors du Conseil européen du 19 novembre 2004. Signalons, pour ne plus en reparler, le rapport sur l’habitat rendu illisible par le langage, la syntaxe et l’orthographe.
Le terme multiculturalisme n’est employé qu’une fois sur les 276 pages des cinq rapports, et encore à titre historique et anecdotique. C’est pourtant bien de multiculturalisme dont il s’agit dans ces rapports. Ces rapports nous expliquent que le terme intégration a servi de camouflage à une politique d’assimilation et que le Haut Conseil à l’intégration a été le lieu de ce camouflage. Or, rien n’est plus faux. La tendance républicaine récente, dont on fait grief au HCI, a plutôt contrasté avec d’autres plus anciennes. À sa création, lorsqu’il s’est agi de définir l’intégration, le HCI a en effet opté pour une définition multiculturaliste. L’intégration y est désignée comme "le processus spécifique par lequel il s'agit de susciter la participation active à la société nationale d'éléments variés et différents tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales et en tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de cette variété, de cette complexité". Cette définition, qui fait déjà de la diversité une valeur a priori, anticipait sur celle qui allait être adoptée dans toute l’UE, laquelle insiste elle aussi sur l’idée de processus à double sens. Pour avoir été membre du groupe statistique puis du HCI, je me souviens fort bien que la fermeté républicaine, jugée aujourd’hui synonyme d’intolérance, n’a pas toujours été de mise, comme on fait mine de le croire.
Ce n’est donc pas l’assimilation que ces rapports s’emploient à réfuter, tant l’usage de ce terme comme ses points d’application se sont raréfiés, mais l’intégration. L’idée en a été disqualifiée, nous explique-t-on par son usage à l’égard des descendants d’immigrés et par l’absence d’action à destination de la société dans son ensemble. « Il n’y a pas de spécificité intrinsèque aux populations vues comme “issues de l’immigration” si ce n’est justement que certaines d’entre elles sont vues et traitées comme toujours étrangères ». C’est le regard racialisant, ethnicisant, discriminant etc. de la société d’accueil qui justifie une politique globale visant à transformer ce regard et donc à réformer la partie dite « majoritaire » de cette société. Une incidente est nécessaire sur l’usage récent du qualificatif « majoritaire » dans les écrits scientifiques, notamment ceux de l’Ined, pour nommer ceux qui ne sont, comme le dit l’Insee, « ni immigrés ni enfants d’immigrés ». Sa vertu est de n’attribuer aucune qualité particulière à l’ensemble qu’il désigne et surtout pas l’avantage de l’ancienneté. Insister sur le caractère majoritaire d’une population la renvoie à une position qui ne s’explique que par son nombre, situation qui n’implique aucun ascendant autre que numérique, lequel n’est pas forcément appelé à perdurer. Aucun héritage collectif ne vient teinter l’appellation de « population majoritaire ». Tous les résidents sont équidistants puisqu’il s’agit de reconnaître « toutes les personnes qui résident en France » dans leur diversité, non pas pour la contribution qu’ils pourraient apporter à la société mais « pour ce qu’ils sont et simplement pour leur présence sur le territoire ». Cela suppose « une reconnaissance des personnes dans leur singularité, […] dans le respect des cadres sociétaux minimums communs » et une reconnaissance de la « légitimité des personnes à être ici chez elles, et comme elles sont ou se sentent être, et en conséquence une légitimité des acteurs et des organisations à agir sur les problèmes qui empêchent la normalisation des statuts sociopolitiques et la réalisation d’une égalité effective des droits et de traitement ».
La question que se posait déjà le HCI lorsqu’il avait lancé sa définition de l’intégration, à savoir comment faire tenir ensemble ce conglomérat d’individus et de groupes, les auteurs des rapports se la posent aussi. Le HCI voyait bien se profiler la contestation « du système de valeurs traditionnellement dominant dans notre pays ». Le HCI proposait ce qu’il appelait « le pari de l’intégration » selon lequel la contestation « du cadre global de référence français » serait surmontée par « l’adhésion à un minimum de valeurs communes », tolérance et respect des droits de l’homme. C’est aussi ce que proposent les rapports rendus récemment. Ils invitent les pouvoirs publics à « rompre avec une logique extensive de normalisation », en s’en tenant à un triptyque de valeurs (droits de l’homme, droits de l’enfant, laïcité « inclusive »), lequel peut être transposable à peu près dans toutes les démocraties du monde.
Puisqu’il n’y a ni héritage, ni culture, ni modes de vie à préserver côté « majoritaire », toute l’action politique doit être canalisée vers la lutte pour l’égalité et contre les discriminations de toutes sortes, y compris celles qui figurent dans nos textes de loi actuellement, comme la loi sur le voile à l’école ou l’exclusion des étrangers de la fonction publique. Le mal est si grand et si répandu que cette politique doit être « globale et systémique ». Les majoritaires baignent dans une société imbibée de pensées et attitudes racialisantes qui nécessitent des actions de formation qui leur feront voir la « diversité » sous son vrai jour. L’école est bien évidemment l’institution qui devrait se prêter le mieux à cette rénovation des mentalités, mais pas seulement. Nous sommes tous potentiellement visés : « ensemble des acteurs associatifs, culturels, collectifs, citoyens, acteurs institutionnels et élus ». Il faut ainsi « remettre à plat l’histoire de France » afin d’inscrire « chacun dans une histoire commune ». Pourquoi ne pas constituer un « nouveau “panthéon” pour une histoire plurielle », l’histoire enseignée se référant « à des figures incarnées qui demeurent très largement des “grands hommes” mâles, blancs et hétérosexuels » ? L’idée serait de mettre en place « un groupe de travail national composé notamment d’historiens, d’enseignants, d’élèves et de parents » chargé de « proposer une pluralité concrète de figures historiques […] et de faire des propositions en direction par exemple des éditeurs de manuels, de revues, etc. ». Les activités dites « culturelles » se prêteraient aussi fort bien à cette entreprise de reformatage idéologique. Il faudrait alors valoriser « dans tous les médias des “bonnes pratiques” où les forces vives d’un territoire s’allient pour créer avec les artistes et les habitants des récits locaux qui construisent de nouveaux imaginaires collectifs » déconstruisant ainsi « les clichés, les représentations et peurs de l’autre, inconnu ou étranger ».
Ces rapports empruntent à Bhikhu Parekh qui est tout sauf un multiculturaliste modéré, même au Royaume-Uni, puisqu’il avait proposé de remplacer le mot nation par communauté de communautés, de revisiter l’histoire du Royaume-Uni et, lui aussi, d’en finir avec le mot intégration. Ils s’inspirent aussi beaucoup des multiculturalistes québécois qui, pour se distinguer du multiculturalisme canadien, ont proposé l’interculturalisme québécois. Il faut promouvoir l’interculturel en faisant dialoguer les différentes cultures françaises, en développant les langues de France, le français n’étant que la langue dominante d’un pays plurilingue. « Il faut à la fois banaliser la pluralité des langues et encourager leur réappropriation potentielle par tous les élèves, en tant que véhicules donnant accès à des univers et rapports cognitifs constitutifs d’une pluralité de civilisations, qui font notre richesse, notre histoire et notre culture commune ». On notera la contradiction qu’il y a à demander à des enfants (compris dans « tous les élèves ») de se réapproprier des langues qu’ils n’ont jamais apprises. Ces rapports font également leur les fameux accommodements raisonnables dont les Québécois ne veulent plus guère, sans évidemment prononcer le mot qui fâche. On doit donc s’attendre, s’ils étaient entendus par le gouvernement, à une modification du cadre légal en profondeur pour contraindre aux « compromis normatifs ». C’est probablement sur les mêmes droits que ceux mobilisés au Québec que s’appuierait le nouveau cadre légal – « droit de l’égalité et celui de la liberté de pensée (opinion, religion…) » considérés comme « le socle minimum commun ».
Ce redressement idéologique devrait évidemment toucher le langage puisque « désigner dit-on c’est assigner, c’est stigmatiser ». Seule l’auto-désignation identitaire serait désormais acceptable. Il faut donc reconnaître la différence et en tenir compte plus que jamais sans jamais la nommer. Cela va être difficile. On espère que les formations recommandées pour réformer la société fourniront le glossaire et les exercices appropriés. L’un des rapports recommande de « revisiter tous les registres lexicaux utilisées au sein et par les institutions d’action publique tout comme par les médias et les partis politiques ». On se demande ce qu’il en sera de la recherche. Il prévoit la multiplication de chartes diverses, de recommandations en direction des médias et donc des journalistes et même le « recours à la sanction pour contraindre à la non désignation ». Désigner pourrait être assimilé à un harcèlement racial. On aura intérêt à se tenir à carreau si la rénovation politique annoncée voit le jour.
La connaissance elle-même est un enjeu important. Telle que ces rapports l’envisagent, elle serait à même de faciliter la reconnaissance. Il y faudrait pour cela une « vision actualisée » de l’immigration produite par des « connaissances actualisées ». Par actualisé, il faut entendre une mise au goût du jour. Une manière envisagée pour actualiser la connaissance serait par exemple de consacrer une journée à la commémoration des « apports de toutes les migrations à la société française ». Une autre serait de donner une prime aux documentaires et fictions « favorisant la diversité ». On envisage aussi des « ateliers-débats de philosophie » de la maternelle à la classe de seconde traitant du genre, de la religion, de l’identité, de l’altérité…
Cette nouvelle politique « qui nous pend au nez » si le Premier ministre prend au sérieux les cinq rapports qu’il a lui-même commandés – et pourquoi n’en serait-il pas ainsi puisqu’il a, avec ces rapports, « récidivé » alors qu’il était déjà en possession du rapport Tuot ? – pourrait s’appeler « inclusive » selon les recommandations de ce dernier. « L’inclusion est l’action d’inclure quelque chose dans un tout ainsi que le résultat de cette action. » Et c’est tout. Une politique inclusive vise donc uniquement à favoriser « l’accès du citoyen aux infrastructures et aux services sociaux, culturels et économiques, de même qu’au pouvoir ». Je suppose qu’il faut entendre, par citoyen, « citoyen potentiel » s’agissant des étrangers, même si, on l’a bien compris, plus rien ne devrait logiquement séparer l’étranger du Français en termes de droits. En plus d’une loi-cadre, chaque rapport a sa petite idée sur le nom des instances à placer auprès du Premier ministre, dont certaines seraient déclinées à l’échelon régional afin de mettre en place cette politique inclusive globale : Conseil de la cohésion sociale, Cour des comptes de l’égalité, Institut national pour le développement social, économique ou culturel des milieux populaires chargé de « mettre fin à l’assignation sociale par héritage ».
Cette politique serait distincte de la gestion des flux migratoires – qui, par souci de cohérence, devra rester bienveillante et respectueuse de la diversité - par le ministère de l’Intérieur, dont la réorganisation (décret du 12 juillet 2013) a déjà supprimé le terme d’intégration. Le SGII (Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration) a été remplacé par la Direction des étrangers en France.
Pour conclure, il est cocasse de constater que les cinq missions mandatées par le Premier ministre qui n’ont que le pluralisme en bout de plume dans leurs écrits ne brillent guère par le pluralisme de leur composition et de leurs conclusions. Comme l’écrivait Kenan Malik dans la revue Prospect de mars 2006, « une des ironies qu’il y a à vivre dans une société plus diverse est que la préservation de cette diversité exige que nous laissions de moins en moins de place à la diversité des opinions. » Jean-Marc Ayrault semble avoir parfaitement intégré ce paradoxe.
Michèle Tribalat (Atlantico, 9 décembre 2013)