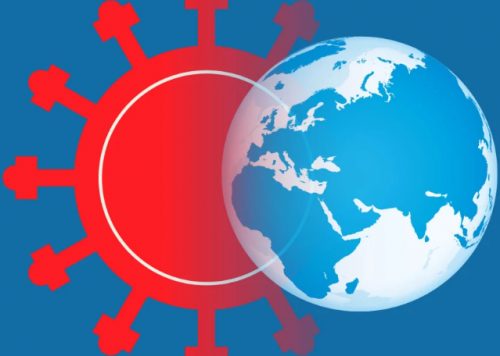Après la mort de cinq soldats français, tués en opération au cours des derniers jours, nous reproduisons ci-dessous deux points de vue consacrés à la stratégie de la France au Sahel et au devenir d'une opération militaire débutée il y a près de huit ans, l'un de Renaud Girard, journaliste au Figaro, spécialiste des conflits armés, cueilli sur le site de Geopragma, et l'autre de Bernard Lugan, historien et africaniste, cueilli sur son blog.

Repenser notre stratégie au Sahel
Cela fait maintenant huit ans que l’armée française est déployée au Sahel. Dans la seule semaine chevauchant le jour du nouvel an 2021, cinq de ses soldats y ont trouvé la mort. Ils furent tués à l’est du Mali, par ces bombes artisanales cachées sous le sable des pistes, qu’on appelle IED (Improvised Explosive Devices) dans le jargon militaire, depuis les dernières interventions occidentales en Afghanistan et en Irak.
Huit années, c’est déjà plus long que la guerre d’Algérie. Les résultats en matière de stabilisation régionale ne sont pas éblouissants, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est un dossier où il vaut mieux éviter les y a qu’à et les faut qu’on, car personne ne possède de potion miracle pour garantir la réussite des interventions occidentales en terre d’islam. Il serait absurde de précipiter le départ des forces françaises, car elles sont aujourd’hui les seules à empêcher que le Mali, ancienne colonie de l’Afrique occidentale française, vaste comme deux fois et demi l’hexagone, se transforme en sanctuaire pour djihadistes internationalistes.
Mais, au bout de huit ans sans résultat patent, ne convient-il pas de regarder la situation en face, afin de repenser notre stratégie ?
Provoquée par l’intervention militaire franco-britannique du printemps 2011, la chute brutale du régime Kadhafi a aggravé une situation économique et sécuritaire déjà très précaire dans la région sahélienne. Les stocks d’armes de la Libye se sont retrouvées aux mains de milices incontrôlables professant l’islamisme, s’enrichissant du trafic de la drogue et des êtres humains, et profitant du sanctuaire du sud algérien.
Au Mali, on peut se demander aujourd’hui s’il n’y a pas un lien entre l’arrivée dans le sud libyen de djihadistes syriens mercenaires de la Turquie et l’intensification des attaques par IED. Une chose est sûre : la région intéresse le président Erdogan, qui a proposé au Niger, il y a six mois, d’y installer une base militaire.
Suite au sommet de Pau de janvier 2020, où les pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad) ont manifesté leur souhait du renforcement de la présence française, 5000 soldats français sont aujourd’hui déployés dans la région, aidés de plus en plus efficacement par 5000 soldats sahéliens, incapables cependant aujourd’hui de prendre le relais. Le Mali dispose en outre des forces onusiennes de la Minusma, 13000 hommes, statiques, mais dont le rôle reste essentiel pour la stabilité d’un pays dépourvue de réelle administration.
Malgré ces déploiements militaires, la perspective sécuritaire ne s’est guère améliorée au Mali, car les problèmes de fond n’y ont pas été réglés. C’est un pays artificiel, où les Touaregs du nord n’acceptent pas d’être gouvernés par les Noirs du sud, qui furent jadis leurs esclaves. Les idéologues islamistes ont su instrumentaliser à leur profit ces revendications anciennes. Aux exactions islamistes se sont ajoutées les luttes interethniques dans la boucle du Niger, notamment entre Peuls et Dogons, entre pasteurs et agriculteurs. L’armée malienne s’est montrée autant incapable de détruire les groupes djihadistes que de désarmer les milices d’autodéfense ethniques. On retrouve le même problème au nord du Burkina Faso.
Les pays de l’UE apportent une aide au développement d’un milliard d’euros au Sahel, mais leurs hommes ne sont pas prêts à venir y mourir aux côtés des soldats français. La France parvient à tuer un certain nombre de chefs djihadistes plus ou moins médiatisés, sans parvenir à dissuader de nouvelles vocations. Dans la population, la perception de soldats étrangers en armes est forcément fluctuante : ils peuvent passer très rapidement du statut de protecteurs à celui d’occupants. Ils deviennent des boucs-émissaires s’ils se révèlent incapables de maintenir la paix civile, quand bien même son viol résulte de facteurs locaux totalement extérieurs à eux.
La France a-t-elle vocation à redevenir le gendarme du Sahel, ce qu’elle fut de 1890 à 1960 ? Voici la question qu’il faut se poser avant de repenser notre stratégie. N’est-il pas temps de prévenir les Etats africains qu’il leur appartient de gérer leur sécurité et que l’armée française ne restera pas éternellement sur le terrain pour les protéger ? Un coup de main occasionnel, oui. Une protection parentale ad vitam aeternam, non ! Ce sont des configurations dynamiques qui conviennent à l’armée française sur le terrain africain. Pas des configurationsstatiques, car elles finissent fatalement par être perçues comme de l’administration coloniale.
Au Sahel, il faut élaborer une stratégie de sortie progressive, reposant sur la montée en puissance des armées africaines, laquelle passe d’abord par de la formation, française mais aussi européenne. En Afrique, aide ton ami à se défendre. Mais si tu persistes à le faire à sa place, tu lui rendras à long terme le plus dangereux des services.
Renaud Girard (Geopragma, 5 janvier 2021)

Mali : allons-nous continuer encore longtemps à faire tuer nos soldats parce que les décideurs français ignorent ou refusent de prendre en compte les réalités ethno-politiques locales ?
C’est très probablement en représailles de la mort de Bag Ag Moussa, un des principaux adjoints du chef touareg Iyad ag Ghali tué par Barkhane le 10 novembre 2020, que deux Hussards de Chamborant (2° de Hussards), ont perdu la vie le samedi 2 janvier, à quelques kilomètres de la base de Ménaka, quand leur VBL (véhicule blindé léger) a sauté sur une mine.
A la différence de la mort de nos trois hommes du 1° Régiment de Chasseurs de Thierville survenue le lundi 28 décembre, au sud de Gao, l’explosion qui a provoqué celle des deux Hussards s’est produite plus au nord, dans une région qui était devenue « calme », les décideurs français semblant avoir enfin compris qu’ici, nous ne sommes pas face au même jihadisme que plus au sud. Comme je ne cesse de le dire depuis des années, et comme je le montre dans mon livre Les Guerres du Sahel des origines à nos jours, ici, le conflit n’est en effet pas à racine islamiste puisqu'il s’agit d’une fracture inscrite dans la nuit des temps, d’une résurgence ethno-historico-économico-politique touareg conjoncturellement abritée derrière le paravent islamiste.
Pour bien comprendre la situation, il nous faut revenir en arrière, au mois de juin 2020 avec la mort de l’Algérien Abdelmalek Droukdal, le chef d’Al-Quaïda pour toute l’Afrique du Nord et pour la bande sahélienne, abattu par l’armée française sur renseignement algérien. Cette liquidation qui libérait le Touareg Iyad ag Ghali de toute sujétion à l’Arabe Abdelmalek Droukdal, s’inscrivait dans le cadre d’un conflit ouvert qui avait éclaté entre les deux branches du jihadisme régional. L’EIGS (Etat islamique dans le Grand Sahara), rattaché à Daech prône en effet la disparition des ethnies et des Etats et leur fusion dans le califat universel. Tout au contraire, le groupe d’Al-Qaïda, dirigé par Iyad ag Ghali « associé » aux services algériens privilégie l’ethnie touareg et ne demande pas la disparition du Mali.
Le coup d’Etat qui s’est produit au Mali au mois d’août 2020, a ensuite permis de donner toute liberté à la négociation entre Bamako et la branche locale d’Aqmi, avec pour but de régler le conflit du nord Mali. Pour la France, l’opération était entièrement profitable car cela permettait de fermer le front du nord.
Même si nous avons perdu ce « doigté » qui était une de nos spécialités à l’époque des « Affaires indigènes » et ensuite des emprises militaires permanentes, dans la durée, avec des unités dont c’était la culture, il allait donc être possible, avec un minimum d’intelligence tactique, et en jouant sur cette opposition entre jihadistes, de laisser se régler toute seule la question du nord Mali. Et cela, afin de commencer à nous désengager après avoir concentré tous nos moyens sur la région des « 3 frontières », donc sur l’EIGS, et également sur certains groupes peul jouant sur plusieurs tableaux à la fois [1].
Or, le 10 novembre 2020, une insolite opération française menée près de Ménaka, donc en zone touareg, s’est soldée par la mort de Ba Ag Moussa, un des principaux adjoints de Iyad ag Ghali. Les Touareg ayant pris cette action comme une provocation, il était donc clair qu’ils allaient mener des représailles.Par devoir de réserve, je n’ai alors pas commenté cette opération sur mon blog, mais j’ai prévenu « qui de droit » que les Touareg allaient, d’une manière ou d’une autre, venger la mort de Ba Ag Moussa et qu’il allait falloir être vigilants dans la région de Ménaka. D’autant plus que, alors que, depuis plusieurs mois, les opérations françaises avaient évité la zone touareg, les derniers temps, elles y avaient repris. Comme si un changement de stratégie avait été décidé à Paris, un peu « à l’américaine », c’est-à-dire en « tapant » indistinctement tous les GAT (Groupes armées terroristes) péremptoirement qualifiés de « jihadistes », et peut-être pour pouvoir « aligner du bilan ». Une stratégie sans issue reposant sur une totale méconnaissance des réalités ethno-politiques locales, et dont nos soldats viennent de payer le prix sur le terrain.
Le signal donné par les Touareg étant donc clair, aux autorités françaises d’en tirer maintenant les leçons. Veulent-elles oui ou non ré-ouvrir à Barkhane un deuxième front au nord ?
En ce jour de tristesse, j’ai une pensée particulière pour le sergent Yvonne Huynh, avec lequel, à la veille de son deuxième séjour au Mali, j’avais longuement échangé sur les causes profondes du conflit, et je tiens, à travers ce communiqué, à faire part de mes sincères condoléances aux « Frères bruns », ses camarades de Chamborant hussards.
Bernard Lugan (Blog de Bernard Lugan, 3 janvier 2021)
Note :
[1] L’on pourra à ce sujet se reporter à mon communiqué en date du 24 octobre 2020 intitulé « Mali : le changement de paradigme s’impose ».