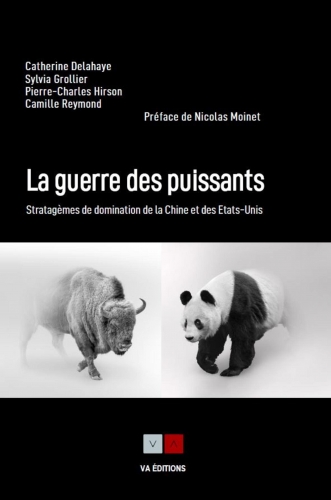Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Pierre de Lauzun, cueilli sur le site de Geopragma et consacré au besoin de la définition d'une politique visant à la défense des intérêts nationaux de notre pays. Membre fondateur de Geopragma, Pierre de Lauzun a fait carrière dans la banque et la finance.

La guerre d’Ukraine : leçons pour une politique nationale
On tend trop souvent à analyser la guerre d’Ukraine en termes émotionnels, ou comme grande lutte des régimes autoritaires et des régimes démocratiques. Je me placerai ici sur un plan différent : celui des relations internationales. Non pour évoquer la question des réactions à la crise (sanctions, etc.) ni celle des perspectives de sortie. Mais pour me concentrer sur les leçons à en tirer pour la détermination d’une politique nationale pour la France.
1. Pour cadrer le débat
Rappelons le principe de base en matière internationale : chaque pays est autonome et responsable de son action. Cela ne veut pas dire qu’il ne considère que ses seuls intérêts. Membre d’une communauté internationale, il prend aussi en compte ses relations avec les autres pays, tant pour coopérer que pour la recherche de la paix. Or, dans le contexte international, un principe essentiel pour la recherche de la paix est le respect de la souveraineté et donc des frontières. Ce principe n’est pas absolu ni totalement inviolable, et il y a des précédents graves, comme la guerre d’Iraq qui était une guerre d’agression (malgré l’excuse des attaques antérieures de l’Iraq sur ses voisins). Mais il reste par nature un repère majeur.
De ce point de vue, l’attaque russe sur l’Ukraine, agression généralisée d’un Etat souverain par un autre, sans provocation ou menace du premier directement sur le second, ne peut faire l’objet que d’une condamnation nette. Même si comme on sait les responsabilités occidentales et notamment américaines sont significatives. Le joueur d’échec que paraissait être Poutine a renversé la table, d’une façon peu rationnelle. Notons incidemment que sur ce plan l’invasion contredit la doctrine affichée par le grand allié de la Russie, la Chine (rappelons que Taiwan est considéré partie de la Chine).
2. Le paysage international à la suite de l’attaque russe
Par son ampleur et sa nouveauté, une telle agression représente un tournant majeur dans les relations internationales. D’un côté, c’est le retour à la guerre comme instrument de rapports entre Etats, autrement que dans des cas qui pouvaient être présentés à tort ou à raison comme une forme de police internationale. Et d’un autre côté, c’est une rupture franche entre la Russie et le monde occidental, et par là aussi le mode de régulation internationale que celui-ci affiche. Bien entendu, une appréciation complète dépend des buts ultimes côté russe : volonté de puissance et de revanche, reconstitution d’une grande Russie ou d’une forme d’URSS, etc. L’attaque montre en tout cas qu’on n’a pas affaire à un patriotisme pur et simple, comme en témoignait déjà l’intervention en Syrie, acte de puissance et non de défense de la patrie russe.
Par ailleurs, la guerre en Ukraine fait sortir les Européens de leur monde rêvé où la paix est une situation normale et où la question de la guerre ne se pose qu’au loin, dans des pays où sévissent encore d’affreux tyrans qu’une bonne police internationale doit pouvoir faire disparaître. Ce qu’ils découvrent est la possibilité de la guerre en Europe, en outre avec une puissance nucléaire majeure. Derrière, se profile ce qui était pourtant clair depuis des années : l’émergence d’un monde multipolaire qui est un monde de puissances, où la guerre est possible, que j’ai décrit dans mon livre de 2017 appelé justement Guide de survie dans un monde instable, hétérogène, non régulé.
Ce qui est particulièrement évident en Asie, avec présence de grandes puissances actuelles ou potentielles, tant dans la région (Chine, Russie, Inde, dans une certaine mesure Japon) que venant du dehors (Etats-Unis) ; plus des puissances moyennes mais ayant un poids réel appréciable (Iran, Pakistan, Arabie Saoudite, Indonésie, Corée, Vietnam, sans parler de la Turquie et d’Israël à l’ouest du continent). Les rapports entre ces nombreuses puissances sont complexes et évolutifs (y compris entre Russie et Chine, malgré les apparences), mais avec un point commun : les lignes de clivages ne sont pas idéologiques, ni vraiment des conflits de civilisations, et le patriotisme est partout une réalité de base indiscutable. Les réactions à la guerre en Ukraine le confirment, avec très peu de condamnations franches venant de cette zone. Or, l’Asie est de plus en plus le centre de gravité de la planète et elle donnera de plus en plus le ton.
À cela s’ajoute bien sûr la situation toujours complexe et belligène du Moyen-Orient, et la dérive croissante du Sahel, de la corne orientale de l’Afrique ou de la zone congolaise, et plus généralement d’une bonne partie de l’Afrique. Conflits, instabilité et guerres, mais là aussi, pas de conflit véritablement idéologique.
3. Dans un monde de puissances, l’importance clef d’un patriotisme sain et lucide et non d’une croisade idéologique
À l’opposé, la tentation latente en Europe et aux Etats-Unis reste l’idéologisation : en l’espèce, interpréter l’alliance de la Russie et de la Chine comme la sainte alliance des régimes autoritaires contre les démocraties, et tout voir en termes de grand combat manichéen de celles-ci contre ceux-là. La guerre d’Ukraine a considérablement ravivé cette tendance, parfois jusqu’à une forme d’hystérie. Mais en fait, seuls les ‘Occidentaux’ mettent en avant leur idéologie. Or comme je l’ai déjà relevé par ailleurs, la tentation idéologique est très dangereuse en matière de relations internationales, et cela indépendamment du bien-fondé de ce qu’on appelle ses ‘valeurs’. En termes clairs, il faut dans la plupart des cas choisir entre l’idéologie et la recherche de la paix. En outre, cette attitude, qui se veut moralisante, est celle qui rencontre le moins d’écho en dehors du monde occidental, d’autant que cela peut à un moment ou un autre menacer la plupart des pays ou régimes et a justifié dans le passé des agressions occidentales stupides, sanglantes et contreproductives (Iraq, Lybie etc.). Dans le cas ukrainien, condamner une agression manifeste est parlant ; y voir la lutte du bien et du mal est moins convaincant.
Ce qui n’empêche évidemment pas de souligner les différences entre les différents régimes politiques, de considérer que tel ou tel est mauvais, et de promouvoir des valeurs qu’on juge essentielles. Rien n’empêche en effet d’avoir ses idées et de porter des jugements, notamment sur les régimes jugés brutaux, agressifs, ou a fortiori totalitaires, et d’aider des évolutions dans un sens qu’on juge meilleur. Mais cela doit s’inscrire dans un cadre de relations internationales où on doit admettre qu’on est un pays ou ensemble de pays parmi d’autres, qu’on est perçu par les autres comme défendant sa position et ses intérêts, et où surtout la guerre au sens propre (et l’escalade) est en général contreproductive, en dehors même de ses horreurs.
Mais si ce qui compte est, là où on est, de jouer son rôle et s’assumer ses responsabilités, le patriotisme est plus que jamais à l’ordre du jour. Patriotisme pacifique, inscrit dans une communauté des Etats et le respect mutuel, mais patriotisme profond et exigeant. Cela implique, non seulement de disposer d’un outil de défense puissant et efficace, donnant la plus grande autonomie possible et donc des budgets militaires appréciables, mais aussi un esprit de combat, de défense, que nous avons perdu (et dont les Ukrainiens montrent à nouveau l’importance). Nous en sommes encore bien loin. C’est évidemment pour nous la leçon centrale de ces évènements.
4. Quelles alliances militaires pour un pays comme la France ?
Reste la question des alliances. Un pays comme la France à la fois une tradition d’action autonome (décrite couramment sous le terme de gaullisme), qui s’est étiolée au fil du temps, mais a pu encore se traduire récemment ici ou là, et une inscription dans des alliances ou constructions politiques : l’Alliance atlantique et l’Union européenne. Dans leur principe, on ne peut que conserver ces deux éléments, mais en les délimitant.
Une alliance est utile lorsqu’elle permet de maintenir une solidarité face à ce qui serait un agression franche de la part d’une puissance, lorsque cette solidarité est justifiée. L’Alliance atlantique a fondamentalement pour rôle de parer à une menace soviétique puis russe. Cette menace pouvait être perçue comme moins actuelle, mais l’agression russe de l’Ukraine lui a donné une certaine crédibilité. Bien sûr, cela dépendra aussi de l’issue militaire de ce conflit. Et même si la Russie se tirait bien de cette affaire mal engagée, elle n’est à l’évidence pas en état de menacer grand monde en dehors de son ancienne zone d’influence. Mais justement, le choix russe de mener cette agression fait qu’on doit intégrer au moins l’hypothèse d’une telle attaque contre d’autres pays d’Europe orientale, ce qui redonne un sens à l’Alliance, même si la Russie ne sera à court terme sans doute pas à même de le faire. Et pour la France, une telle attaque éventuelle et la vassalisation de l’Europe orientale ne seraient pas acceptables. Mais naturellement cela ne vaut que pour l’Europe (orientale). Il n’y a aucune raison pour que cela s’étende à d’autres zones.
Et ces motifs n’impliquent pas un alignement général, d’abord sur les Etats-Unis, qui sont la colonne vertébrale de l’Otan, mais qui ont commis suffisamment d’erreurs dans le passé pour ne pas être suivis partout ; comme aussi sur des Européens dont nous sommes loin de partager toutes les vues, ni n’avons toujours les mêmes intérêts de défense (notamment sur le plan naval, avec notre immense domaine maritime), ni la même capacité à agir. L’Alliance devient notamment contreproductive si elle se traduit par le suivi servile des errements de la politique américaine ou de leurs intérêts qui ne se confondent souvent pas avec les nôtres, ou, pire, par des agissements qui sont des menaces pour la paix. Concrètement, en l’espèce, il aurait par exemple fallu continuer à s’opposer fermement à l’hypothèse même de l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan. Dès lors, sur le plan militaire, autant une interopérabilité peut être utile, voire indispensable pour des actions communes qu’on juge appropriées, autant il faut viser le maximum d’autonomie opérationnelle possible. Entre autres exemples, la Russie y parvient technologiquement alors que son économie est plus réduite que la nôtre ; Israël, encore plus petit, dans une large mesure aussi.
Ce qui conduit à poser la question de notre participation à l’organisation intégrée de l’Otan. Elle n’est pas indispensable (on s’en est passé pendant quarante ans) et il aurait mieux valu ne pas y entrer. Ce qui nous éviterait aussi de nous endormir sous la protection américaine, réelle ou non, comme l’Otan conduit à le faire. Logiquement cette analyse implique d’en sortir au moment opportun (et donc pas dans les circonstances actuelles), tout en restant dans l’Alliance. Une telle politique renforcerait la crédibilité de la France dans ses tentatives d’intermédiation ou d’influence.
S’agissant de l’Union européenne, elle ne peut être un cadre adéquat pour une politique de défense, contrairement à ce que prétend E. Macron. D’une part, les autres pays européens en quasi-totalité (et surtout à l’Est) sont plus que jamais convaincus que le lieu adéquat pour cela est l’Otan, et que leur défense est assurée d’abord et surtout par les Etats-Unis ou avec eux, y compris quand ils renforcent leur propre effort de défense. D’autre part, dans la plupart des cas, les divergences de vues sur l’opportunité d’une action militaire et sur sa direction sont notables entre Européens. L’agression russe de l’Ukraine est une exception, puisque l’accord de tous était d’emblée évident, au moins sur le principe ; mais les mesures prises auraient pu l’être dans le cadre d’un simple instrument de concertation entre Etats, sans besoin d’une défense commune. En outre, ces mesures (sanctions, livraisons d’armes) étaient justifiées au départ mais tendent à devenir irrationnelles (boycott de musiciens !) et surtout contreproductives, ainsi le désengagement des entreprises de Russie, au seul profit des Russes. Enfin, cette défense commune n’est pas prévue par les traités ; et le paragraphe des traités sur la solidarité entre Européens face à une agression n’y conduit pas, sauf cas particulier.
Il ne faut donc pas s’obnubiler sur le mythe d’une défense européenne autonome, qui dans l’état actuel des choses ne serait au mieux qu’une variante au sein de l’Otan, et au pire la clef de notre immobilisme. Et d’ailleurs, même si ce mythe se réalisait, à savoir une défense européenne totalement intégrée et bien équipée, pour la plupart des Européens elle ferait moins bien que l’Otan face à une puissance nucléaire majeure comme la Russie, dans le cas ukrainien ou ailleurs.
En revanche, une coopération avec les autres Européens, notamment dans les industries de défense, est nécessaire et bénéfique, tout en prenant garde d’avoir une réelle réciprocité, contrairement à ce qu’on voit (ainsi récemment pour les avions américains achetés par l’Allemagne – après bien d’autres cas), et de ne pas se faire lier les mains, ou, pire, déposséder de notre outil par idéologie ou esprit de système.
Pierre de Lauzun (Geopragma, 28 mars 2022)