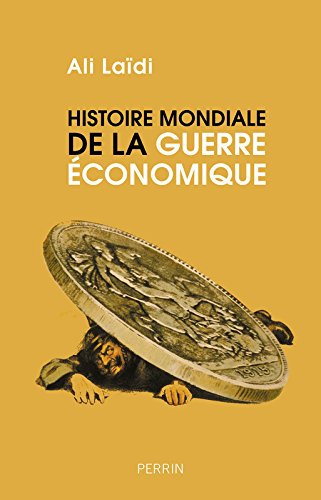Vers un crash économique mondial ?
Les économistes classiques distinguent deux niveaux de crise : la récession et la dépression, la première étant passagère (une grippe), la seconde étant plus grave (une pneumonie), comme la crise de 1929. Il existe un troisième niveau, jamais envisagé, à tort, par les économistes officiels : le crash, comparable à un cancer. Mortel. Le dernier en date eut lieu au début du Ve siècle avec l’effondrement de l’Empire romain d’Occident. Il aura fallu près de mille ans pour s’en remettre.
Voici quels sont les facteurs de déclenchement possibles de l’ apocalypse économique.
1. Un mécanisme spéculatif international fondé sur des robots numériques et déconnecté de l’économie réelle.
Le spéculateur va du fonds de pension au petit épargnant en passant par les banques et autres institutions financières, avec aussi les fonds souverains et les important investisseurs privés. Les bourses ne dépendent plus des ordres concrets des détenteurs d’actions mais les ordres d’achats et de ventes, instantanés, sont définis par des algorithmes informatiques, simplement contrôlés, mais non décidés intelligemment, par des ”financiers” rivés à leurs écrans. Ce sont les milliers de robots interconnectés qui décident de vendre, d’acheter, d’emprunter, de prêter. De gigantesques flux d’argent, hors contrôle et totalement virtuels innervent la planète à une vitesse et avec une instantanéité phénoménales. Cela n’a aucun rapport avec l’économie réelle et peut créer des bulles explosives. Le terme d’ « économie de casino », créé par le prix Nobel d’économie Maurice Allais s’applique aujourd’hui bien plus que de son temps.
2. Un système bancaire international opaque et adepte de pratiques dangereuses.
Blanchiment d’argent sale, aide aux fraudes fiscales, prêts pourris… La prudence et l’honnêteté de beaucoup de banques (pas toutes évidemment !) dans tous les pays du monde peuvent être mises en cause. Il en va de même pour les compagnies d’assurance. Les banques des deux premières économies mondiales (États–Unis et Chine) sont particulièrement adeptes de créances douteuses et de pratiques risquées et opaques. L’absence de réorganisation du système bancaire international après l’alerte de 2008–2009 est inquiétante parce que le niveau des créances et d’opérations dangereuses ne cesse d’augmenter.
3. Un endettement structurel de tous les acteurs économiques mondiaux, publics et privés.
La dette, comme un virus, est au cœur du fonctionnement de l’économie internationale : endettement croissant des États, des entreprises et des particuliers. Cette situation, jamais vue auparavant, est intenable à moyen terme. Si tout le monde emprunte plus qu’il ne peut rembourser, le système s’effondre. Parce que l’ensemble de l’économie mondiale dépense plus qu’il ne produit. Si l’État français est endetté à hauteur de presque 100% du PIB, en hausse constante, l’État chinois l’est à 230% du PIB contre 130% en 2008. Les chemins de fer chinois (China Railway Corp) sont endettés à hauteur de 557 milliards d’euros, plus que la Grèce (311 milliards) !
Pour l’instant, tout tourne mais ça ne durera pas. De plus, le vieillissement des populations occidentales, de la Chine et du Japon va considérablement alourdir la dette globale, du fait des dépenses de santé et de dépendance, si des économies drastiques ne sont pas accomplies par ailleurs par les États. (étude de S&P Global Ratings, mai 2016). L’éclatement de la bulle d’endettement mondial peut provoquer un ”effondrement systémique” : faute de pouvoir être remboursées, la plupart des institutions financières mondiales font faillite. Et entraînent dans leur chute une majorité des acteurs économiques qui sont totalement liés les uns aux autres. C’est le fameux effet domino.
4. Une Union européenne plombée par la France socialiste, homme malade de l’Europe.
Contrairement à ce que prétendent certains (au FN, etc.), ce n’est pas l’Union Européenne, aussi imparfaite soit-elle, qui plombe l’économie française mais le système socio-économique français, d’inspiration marxiste, qui se plombe lui-même… et qui menace toute la zone Euro. Pour l’économiste Nicolas Baverez, la France risque l’ « implosion » et peut entraîner dans sa chute la zone Euro, ce qui provoquerait une récession mondiale. « Le grand écart entre les deux principales économies de la zone euro (France et Allemagne) est insoutenable à terme ». Les dirigeants français ont toujours « refusé toute réforme d’un modèle économique et social suicidaire ». Si la droite revient au pouvoir en 2017, il est très peu probable qu’elle ait le courage d’accomplir un tournant majeur, en dépit des promesses de chevaux de retour candidats à la primaire. On les connaît…
De plus, indépendamment du cas français, l’UE est menacée de dislocation du fait d’autres causes structurelles : elle constitue un ensemble mal organisé, économiquement et financièrement mal géré, sans frontières, sans politique commerciale extérieure. La France entraînera d’autant plus facilement l’Europe dans son naufrage que cette dernière est déjà un navire qui prend l’eau.
5. Les migrations massives et le choc avec l’islam.
Ces deux facteurs, qui menacent l’Europe (surtout) et l’Amérique du Nord, sont lourds de conséquences économiques. Une colonisation de peuplement par des populations en grande majorité musulmanes et globalement (qu’ils soient migrants récents ou nés ici) d’un niveau très inférieur aux populations autochtones en déclin démographique dramatique, va être la source d’énormes troubles. Ils s’ajouteront aux causes ethniques et démographiques d’un effondrement économique global et prendront probablement la forme d’une guerre civile, d’abord en France. Cette dernière sera un facteur d’accélération d’un crash économique qui affectera toute l’Europe et, par effet de dominos, le monde entier.
Quelques signes avant–coureurs de l’effondrement
Tout d’abord le cours de l’or explose : +18% depuis le 1er janvier 2016. C’est une valeur refuge, un placement improductif. 1.290 tonnes d’or ont été négociées depuis cette date, soit 25% de plus qu’en 2015.Chiffre énorme. Le repli sur l’or est de très mauvais augure, il traduit un pessimisme profond, l’attente d’une catastrophe économique.
Ensuite, sur la côte Ouest américaine, paradis des start–up et de l’économie numérique, les investissements ont chuté de 25% au premier trimestre 2016. La Silicon Valley, temple et thermomètre de la ”nouvelle économie”, est en grande difficulté financière. C’est la première fois depuis sa création, voici trente ans. Enfin, les fonds financiers européens et américains ont, depuis quelques mois, retiré 90 milliards de dollars des marchés des actions pour les reporter sur… l’achat d’or. N’oublions pas non plus l’inquiétante récession du Brésil : un PIB en chute de 3,8% en 2015 et probablement autant en 2016 selon le FMI.
L’optimisme forcé, assez irrationnel, sur la ”nouvelle économie numérique”, avec le big data, la blockchain, l’impression 3D, le ”transhumanisme”, etc. qui préfigureraient une ”troisième révolution industrielle” et un nouveau paradigme (et paradis) économique mondial, relève probablement de l’utopie et de l’auto persuasion. Et de la croyance aux miracles.
Les conséquences d’un crash économique mondial
En Europe, un effondrement du niveau de vie d’environ 50% est parfaitement possible, avec le retour de nombreux pays à une économie de subsistance, à la suite d’un déclin géant de tous les échanges et investissements. Certains diront que tout cela sera positif en créant un terrible chaos qui remettra les pendules à l’heure et provoquera par contrecoup un effet révolutionnaire de renaissance.
Un tel crash pourrait peut-être stopper et inverser les flux migratoires en Europe. On ne sait pas, nous verrons bien. On ne peut pas prévoir les conséquences exactes d’événements qui, eux pourtant, sont prévisibles. Il faut simplement se préparer au pire qui peut aussi être le meilleur.
Guillaume Faye (J'ai tout compris, 23 mai 2016)