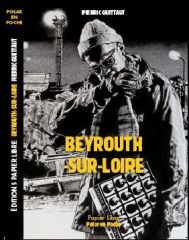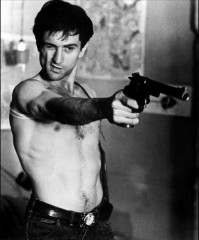Le journal Le Monde dans un article de Caroline Monnot et Abel Mestre, publié dans l'édition du 28 mai 2011 et intitulé Les penseurs de Marine le Pen, souligne que, par l'entremise d'Emmanuel Leroy, un des conseillers de Marine Le Pen, le nouveau programme du Front national a été fortement influencé par la pensée solidariste . Pour éclairer nos lectuers, nous reproduisons ci-dessous un texte intéressant dudit Emmanuel Leroy, cueilli sur Altermedia infos,datant de novembre 2008, qui définit bien les principaux concept de cette pensée de "troisième voie"...

Pour la définition d'une doctrine solidariste
La crise dans laquelle nous venons d’entrer démontre à nouveau l’extraordinaire désarroi dans lequel se trouve plongé le camp national dès lors qu’il est question de problèmes économiques ou sociaux. A de rares exceptions près, c’est le silence ou la dénonciation stérile de comportements scandaleux qui prévalent, sans qu’une solution alternative ne soit jamais avancée.
La crise boursière de 2008 n’a pas donné lieu dans notre camp, sauf rares exceptions, à des analyses empreintes d’une réflexion de fond sur les causes de celle-ci et les remèdes à y apporter. Devant cette carence, une évidence s’impose : quel discours tenir face à un possible effondrement de la légitimité du Système ? Et quelle alternative proposer au peuple qui ne soit ni trotsko-marxiste ni libérale ? La réponse à ces deux questions a déjà été esquissée dans le passé. Nous proposons d’aller plus loin pour offrir une alternative radicale au Système, afin non seulement de tenter de l’abolir, mais surtout d’éviter tout retour possible du mercantilisme et de ses poisons.
A l’époque de la révolution industrielle au XIXème siècle, la République a cherché à concilier deux exigences fondamentales : la liberté individuelle et la justice sociale. L’idée de solidarité, notamment avec Léon Bourgeois, apparût alors comme le moyen d’esquisser une troisième voie entre l’individualisme libéral et le socialisme collectiviste. D’une certaine manière, la France jusqu’aux années 70 avait su trouver une espèce d’équilibre entre socialisme et libéralisme mais l’accélération de la mondialisation à partir des années 80 a fait voler en éclat ce subtil équilibre au profit des oligarchies financières transnationales.
La logique du Système est implacable : après avoir porté les coups de boutoir contre la nation (solidarité verticale), viennent maintenant les attaques contre le social (solidarité horizontale), derniers remparts contre la déferlante de l’indifférencié et du règne sans partage de l’argent.
Le solidarisme est la seule réponse possible à opposer au jeu dialectique des deux internationales, libérale et trotsko-libertaire, qui se livrent devant nous à un jeu de pseudo-opposition, afin de mieux faire disparaître les peuples et les remplacer par une humanité esclave aux ordres du Système.
L’intérêt de la notion de solidarisme est loin d’être purement historique: elle constitue une référence cardinale à tout débat sur la protection sociale et à la répartition des richesses dans la société post-industrielle du XXIème siècle. Or, une des raisons majeures pour lesquelles le camp national n’est pas audible en dehors des questions liées à l’immigration, c’est qu’il n’a pas été capable d’apporter aux Français des réponses claires sur ses conceptions économiques et sociales.
A l’heure où le Système semble entrer dans une crise d’une ampleur sans précédent, ceux qui sauront concilier les intérêts de la nation et la défense des travailleurs sans briser la liberté des individus seront les vainqueurs de demain.
Renaissance du solidarisme en 2008
L’économie et le social n’ont jamais été au sein de la « droite nationale » des domaines qui ont suscité engouement et passion. Les tenants de cette doctrine, en partie influencés par les idées de Maurras (politique d’abord), n’ont pour les questions économiques et sociales qu’une vision distanciée où l’empirisme et le réalisme l’emportent sur les aspects doctrinaux (l’intendance suivra). Cette situation découle probablement du fait que nous sommes les héritiers de différents courants idéologiques où libéralisme et socialisme étaient présents. A l’issue de la seconde guerre mondiale, les camps politiques en Europe occidentale se sont artificiellement scindés en deux grands courants opposant une « droite » libérale et conservatrice à une « gauche » socialiste ou marxiste censée représenter les forces du progrès. Cette division artificielle était censée reproduire l’opposition entre « pays occidentaux libres » et « pays communistes opprimés ». Le courant national était à cette époque complètement marginalisé, en partie du fait de la propagande « résistantialiste » qui a réussi à établir comme une vérité que ses principaux leaders s’étaient mis sans exclusive au service de la France de Vichy ou de la collaboration la plus étroite avec l’occupant (cela sans tenir compte des nombreux royalistes et autres nationaux qui s’étaient engagés dès 1940 dans la résistance). Cette stigmatisation a conduit à la marginalisation quasi-totale des idées nationales/nationalistes jusqu’au début des années 80 qui ont vu l’émergence du FN. La première moitié de cette décennie a été l’occasion véritablement historique de réunir sous l’autorité de JMLP l’ensemble des courants identitaires français. Chacune de ces chapelles idéologiques avait bien sa propre conception doctrinale ou philosophique mais les différences de points de vue ou les querelles étaient obérées par la primauté du leader du FN et par le primat qui était réservé à la question de l’immigration. L’analyse de l’ensemble des scrutins auxquels a participé le FN jusqu’aux années 95 montre à l’évidence que ses électeurs se déterminaient essentiellement sur le refus de l’immigration massive imposée par le Système. En effet, sur les questions économiques, le positionnement du FN n’apparaissait pas de manière claire et JMLP était à l’époque influencé par les idées libérales d’outre-atlantique. Sous l’influence de différents courants internes (solidarisme, christianisme social, anciens cadres du GRECE) le programme du FN entame dès la fin des années 80 une inflexion sociale très marquée et même si ce message est encore peu et mal relayé auprès de l’opinion, il constitue une rupture essentielle dans ce que l’on pourrait appeler « l’idéologie économique » du FN avec les idées libérales qu’il semblait auparavant professer. C’est cette mutation, qui intervient à un moment-clé de la vie politique française à un moment où la gauche, socialiste et communiste, s’est complètement ralliée à l’idéologie marchande du Système (dès 1983), qui devait permettre la progression significative des scores électoraux du FN jusqu’à la crise funeste de 1998. Malheureusement, les fruits de cette évolution, qui pouvaient conduire le camp national aux portes du pouvoir, ont été gâchés par la scission.
L’un des éléments-clés d’un possible retournement de l’opinion à l’occasion de la crise financière de 2008 est la perte de légitimité que le Système va inéluctablement subir lorsque les conséquences sociales vont se faire sentir plus crûment. Mais il sera nécessaire à ce moment d’offrir une alternative économique et sociale crédible, sans laquelle nous risquons d’être perçus comme des espèces de sous-Besancenot. Cela implique d’adopter résolument un positionnement anti-Système -qui sera en résonance avec le refus de la constitution européenne exprimé par les Français lors du référendum de 2005- et qui ne se borne pas seulement à une dénonciation des effets pervers de la mondialisation, mais qui énonce également une politique claire et limpide sur nos conceptions économiques et sociales. La meilleure illustration que l’on pourrait donner de notre vacuité en matière économique est l’absence de réponse cohérente sur les questions économiques et sociales, et plus particulièrement sur les causes de cette crise. Il est certes difficile de répondre de manière lapidaire à une crise dont la complexité s’apparente à celle du noeud gordien mais, de manière succincte, voilà l’énoncé d’une position solidariste sur cette question :
1. la classe politico-médiatique de Sarkozy à Besancenot) est collectivement responsable du désastre (conception matérialiste et économique du monde).
2. Nous punirons les responsables de cette escroquerie gigantesque, financiers ou hommes politiques, qui l’ont provoquée, encouragée ou servie.
3. Nous restaurerons une politique nationale où la notion de solidarité entre citoyens sera inscrite dans la Constitution et où seront proscrits les comportements anti-nationaux (délocalisations, privatisation des services publics…).
4. Nous instituerons une politique économique et sociale où sera rétablie la souveraineté monétaire, restauré l’usage du franc et respectés les principes de préférence nationale et européenne.
5. Seront dénoncés les traités qui subordonnent toute décision nationale à l’avis des autorités de Bruxelles.
L’objet de cette note n’est pas de formuler un programme économique et social complet, mais plutôt de lancer un débat sur ce que pourrait être un solidarisme moderne. L’idée de fond est que la gauche, du fait de son orientation internationaliste, a rallié l’idéologie du Système et qu’ayant ainsi renié ses convictions et ses engagements, elle a trahi non seulement la classe ouvrière mais aussi les classes moyennes qu’elle avait su séduire dans les années 80. En agissant ainsi, elle a laissé ouverte la voie du social que seul le camp national peut légitimement emprunter. Je partage l’analyse d’Alain Soral sur ce sujet et soutiens notamment ses positions sur la gauche du travail et la droite des valeurs, comme dialectique permettant de dépasser l’affrontement droite/gauche et susceptible de restaurer les solidarités nationales en dépassant le concept de luttes des classes.
C’est sur cette capacité à récupérer les électeurs séduits par les sirènes sarkozystes et à rallier les électeurs de gauche que se jouera l’avenir de la France.
Une des difficultés majeures qui peut se présenter est celle d’un discours « social » qui pourrait effrayer une partie de notre électorat traditionnel (artisans, commerçants, patrons de PME, indépendants). Pour éviter cet écueil, il convient à mon avis de sortir des sentiers battus et d’imposer de nouvelles définitions dans le vocabulaire politique français. En effet le champ sémantique utilisé par les politiques ou les médias d’aujourd’hui dans le domaine social reprend peu ou prou les termes utilisés par la gauche socialiste ou marxiste du XIXème siècle. Certes le terme de « prolétaire exploité » n’est plus guère usité mais celui de « patrons exploiteurs » l’est encore et parfois à juste titre et cette perception de « patron de droit divin » est encore bien ancrée à gauche et c’est sur cette perception, en partie erronée, qu’il convient d’intervenir. Il faudrait ici introduire une distinction fondamentale entre petits et grands patrons, qui ne participent pas du même monde, ne jouent pas dans la même cour et souvent ne poursuivent pas les mêmes objectifs. N’oublions pas que l’ensemble des artisans, commerçants, petits patrons et indépendants représente environ 3 millions de personnes en France, qui produisent l’équivalent d’environ 60% du PIB quand seulement 500 grandes entreprises produisent les 40% restant. Il est clair que le Système s’appuie principalement sur les 500 patrons de ces grandes entreprises -intrication des intérêts financiers, médiatiques et politiques- beaucoup plus que sur les 3 millions d’indépendants à qui on ne demande que l’approbation tacite et qui ne sont nullement représentés sur le plan syndical. Donc, le maintien des positions du camp national au sein de cet électorat est essentiel et il devrait même se trouver amélioré si l’on parvient à introduire cette césure dans l’esprit des Français entre ce que l’on pourrait appeler les patrons responsables et les patrons commis.
Le patron responsable c’est celui qui a investi ses propres fonds pour la création ou le rachat de son entreprise ; c’est celui qui travaille avec ses employés, souvent plus durement qu’eux ; c’est celui qui risque l’infamie et la perte de ses biens personnels en cas d’échec et non pas l’attribution de stocks options et de « golden parachutes » ; c’est aussi et surtout celui qui a une claire responsabilité de ses engagements vis-à-vis de ses employés et qui ne licencie que lorsqu’il y est acculé et jamais pour des questions de profits immédiats à la demande des actionnaires. Ce patron a un rôle social essentiel dès lors que la richesse qu’il produit bénéficie également à ses salariés et à la collectivité.
Le patron commis est un pur produit du Système. Patron d’une banque ou d’une grande entreprise, multinationale ou non, il est souvent formé par les grandes institutions de la république (ENA, Polytechnique, Grandes Ecoles) et il est ensuite coopté par ses pairs avant d’intégrer son futur champ d’action. Avant l’accélération de la mondialisation, il pouvait être commis par l’Etat dans une de ces grandes entreprises nationalisées à statut public ou mixte dont la France s’était fait une spécialité (Renault, EDF-GDF, Charbonnages de France, SNCF, etc.) aujourd’hui où la puissance régalienne recule devant les diktats de la finance internationale, il est commis par les actionnaires (banques, fonds de pensions, investisseurs institutionnels), mais dans tous les cas de figure, il ne s’agit pas d’un patron au sens traditionnel du terme dans la mesure où non seulement il n’a pas investi un sou dans l’entreprise mais il doit au surplus rendre des comptes à ceux qui l’ont fait roi, et ces derniers aujourd’hui ne poursuivent qu’un unique but : la rentabilité maximale et rapide de leurs investissements. De ce fait la fonction sociale de solidarité avec les salariés de ces pseudo chefs d’entreprises disparaît au profit exclusif de leurs mandants avec le cortège inéluctable de délocalisations, licenciements, fermetures d’usines, etc. qui en découle.C’est donc contre ces patrons commis que le camp national devrait engager une vigoureuse campagne de dénonciation et non pas laisser à l’extrême gauche le bénéfice de ces actions qui a permis à ses leaders d’atteindre en cumul environ 10% des voix lors de la dernière élection présidentielle. Cela implique des actions de terrains, de manifestations de solidarité avec les ouvriers licenciés et de dénonciations systématiques des abus constatés.
Le terme de solidarisme peut parfaitement s’intégrer à une nouvelle articulation du discours social du camp national. Le solidarisme peut se définir comme un système économique et social qui profite à tous dans la mesure où les sommes investies et redistribuées restent sur le territoire où elles sont produites, et bénéficient à l’ensemble de la collectivité sous la forme d’achats de biens ou de services, de salaires et d’impôts. On pourrait lui opposer le terme de capitalisme déraciné ou de capitalisme irresponsable où le capital investi a pour unique fonction d’être rentabilisé le plus rapidement possible au bénéfice exclusif des investisseurs. Le patron responsable fait du solidarisme dans la mesure où ses investissements et la création de richesses qui en découlent profitent à la collectivité. Le patron commis fait du capitalisme irresponsable dans la mesure où les profits qu’il réalise doivent toujours être réalisés au plus bas coût possible et visent prioritairement à payer toujours plus les actionnaires au détriment des salariés et de la collectivité.
Ce discours doit être approfondi dans la dénonciation de la micro-classe oligarchique qui se partage aujourd’hui l’essentiel du pouvoir. Cette nouvelle classe de privilégiés est composée aujourd’hui, outre des hommes politiques nationaux du Système et des dirigeants des principaux médias, mais aussi des grands patrons banquiers ou présidents de multinationales. Le point commun négatif de ces stipendiés du Système est qu’ils travaillent unis contre les intérêts du peuple et au bénéfice exclusif de la finance internationale (cf. le sauvetage des banques à l’aide de nouveaux emprunts que les Français devront rembourser). La théorie de Marx sur la bourgeoisie exploitant le prolétariat pourrait être remise à l’ordre du jour, en intégrant l’idée que désormais une immense classe de néo-prolétaires, incluant les anciennes classes moyennes, est en train de voir le jour et qu’elle se trouve opposée à une oligarchie sans frontière appuyant son pouvoir sur la puissance financière et la religion des droits de l’homme.
L’articulation de ce discours vise à faire comprendre aux électeurs de gauche, qu’il existe une économie « sociale » et solidaire, incluant la notion de profit pour tous, avec laquelle on peut s’entendre et un capitalisme international qui est leur pire ennemi et qui engendre, entre autres maux, le phénomène de l’immigration, qui a pour principal objectif, dans l’esprit de ses promoteurs, de faire peser les salaires des Français à la baisse pour augmenter les profits de l’oligarchie financière internationale.
L’économie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux banquiers. Il est clair que cette option s’inscrit en rupture totale avec l’idéologie libre-échangiste du Système. Maurice Allais, seul prix Nobel d’économie français, préfère employer le terme de laisser-fairisme dans la mesure où le libre-échangisme serait parfaitement applicable dans de grands ensembles régionaux bénéficiant d’un niveau de vie comparable et subissant des contraintes sociales de même nature. Mais si les critiques de Maurice Allais contre les excès du Système sont intéressantes, cet auteur n’en reste pas moins un libéral et n’accepte pas la notion d’économie orientée et régulée nécessaire dans une conception solidariste.
Comment définir une économie solidariste, organique et enracinée ?
C’est avant tout une économie au service du peuple et non pour le bénéfice exclusif d’une oligarchie. De ce fait, elle est automatiquement subordonnée au pouvoir politique qui l’oriente mais ne la dirige pas, sauf dans certains secteurs cruciaux. Elle suit les orientations (incitations fiscales, exemptions ou réductions d’impôts, zones franches, interdictions, limites, restrictions) que lui pose l’Etat. De ce fait, elle agit librement dans un cadre donné en fonction de deux impératifs :
1. assurer le bien-être de la population ;
2. assurer les exigences stratégiques de l’Etat.
Tant que l’économie n’est pas en crise et que ces deux impératifs sont satisfaits, l’Etat n’intervient pas. Dès lors qu’un dysfonctionnement intervient, extérieur ou intérieur (prix du baril de pétrole, pénuries alimentaires, hausse du prix des matières premières ou stratégiques etc.) l’Etat use de son pouvoir régalien pour imposer les mesures qu’il juge nécessaires (baisse ou hausse des prix ou des salaires, inflation ou déflation, augmentation des droits de douanes, contrôle des changes, etc.). En conséquence, et contrairement aux exigences du Système Global, il est vital pour un Etat qui désire conserver son indépendance et sa liberté d’agir, de se désendetter et de pouvoir disposer d’une banque centrale sous son contrôle direct afin de pouvoir jouer à sa guise sur la circulation monétaire dans le pays.
Une économie solidariste doit reposer sur le principe de la libre concurrence mais en respectant les valeurs et les traditions des peuples où elle est appliquée. Contrairement à ce que pense les libéraux, tout n’est pas à vendre ou à acheter. En conséquence l’Etat doit réglementer les secteurs où il souhaite détenir le monopole (transports publics, énergie, défense, télécommunications, médias). Il est même souhaitable que ces secteurs restent sous le contrôle étroit et exclusif de l’Etat, notamment les télécommunications et les médias, du fait de leur utilisation potentielle comme armes stratégiques de désinformation.
Afin d’éviter un assoupissement du système inhérent à toute fonction publique et à toute administration centralisée dépourvue de concurrence, il est souhaitable d’instaurer dans ces administrations un système de rémunération au mérite (comportant des limites), géré par une commission mixte de fonctionnaires de tous grades et d’experts indépendants extérieurs à l’administration.
Pour protéger cette économie de tout choc intérieur ou extérieur, il convient de fixer un certain nombre de principes simples :
1. tout ce que peut fabriquer ou produire le pays, sans coûts excessifs, et qui fournit de l’emploi à des salariés ou est considéré comme d’intérêt stratégique par l’Etat, doit être protégé par des droits de douane, variables selon la nature de la menace, ou être nationalisé.
2. La monnaie nationale n’est pas une marchandise et il faut restaurer le système qui la place hors du champ des spéculateurs internationaux.
3. L’Etat doit s’arroger le droit d’interdire toute société ou organisation étrangère dont l’activité peut être néfaste (sur les plans politique, économique ou culturel) pour le pays.
4. L’impôt doit être juste et équitable et toucher proportionnellement toute les classes sociales (sauf les plus démunies) en évitant de frapper trop fort les hauts revenus ce qui risquerait de faire fuir les élites.
5. L’Etat doit se donner les moyens, même à prix exorbitant et donc non compétitif, de fabriquer ce qu’il estime nécessaire pour son indépendance et dont la perte de savoir-faire lui serait extrêmement préjudiciable. (cf. industrie spatiale).
6. Une économie solidariste doit favoriser le principe de fonctionnement des cercles concentriques : il faut qu’une région consomme prioritairement ce qu’elle produit. Si un produit n’est pas disponible dans la région concernée, c’est à la région la plus voisine de l’approvisionner. Si aucune région du pays ne produit le bien recherché, il sera importé, de préférence d’un pays avec lequel existe des accords bilatéraux d’échanges.
7. Une économie continentale ouverte sur les deux océans doit mettre en place le principe de l’autarcie des grands espaces. Le continent Eurasien, de Brest à Vladivostok, possède largement en son sein de quoi satisfaire tous ses besoins essentiels. Pour les rares denrées (café, chocolat…) ou matières premières qu’elle ne posséderait pas, ou alors en quantité insuffisante, des accords de commerce internationaux avec les pays producteurs permettront de pallier la pénurie.
Ces principes d’économie organique ne sont que de simples mesures de bon sens et ils étaient pratiqués naturellement par tous les Etats du monde avant que la maladie libérale et sa dérive libérale-totalitaire ne se répandent sur la surface de la terre. Ils pourraient être remis en place dans un débat comme alternative positive au système marchand mis en place par ceux qui visent à travers lui à s’assurer le contrôle de la planète.
Notre particularité, c’est la logique de la troisième voie, celle qui réussit la synthèse entre le national et le social. Mais pour ce faire, il ne faut pas heurter de front ceux qui en sont restés à une logique dialectique simpliste de type gauche/droite, à savoir socialisme contre libéralisme. La meilleure définition possible pour un solidarisme moderne c’est : « Au travail, sa place, toute sa place ! Au capital, sa place, rien que sa place ! »
Emmanuel Leroy (14 novembre 2008)